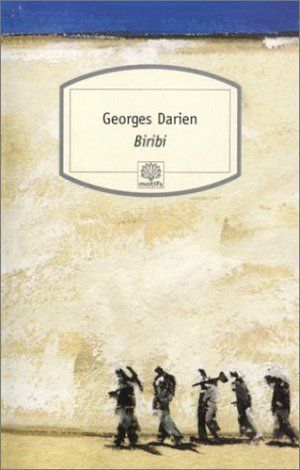Impossible de faire un papier sur ce livre puissant, sur cette langue riche alternant langage soutenu, argot du bagnard, descriptions fabuleuses des choses, des paysages et des gens, ces phrases magnifiques sans taper dans le texte ! Georges Darien est un grand écrivain et son livre Biribi à ranger aux côtés du Voyage au bout de la nuit (Céline), des Raisins de la colère (Steinbeck), de Si c'est un homme (Primo Levi) de La peur (Gabriel Chevalier) entre autres références. Chant de misère, de colère et d'une haine cultivée, arrosée de sueur, de sévices, de tortures, de faim, de soif, d'envies suicidaires, de travaux forcés, d'angoisse, de coups (pieds, poings, nerfs de bœuf), de soleil brulant de toutes les souffrances...par un être conscient et malheureux de la bêtise et de l'injustice criante de son temps.
Ce qu'il me faut, ce que je veux emporter d'ici, tout entière, terrible et me brûlant le coeur, c'est la haine ; la haine que je veux garder au dedans de moi, sous l'impassibilité de ma carcasse. Car la haine est forte et impitoyable; le temps ne l'émousse pas; elle ne transige point. Elle s'accroît avec les années ; chaque jour d'abjection l'augmente ; chaque heure d'indignation la féconde, chaque larme la fait plus saine, chaque grincement de dents plus implacable.
Tout au long de son œuvre Georges Darien esprit humaniste éclairé va s'engager contre les bourgeois, les catholiques, les antisémites, les nationalistes revanchards, les colonialistes, les exploiteurs mais aussi les pauvres qu'il fustige de se laisser soumettre ! Ici il débite sa tranche de vie en petits dés pour peindre les multiples itinéraires de compagnons d'infortune marchant au bord d'un précipice où ils peuvent basculer à tout moment vers la tombe et un oubli total.
C'est le genre de livre qui vous secoue, qui vous prend aux tripes, et transfigure votre apathie, un livre qui vous retire vos œillères et vous pousse à dire non !
Se taire, faire parti de, ne pas hésiter à passer dans le camp des bourreaux seule solution pour échapper à l'horreur d'un siècle, de la brutalité des armées qui donneront 14/18 puis 39/45.
Les trois années volées à Froissard l'avatar de Darien sont à placer sous le signe de l'injustice d'une époque où l'individu n'est rien, pire où l'individu qui revendique est voué à l'exclusion.
La conscription en 1872, se fait par tirage au sort les numéros les plus bas font un service de cinq ans, les autres d'un an seulement. En 1889, la durée du service est fixée pour tous à trois ans, les numéros servant désormais à déterminer l'arme d'affectation. Pour Froissard rien de tout ça puisqu'il s'engage en 1881 pour cinq ans poussé par la violence familiale et la perpétuelle incompréhension d’ainés qui giflent brutalement avec des mots un adolescent qui se cherche.
Quand tu seras soldat, je te conseille, mon ami, de continuer à discuter avec ton insolence habituelle. Sais-tu ce qu’on te fera, si tu raisonnes, si tu es insolent ? hein ? le sais-tu ?
— Non, mon oncle.
— On te passera par les armes.
— On t’exécutera, dit ma tante.
— On te fusillera, dit ma cousine.
Et lui de rester de marbre
— Quand tu auras des galons, mon ami… Souviens-toi bien de ce que je vais te dire, grave-le dans ta mémoire.
— Oui, mon oncle.
— Quand tu auras des galons, ― sois sévère, mais juste.
Il ferme la porte.
Au XIXè siècle, le début de la conquête coloniale fait de l'Afrique du nord une nouvelle zone de relégation. L'armée française y implante des bagnes militaires qui lui permettent de se débarrasser de ses "mauvais sujets". Le parcours est simple les mauvaises personnes où jeunes gens n'ayant pas grand chose à se reprocher mais aussi des "communards" tout ce qui peut gêner une société bourgeoise qui se sert d'une armée pourrie jusqu'à la moëlle, d'une dureté, d'une injustice invraisemblable (point d'orgue la guerre de 14 où des millions de pauvres bougres seront précipités dans des cercueils tranchées) sont exclus, rejetés en Afrique du Nord dans les Bat'd'Af (Bataillons d'infanterie légère d'Afrique). L'armée française refoule donc les mauvaises têtes dans ce vaste archipel pénitentiaire, éparpillé en chantiers ou camps itinérants intimement liés à l'avancée de la colonisation. Froissard/Darien commence en France mais s'ennuie tellement qu'il faute : c'est les Bat'd'Af puis trop de punitions par insoumission dans son régiment lui valent trois ans en bataillon disciplinaire après un conseil de corps expéditif en forme de double peine. "Fatalitas" nous crie Chéri Bibi depuis Cayenne : c'est BIRIBI !
Or, la discipline ― on l’a dit ― la discipline, c’est la peur. Il faut que le soldat ait plus peur de ce qui est derrière lui que de ce qui est devant lui ; il faut qu’il ait plus peur du peloton d’exécution que de l’ennemi qu’il a à combattre.
C’est la peur. Le soldat doit avoir peur de ses chefs. Il lui est défendu de rire lorsqu’il voit Matamore se démasquer et Tranche-Montagne se métamorphoser en Ramollot. Il lui est défendu de s’indigner quand il voit commettre ces vilenies ou ces injustices qui vous soulèvent le cœur. Il lui est défendu de parler et même de penser, ses chefs ayant seuls le droit de le faire et le faisant pour lui. Et s’il rit, s’il s’indigne, s’il parle, s’il pense, s’il n’a pas peur, alors malheur à lui ! C’est un indiscipliné : disciplinons-le ! c’est un insurgé : matons-le ! Donnons un exemple aux autres ! ― Au bagne ! ― À Biribi !
Ces camps de travaux forcés sont le refuge des corrompus de tous grade, de cheffaillon sordides qui n'attendent que ça pour devenir des tortionnaires. Il y règne une injustice révoltante à laquelle certains forçats répondent par la haine en cultivant une vengeance improbable. Lutte du pot de terre contre le pot de fer. Nombreux seront les morts, les brisés, les récupérés, les suicidés...pas Froissard !
Torture :
— Et on les a supprimés, ces silos ?
— Oui, il y a un mois environ. On y avait mis un type auquel on avait attaché les mains derrière le dos. Il y est resté près de quinze jours. À midi et le soir on lui jetait, comme d’habitude son bidon d’eau qui se vidait en route et son quart de pain qu’il attrapait comme il pouvait. Je me souviens que, pendant les cinq ou six derniers jours, il criait constamment pour qu’on le fît sortir. Enfin, quand on l’a retiré, il était à moitié mangé par les vers.
— Oui, mangé par les vers, reprend le perruquier qui a fini de me couper les cheveux et remue un vieux blaireau dans un quart de fer blanc. Tu comprends bien qu’ayant les mains attachées derrière le dos, il ne pouvait pas se déculotter. Il était forcé de faire ses besoins dans son pantalon. À force, les excréments ont engendré des vers et les vers se sont mis à lui manger la chair. Il avait le bassin et le bas-ventre à moitié dévorés. On l’a porté à l’hôpital et il est mort huit jours après. Le médecin en chef a fait du pétard et a réclamé au ministère. Alors, on a supprimé les silos.
Le visage du forçat :
Prey est bien un fou, un pauvre fou. Aucune proportion entre les lignes de cette face bestiale qui porte tatoué : «Pas de chance» sur le front où descendent des cheveux hérissés ; le maxillaire inférieur avançant sur le supérieur et laissant entrevoir la pointe acérée des canines; les yeux injectés de sang. On sent que, chez cet être au cerveau déséquilibré, la conscience n'existe pas. On sent que, dans sa naïveté cynique, il n'hésiterait pas à se servir, pour étendre du fromage sur son pain, du lingre à la virole (petit couteau type opinel) encore rouge avec lequel il aurait suriné, la veille, un pante (bourgeois) au coin d'une borne. Un de ces prédestinés des fins lugubres, poussés vers le crime par une fatalité inéluctable, et sur le berceau desquels le couperet sinistre de la guillotine a projeté son ombre triangulaire. Je connais peu de sa vie. Le peu qu'il en sait lui-même et qu'il m'a raconté en riant, d'un air triste, avec des expressions baroques, magnifiques et atroces, qui font couler dans le dos le froid d'une lame de couteau et qui jettent parfois comme un rayon d'or sur des remuements de boue : le père au bagne, la mère indigne, la maison de correction à treize ans... Toute l'épopée lamentable d'un de ces parias dans la pauvre âme desquels la société ne sait pas voir et dont elle jette un jour le cadavre, la bourgeoise jouisseuse, dans le panier sanglant du bourreau.
Beauté d'une phrase cryptique, d'une description
Mon rêve a glissé sur le pavé gras dont la pente mène à l'égout, et s'en va à vau-l'eau, maintenant, roulé par les flots sales de ce fleuve qui coule, bête et jaune, dans les brumes grises, et dont le courant se partage, au tranchant des piles du pont, sans un bruissement, sans un bruit, sans une écume.
Les maisons aux hautes façades pâles, aux fenêtres mornes, les longues avenues au sol cendré et froid où tremblotent les squelettes ridicules des arbres violets, le ciel blafard et décoloré comme une vieille bâche, les silhouettes vilaines des édifices mangés par les vapeurs caligineuses que piquent déjà les points jaunes des becs de gaz, les taches noires et frissonnantes des passants qui glissent vite, silencieusement..
Peur
Ce n’est que par la peur que le système militaire a pu s’établir. Ce n’est que par la peur qu’il se maintient. Il doit peser sur les imaginations par la terreur, comme il doit remplir d’obscurité l’âme des peuples pour les empêcher de voir au delà de l’horizon stupide des frontières.
Stupidité de l'armée :
Aucune de ces phrases : « Au commandement, Haut pistolet ! ― La baguette en avant ― Les rênes passées sur l’encolure » ne font bondir votre cœur dans votre poitrine, m’a dit l’autre jour le capitaine-instructeur.
Malheureusement, on est assez porté, dans l’armée, à juger de l’intelligence d’un homme d’après le degré de luisant et de poli qu’il est capable de donner à un bout de fer ou à un morceau de cuir.
Armée
Je pense à cette armée que je vais quitter. Je l'envisage froidement, laissant de côté toutes mes haines.
C'est une chose mauvaise. C'est une institution malsaine, néfaste.
L'armée incarne la nation. L'histoire nous met ça dans la tête, de force, au moyen de toutes les tricheries, de tous les mensonges. Drôle d'histoire que celle-là ! Dix anecdotes y résument un siècle, une gasconnade y remplit un règne. Batailles! batailles ! combats ! Elle a osé fourrer la Révolution dans la sabretache des généraux à plumets et jusque dans le chapeau de Bonaparte, comme elle a fait bouillir le grand mouvement des Communes qui précéda la bataille de Bouvines dans le chaudron où les marmitons de Philippe-Auguste ont écumé une soupe au vin. Elle prêche la haine des peuples, le respect du soudard, la sanctification de la guerre, la glorification du carnage...
Ah! Mascarille! toi qui voulais la mettre en madrigaux, l'Histoire !
Elle nous a donné le chauvinisme, cette histoire là ; le chauvinisme, cette épidémie qui s'abat sur les masses et les pousse, affolées, à la recherche d'un dictateur.
L'armée incarne la nation! Elle la diminue. Elle incarne la force brutale et aveugle, la force au service de celui qui sait lui plaire et—c'est triste à dire, mais c'est vrai—de celui qui peut la payer.
«Cela s'est fait, mais ne se fera plus.» Si, la blessure ne se guérira point. La gangrène y est.
L'armée, c'est le réceptacle de toutes les mauvaises passions, la sentine de tous les vices. Tout le monde vole, là-dedans, depuis le caporal d'ordinaire, depuis l'homme de corvée qui tient une anse du panier, jusqu'à l'intendant général, jusqu'au ministre. Ce qui se nomme gratte et rabiau en bas s'appelle en haut boni et pot-de-vin. Tout le monde s'y déteste, tout le monde s'y envie, tout le monde s'y torture, tout le monde s'y espionne, tout le monde s'y dénonce. Cela, au nom de soi-disant principes de discipline dégradante, de hiérarchie inutile. Avoir un grade, c'est avoir le droit de punir. Punir toujours, punir pour tout. De peines corporelles, naturellement; celles-là seules sont en vigueur... Ah! c'est triste qu'un bout de galon permette à un homme de mettre en prison son ennemi—ou de faire fusiller son camarade.
L'armée, c'est le cancer social, c'est la pieuvre dont les tentacules pompent le sang des peuples et dont ils devront couper les cent bras, à coups de hache, s'ils veulent vivre.
Ah! je sais bien: le patriotisme!... Le patriotisme n'a rien à faire avec l'armée, rien; et ce serait grand bien, vraiment, s'il n'était plus l'apanage d'une caste, la chose d'une coterie, l'objet curieux que des escamoteurs ont caché dans leur gibecière, et qu'ils montrent de temps en temps, mystérieux et dignes, à la foule béante qui applaudit. Ce sentiment là, je crois, n'est pas forcément cousu au fond d'un pantalon rouge. Il y a peut-être autant de patriotisme dans l'écrasement banal d'un maçon qui tombe d'un échafaudage ou dans la crevaison ignorée d'un mineur foudroyé par un coup de grisou, que dans la mort glorieuse d'un général tué à l'ennemi. Et il y a de bons patriotes, voyez vous, qui haïssent la guerre, mais qui la feraient avec joie—si l'on tentait d'assassiner la France—parce qu'ils auraient l'espoir grandiose, ceux-là, non pas d'écraser un peuple, mais d'anéantir, avec le gouvernement qui le régit, toutes les tendances rétrogrades, féodales, anachroniques—le caporalisme.