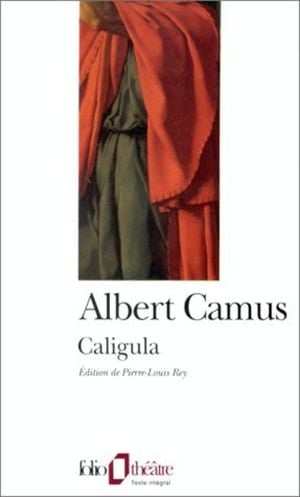Caligula et Le Malentendu
La première pièce présentée dans cette édition, Caligula, est la raison principale de l’achat de ce livre, trouvé d’occasion dans une petite librairie il y a quelques jours. Le nom de Camus, imprimé dans les mêmes lettres épaisses que l’empereur romain, dont la légende me trouble autant que celle de Néron, a dépassé ma répugnance à lire du théâtre.
Je ne privilégie pas, habituellement, la lecture de pièces. Lire Shakespeare ou Molière a souvent été une longue et désagréable expérience -toujours moins désolante que les mauvaises représentations que j’ai pu voir du second-, et je m’ennuie de ces dialogues sans articulations, lâchés dans le vide à la merci d’une imagination que je me permets d’ordinaire d’abandonner au talent d’un écrivain. Lire du théâtre me demande souvent un effort de concentration aussi désagréable que celui que Victor Hugo m’impose à la lecture de sa prose, et je préfère, bêtement, ignorer des chefs d’oeuvres plutôt que de m’infliger une lecture stérile.
Pour Caligula, l’expérience a été considérablement différente. La lecture est à la fois rapide et profondément hypnotique. J’ai volontairement ralenti mon rythme au fur et à mesure, et suis revenue plusieurs fois sur certains passages, tant la pertinence et la précision des différentes sensibilités y sont remarquablement décrites. J’ai cependant dû faire abstraction de la projection de ces dialogues sur une scène, car l’aspect dramatique, bavard et éloquent des personnages me paraît toujours aussi caricatural au théâtre. Mais la lecture nue de ces dialogues est saisissante.
Je n’essaierai pas de retranscrire ici la démarche de Camus, qui choisit un personnage dont le nom est parvenu jusqu’à nous comme celui d’un fou cruel, et qui en fait un homme ambigu, d’une intelligence crue et linéaire, et dont l’inhumanité réside au contraire dans une conscience torturée de l’humanité. Il décrit un manipulateur touchant, un travesti ignoble et poétique. Et il en résulte que la lecture de cette pièce offre une description à la fois tortueuse et essentielle d’un glorieux pantin, dont on s’éprend d’un amour laid, mais curieusement sincère.
Le Malentendu laisse une nouvelle fois à Camus l’étude de personnages tragiquement hideux et bouleversants. De cette pièce au déroulement plus conventionnel, peut-être plus prévisible, on retire surtout la scène finale, qui est, à mon sens, ce qui fait de son théâtre un morceau de véritable littérature. Le personnage de Martha, qui rappelle en un sens celui de Caligula, est un modèle de subtilité dans le traitement complexe des mutations de l’esprit humain. En cela, Camus réussit une nouvelle fois à imposer non pas une démonstration achevée des passions, mais l’ébauche d’une réflexion sublime sur la variation des sentiments, une préparation à l’agitation et aux soubresauts de l’âme humaine, qui creuse, arrange ou défigure ses personnages.
Je conseillerais cette lecture à tous ceux que la tentative d’exploration des esprits fascine, car sans hésiter, Camus est l’un de ceux dont la proposition dans ce domaine est la plus sincère et la plus frappante.