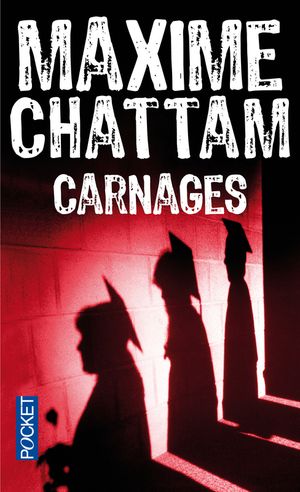Carnages par EncoreDuNoirYan
Lamar Gallineo, inspecteur de la police de New York se trouve confronté à une bien singulière affaire. En l’espace de quelques semaines, trois lycéens font un carnage à l’arme à feu dans leurs établissements respectifs avant de se suicider. Il semble toutefois que, si les bourreaux présumés se sont donnés la mort, il y ait un lien direct entre ses trois affaires et Lamar va tenter de mettre fin à cette série de massacres.
Commençons par expliciter notre choix. Pourquoi s’intéresser à ce roman de Maxime Chattam plutôt qu’à un autre ? Pour deux raisons qui tiennent en une : il est court.
Il est court – à peine un peu plus de 80 pages – et une première tentative il y a quelques années de lire un roman de Maxime Chattam (In tenebris) avait tournée court aux environs de la page 30. Choisir un roman court était donc le garant d’une lecture complète.
Il est court, et cela semble changer du gros de la production de la Ligue de l’Imaginaire dont les auteurs publient couramment des livres qui dépassent allègrement les 400 ou 500 pages. Il est donc intéressant aussi de voir comment un auteur qui publient généralement des romans assez longs va trouver à resserrer une intrigue. Dans ce collectif d’auteurs qui affirme son désir de tenir le lecteur en haleine, le fait de lui offrir un roman court peut apparaître comme un moyen de maintenir une tension importante. Cela nécessitera bien sûr une construction sans failles et une économie de moyens. Alors, pari réussi ?
Parlons donc pour commencer de la narration. Et passons assez vite sur les questions de style. D’une manière générale, l’écriture de Chattam apparait relativement fade avec une certaine propension à la métaphore et à la comparaison maladroitement grandiloquentes (« L’établissement ressemblait à un golem de pierre agenouillé, des tentacules de pierre à la place des bras s’étalant entre des flaques de bitume et des nappes d’herbes », première phrase du roman, p. 9 ; « Des bouteilles d’alcool et de soda jonchaient le sol comme la flore apocalyptique de ce bunker », p.80 ; « Le canon beugla, vomissant sa gerbe d’acier en fusion », p.83), ainsi que, régulièrement, à une syntaxe et une sémantique peu claires, voire approximatives : « Toute la ville tremblait dans l’incompréhension », p. 27 ; «Un obscur secret se tramait derrière tout ça », p. 39 ; « (…) personnes suspectées d’être impliquées dans des activités ou une doctrine néonazies ou apparentées », p. 75 ; « La haine s’empara de son faciès », p. 82.
Ces scories existent bel et bien et peuvent s’avérer agaçantes mais elles restent toutefois supportables, la faible longueur du récit et la nécessité de le faire avancer rapidement empêchant de fait les longs développements dans lesquels elles pourraient faire leur nid.
Cela nous amène nécessairement à la question de la dynamique du récit ; dynamique que la structure courte dudit récit rend primordiale. Et c’est bien là que le bât blesse. Maxime Chattam développe une intrigue qui, nous l’avons dit, se déroule sur plusieurs semaines. 18 pages sont consacrées au premier massacre, une cinquantaine à la résolution de l’affaire. Entre les deux, il reste à peine un peu plus d’une douzaine de pages pour évoquer les débuts de l’enquête et les deux autres massacres. Donc, l’auteur coupe, élude. Un procédé qui pourrait éventuellement tenir la route avec une histoire simple. Mais Maxime Chattam a opté pour une intrigue à rebondissements. En fait, il va privilégier la tension dans l’action de la dernière partie, avec course contre la montre, confrontations et multiples coup de théâtre (nous y reviendrons) au détriment sinon de la cohérence, du moins de la crédibilité de l’histoire, et surtout, de celle des personnages. D’où l’impression d’une intrigue dont il manque des pièces, des parties entières, et qui, au bout du compte, semble particulièrement tirée par les cheveux.
Les personnages eux aussi, donc, participent de cette sensation d’artificialité – au sens non pas d’imaginaire, mais de manque de profondeur – à commencer par le héros, Lamar Gallineo, dont le portrait est dressé, ou plutôt esquissé, en une bonne page. On y apprend qu’il a deux handicaps pour être flic : il est trop grand, et il est noir. On comprend bien que la question du racisme dans la police puisse être un frein pour un noir, on reste dubitatif sur la question de la taille, si ce n’est qu’elle permet l’auteur de faire une blague sur les basketteurs. Lamar a finalement réussi à faire son trou grâce à « quelques bon coups de flair » (p. 14) et à la discrimination positive. Si Chattam va ensuite s’échiner à nous montrer comment Lamar est un bon flic (c’est simple, dès qu’il y a un meurtre c’est lui que l’on contacte), il expédie ici un portrait qui tendrait plutôt à prouver qu’il est surtout chanceux.
L’autre personnage important du roman est bien sûr l’instigateur présumé des massacres, un lycéen renvoyé de plusieurs établissements. Là encore, le portrait est vite brossé et ses motivations implacablement montrées du doigt par le très perspicace Lamar : « N’oublie pas qu’il s’est fait virer quatre fois ! C’est un… turbulent. S’il a ressassé sa soif de vengeance pendant des mois et des mois, il aura fini par élaborer ce stratagème perfide » (p. 63). On y ajoutera une pincée de nazisme pour mieux l’opposer à l’inspecteur noir et jouer un peu avec l’imagerie du Troisième Reich lorsque Lamar pénètre dans la cave où l’ado rebelle dissimule ses jouets : « Puis il dut reculer pour voir dans son ensemble l’immense drapeau qui était accroché contre le mur opposé. Un étendard rouge sang énorme. Avec un cercle blanc au milieu. Et la croix gammée tournant en son centre », p. 69.
De là, on peut tirer déjà un des aspects principaux du roman, à savoir un traitement ambigu de son sujet. Il ne s’agit pas de parler de faits de société. L’utilisation de faits divers qui ont marqué la société occidentale, ces massacres commis par des lycéens, à Columbine ou en Finlande, n’est là que pour servir de toile de fond à un semblant de combat entre le Bien et le Mal en jouant vaguement avec le politiquement correct. En l’occurrence, on présente un héros noir et un méchant néonazi ; pari osé si le livre avait été écrit en 1934. Surtout, il en ressort une certaine de fascination morbide de l’auteur envers cette symbolique pseudo-nazie (bannière, référence au bunker) maladroitement mêlée à l’imaginaire juif dans la phrase d’introduction qui se réfère au Golem. Il ne faut bien entendu pas en tirer une conclusion hâtive sur une quelconque prise de position politique de l’auteur. Il s’agit plutôt de l’utilisation à destination d’un lectorat qui en est avide, d’une symbolique qui s’appuie sur la littérature et le cinéma d’horreur, les jeux de rôles mâtinés de mythologie médiévale etc. Bref, de quoi faire frissonner à l’aide d’un peu de grand guignol particulièrement appuyé par le biais de l’utilisation régulière lors des fusillades de l’image de la cervelle qui vient recouvrir un visage, se coller au plafond…
C’est sans doute là que vient se loger l’imaginaire dont Chattam est l’un des hérauts. Dans cette symbolique approximative et puérile, ambiance bivouac de colonie de vacances autour d’un feu de camp où l’on se raconte l’histoire du tueur du vendredi soir. Sauf que l’on n’est pas forcément au coin du feu, que l’on n’est pas non plus forcément un adolescent prépubère et qu’il en faut plus pour nous effrayer et nous entrainer dans l’histoire. Il en ressort un sentiment de vacuité accentué par un élément relevé dans d’autres critiques faites lors de ce défi : l’utilisation quasi systématique des coups de théâtre à répétition ; un procédé qui finit par devenir tellement banal que la véritable révolution serait d’écrire un livre dans lequel on ne trouverait jamais le coupable. On a en fin de compte l’impression d’avoir lu un ouvrage qui cherche à provoquer la montée d’adrénaline mais qui s’avère être sans surprise et d’une grande fadeur.