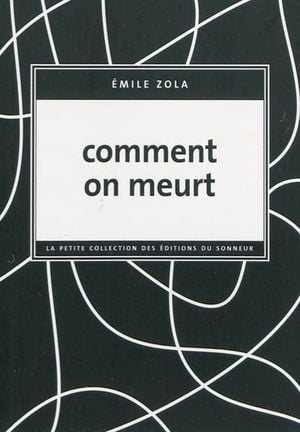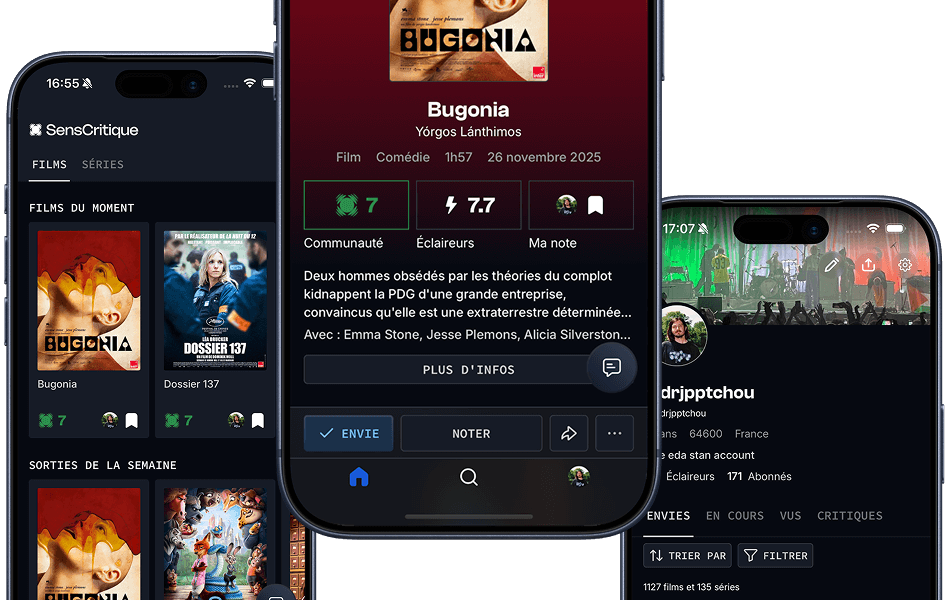Le thème de la mort, obsessionnel chez Zola au vu de la récurrence des scènes d’enterrement dans les Rougon-Macquart et de la spirale d’hypnose que constituent dans son œuvre les motifs macabres, est exploité par l’auteur naturaliste comme un révélateur des mentalités et des automatismes sociaux. Déjà essayé une année plus tôt dans Comment on se marie, Zola applique, une nouvelle fois en 1876, son procédé de « description physiologique » au deuil.
C’est une sorte d’enquête sociologique mise en narration que livre Comment on meurt, dans un style à première vue purement informatif. La dramatisation elle-même est totalement asséchée, ne faisant guère plus qu’articuler une série d’étapes marquantes, toujours les mêmes : la vie d’avant, l’agonie, le cortège funèbre, la mise en fosse, la vie d’après.
Plus mécanique encore, la partition en chapitres de la nouvelle tend à donner une vue globale de la société, à travers cinq types sociaux : un aristocrate fortuné, une grande bourgeoise riche et avare, l’épouse d’un petit marchand parvenu, l’enfant d’ouvriers miséreux, et un vieux paysan, fils de la terre – l’accent étant bien entendu mis sur l’entourage des défunts.
On pourrait d'abord croire à une parodie par exagération du naturalisme, mais, à bien y regarder, l’écriture de cette nouvelle recèle de petits trésors. Le style est plus coloré qu’il ne le laisserait paraître, variant d’une prose polie pour les couches aristocratiques à des paroles rapportées tout à fait matérialistes pour les milieux populaires, jusqu’à une profonde sérénité rurale que rendent les résonnances de la Nature. Ces modulations insufflent une certaine vie à l’analyse, et le sens zolien du détail y crée un charmant mélange des tons. La dignité des premières funérailles se mêle à une moquerie caustique des petites vanités du monde parisien ; le pathétique de la mort de la petite marchande ou de l’enfant d’ouvriers s’enlace à une écriture sourde, qui gronde, écho de l’absurdité de la mort aveugle qui les frappe et à laquelle les misérables se résignent. Un paragraphe incisif, assassin, clôt chaque paragraphe, sentence lucide quant à la condition humaine. Pour les fils de la bourgeoise avare défunte, par exemple :
« C’est la morte qui se réveille en eux, avec son avarice et ses terreurs d’être volée. Quand l’argent empoisonne la mort, il ne sort de la mort que de la colère. On se bat sur les cercueils. »
Ou encore après la mort de Charlot, l’enfant des miséreux, qui aura succombé quelques heures avant l’arrivée des secours de bienfaisance :
« C’est fini. La terre coule, Charlot est au fond du trou, et les parents s’en vont, sans avoir pu s’agenouiller, dans la boue liquide où ils enfoncent. Dehors, comme il pleut toujours, Morisseau, qui a encore trois francs sur les dix du bureau de bienfaisance, invite les camarades et les voisines à prendre quelque chose, chez un marchand de vin. On s’attable, on boit deux litres, on mange un morceau de fromage de Brie. Puis, les camarades, à leur tour, paient deux autres litres. Quand la société rentre dans Paris, elle est très gaie. »
C’est que Zola, dans Comment on meurt, n’est pas qu’un simple informateur. Il prête sa voix à ceux qu’il aborde, et, dans la foule des condamnés, il jette quelques lumières ; il ne va pas leur offrir une rédemption, seulement un espoir d’être entendus un instant, en tant qu’individus uniques, membres égaux d’une même foule. Si le paysan Lacour n’est pas tous les paysans, il est l’un d’eux, une voix parmi le chœur, dont la nouvelle porte le chant.
Dans cette simplicité heureuse, Zola fonde la complexité de ses plus beaux textes. D’un regard, il parvient à saisir l’entièreté d’une multitude, sans en aplanir les contours, sans en lisser les aspérités.