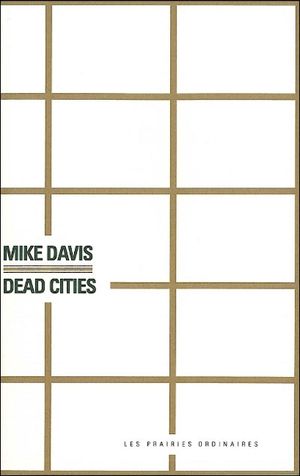Dans sa version française, publiée en 2009 par les Prairies ordinaires, Dead Cities regroupe trois chapitres, contre dix-huit dans sa version originale de 2002 ou 2003 : pourquoi cette habitude qu’ont certains éditeurs, en particulier dans le domaine des sciences humaines, de publier des livres tronqués ? Le lecteur francophone serait-il jugé d’avance trop paresseux pour lire quatre cents pages au lieu de cent ? trop peu curieux pour s’intéresser à Las Vegas ou à Los Angeles en plus de New York, Londres ou Berlin ? L’importance de l’auteur serait-elle trop minime pour qu’on n’en présentât qu’une sorte de florilège – établi d’après quels critères ? Bref.
J’ai parlé de chapitres, mais essais eût tout aussi bien convenu : « Le cadavre berlinois dans le placard de l’Utah », « Les Flammes de New York » et « Villes mortes : une histoire naturelle » sont aussi lisibles comme des textes indépendants, entre lesquels le jeu d’échos n’est guère différent de celui qu’on peut établir entre plusieurs livres d’un même auteur.
Dugway, dans l’Utah, a abrité pendant la Deuxième Guerre mondiale des quartiers allemand et japonais – sans Allemands ni Japonais, car ils ont été construits par l’armée états-unienne pour servir de cibles d’entraînement en vue des bombardements de l’Allemagne et du Japon. New York, le 11 septembre 2001, a vu deux de ses principaux centres d’affaires s’effondrer – et une partie de ses affaires avec eux. Londres, probablement au XXe siècle, et les États-Unis, probablement au XXe siècle puis en 2013, ont été reconquis par la nature – respectivement dans After London de Richard Jefferies (1885), La terre demeure de George R. Stewart (1949) et la Peste écarlate (1912), « diatribe hystérique sur l’eugénisme » (p. 97) de Jack London. On aura compris que le fil rouge qui relie les différentes parties de l’essai de Mike Davis, c’est le thème de la destruction urbaine, analysée – attention, langage administratif ! – en amont et en aval.
Sans parler d’hétérodoxie, la lecture de l’histoire par Mike Davis sort parfois des sentiers battus. Ainsi la troisième partie se fonde-t-elle sur des récits d’anticipation : son propos est précisément de montrer que certains de ces anticipations (dans After London, « tout d’abord une explosion végétale, puis une reforestation, suivie par la vengeance de la Tamise », p. 86) ont vu juste, si l’on en croit les expériences réelles les plus proches de la fiction, comme Pripyat ou plus simplement « ces oasis biologiques que constituent les “sites urbains en friche” de l’Europe post-industrielle ; “des îles vertes” dont la diversité d’espèces excède d’ordinaire non seulement celle du restant de la ville, mais aussi celle des campagnes génétiquement modifiées parsemées de fermes industrielles » (p. 119).
Aussi cyniques qu’elles puissent paraître, ces analyses revigorent : dire que « Churchill, qui pensait qu’un certain nombre de bombardiers Lancaster pourraient faire à nouveau basculer les travailleurs berlinois dans l’anti-fascisme, restait en ce sens un marxiste plus orthodoxe que Staline, qui semble être le seul à avoir compris l’importance de l’emprise morale de l’hitlérisme sur la capitale du Reich » (p. 18-19) ou que « Les agences de maintien de l’ordre […] considéraient les incendies comme une forme criminelle de réaménagement urbain : un déplacement stratégique du coût du déclin urbain des propriétaires vers les assureurs » (p. 133) n’est pas une simple provocation.
Pour finir, quiconque s’intéresse au thème de la peur dans les États-Unis pré- et post-11 Septembre (« la tension déjà présente dans les perceptions collectives avant que la Vraie Terreur ne débarque d’une flotte d’avions de ligne », p. 44) gagnera à lire le deuxième chapitre : « Quand les hypocondriaques finissent par contracter la maladie qu’ils redoutent le plus, leurs ontologies ont tendance à se détraquer » (p. 48). Où l’on retrouve le thème de la nation comme organisme, à ce titre susceptible d’être atteint par la souffrance et la maladie mentales…