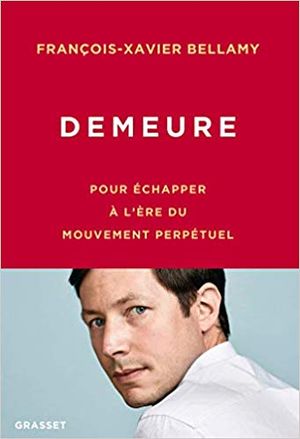Quand on s’interroge sur les conséquences de la révolution scientifique sur notre façon d’appréhender le monde, on pense tout de suite à l'ébranlement causé par le passage du géocentrisme à l’héliocentrisme. Se considérer soi-même le centre de l’Univers n’est-il pas le signe d’un orgueil mal placé ? Rétrospectivement, la modernité interprète en ce sens cette révolution : on répète à satiété la fameuse thèse de Freud sur les trois blessures narcissiques que la science aurait infligée à l’humanité.
En réalité, moins que cette prétendue blessure narcissique, la révolution scientifique aura surtout profondément transformé notre rapport à l’espace et au mouvement. Une révolution aux conséquences gigantesques dont on a pourtant bien du mal à analyser les effets véritables, tant les modes de pensée ont changé depuis lors.
I. Petite philosophie de l'espace
Le cosmos grec
L’événement décisif de ces derniers siècles est que nous avons cessé de vivre dans un cosmos.
Cosmos, en grec, désigne le bon ordre, la beauté résultant d’une disposition harmonieuse. Le choix de ce mot n’est évidemment pas neutre : l’ensemble des choses était perçu comme un tout bien ordonné, où chaque élément occupait une place qui lui revenait. Ainsi, dans un tel univers, les différents éléments sont disposés les uns par rapport aux autres en fonction de leur nature et de leur dignité.
Par exemple, la terre est située sous le ciel. Le ciel, symbole de la perfection mathématique et géométrique, était la demeure des dieux. Dans le modèle aristotélicien de l’univers, cet espace divin débutait au-delà de la Lune. En deçà d’elle, c’était le monde chaotique, le lieu des mouvements désordonnés. Dans ce modèle, l’espace y est donc profondément inhomogène, hiérarchisé. Notre position centrale, chez les grecs, n’était pas une marque d’orgueil, mais signifiait au contraire notre moindre dignité.
Le modèle aristotélicien du cosmos, en vigueur jusqu’au Moyen-Âge, était contrebalancé par la cosmogonie biblique, faisant de l’homme le sommet de la création. Mais s’il existe un point commun entre ces deux visions, c’est la connotation éthique qu’ils attachent à l’univers (le cosmos chez les grecs ou la création chrétienne). « Dieu vit que cela était bon» lit-on dans la Genèse.
L'espace géométrique
Ce que vient pulvériser le modèle héliocentrique, c’est justement ce cosmos si bien ordonné. Car l’héliocentrisme signifie bien plus qu’un simple changement dans la fixité d’un référentiel. Les résistances opposées en leur temps au modèle héliocentrique peuvent certes paraître disproportionnées, incompréhensibles, et après coup on les a attribué à une blessure narcissique. Les adversaires les plus farouches n’étaient pas mus par une vanité blessée mais au contraire par une humilité qui leur faisait juger insensée l’idée de mettre la terre au même rang que les astres.
Montaigne décrivait ainsi l’homme comme une créature logée « parmi la bourbe et la fiente du monde, attachée et clouée à la pire, plus morte et croupie partie de l’univers, au dernier étage du logis et le plus éloigné de la voute céleste […] ; et se va plantant par imagination au-dessus du cercle de la Lune et ramenant le ciel sous ses pieds ».
Dans le système géocentrique, l’homme avait peut-être une place peu reluisante mais il avait une place bien à lui dans un ensemble qui faisait sens. Dans le nouveau monde, la terre devient une demeure de hasard, une planète, c’est-à-dire, en grec, "astre errant". La terre n’avait jamais été une planète jusqu’à l’arrivée des temps modernes. Elle était notre demeure, un point fixe et central autour duquel se déployait un cosmos. Avec l’héliocentrisme, la distinction qualitative entre le monde cosmique et la terre s’efface, l’espace s’homogénéise. Pire encore : l’univers entier se trouve neutralisé de toute portée éthique. L’homme se retrouve perdu dans le silence éternel des espaces infinis.
La demeure
Pour François-Xavier Bellamy, c’est cette dimension existentielle de l’espace que nous avons perdu, cette capacité à pouvoir qualifier l’espace qui nous entoure. Habiter le réel, demeurer quelque part, suppose de reconnaître un proche et un lointain, qui ne sont absolument pas commensurables ou assimilables l’un à l’autre. Des lieux familiers et d’autres étrangers ne peuvent se réduire à une simple distance géométrique. « Il a fallu la civilisation moderne pour que l’homme décrive tout l’univers comme un espace ». Un espace purement mathématique et géométrique est incapable de différencier l’ici et le là-bas.
« Les lieux où a grandi ma famille ne sont pas équivalents à n’importe quelle autre surface égale : ils sont saturés de souvenirs, d’habitudes et d’images intérieurs ; ils ont été peu à peu façonnés, décorés, usés par les répétitions quotidiennes et les petits événements qui ont déposés leur trace dans la mémoire des murs et des meubles. Ils sont devenus une demeure à nulle autre pareille, le "chez-soi" qui devient une sorte de centre du monde. ».
Ainsi, une maison, une demeure, constitue un centre construit par une mémoire, une expérience, et autour duquel s’organise la conscience de l’univers entier. Ce sont les ornements, les coutumes, les rites et même les mythes – toutes choses non matérielles paraissant parfaitement superflues et gratuites - qui viennent aménager et qualifier un espace pour en faire un lieu authentiquement humain. Au contraire, dans l’espace indifférencié de la science moderne, tout ce qui pourrait prétendre habiter l’espace social (cultures, héritages, religions, etc.) doit être rendu invisible, impalpable, insensible.
II. Petite philosophie du mouvement
La deuxième grande rupture causée par la révolution scientifique porte sur notre interprétation du changement et notre rapport au mouvement. La "réalité" se définit-elle par le changement ou la stabilité ? Et là aussi, il nous faut remonter à l’Antiquité.
Parménide et Héraclite
Pour Parménide le changement n’est qu’illusion. Comment pourrait-il en être autrement ? En effet, si tout est en permanence changeant et fluctuant il faut admettre que rien ne peut être véritablement connu. Pour dire ce qui "est", il faut comme condition nécessaire que l’être reste identique à lui-même.
Chesterton affirmait de l'évolution permanente des choses « qu’elle signifie qu'il n'existe pas de chose appelée chose. Au mieux, il n'y a qu'une seule chose, et c'est un flux perpétuel de tout et de n'importe quoi. C'est là une attaque portée […] contre l'esprit : on ne peut penser, s'il n'y a rien à penser ».
Reste pourtant un problème de taille : peut-on faire fi à ce point de ce que nous disent nos sens ? Car tout semble bien en mouvement, en changement permanent. C’est ce point de départ, l’expérience sensible, que prendront les partisans du flux. Héraclite, le plus célèbre d’entre eux, affirme que l’essence de la réalité se trouve dans le changement. Pour lui, rien n’est stable, tout se meut, sans jamais s’interrompre. « On ne peut entrer deux fois dans le même fleuve ».
Mouvement ou stabilité ? Comment résoudre ce paradoxe apparent ?
Aristote
Une solution magistrale sera trouvée pour un temps par Aristote. Une solution, ou plutôt une synthèse.
Aristote, passionné par la physique (phusis en grec désigne la dimension mouvante et changeante de la nature), ne partage pas la défiance de certains de ses maîtres pour le réel. Quand tout semble prouver le contraire il n’est pas question d’affirmer que le mouvement n’existe pas (Zénon s’était essayé à une démonstration de l’impossibilité logique du mouvement : qui n’a jamais entendu parler du Paradoxe de Zénon, mettant en scène une course entre Achille et une tortue ?).
Cependant, pour Aristote, tout n’est pas affaire de mouvement : il est même nécessaire, pour expliquer le mouvement, que quelque chose lui échappe. Chez Aristote le mouvement existe partout dans la nature, mais il ne se déroule qu’en direction d’un but qui, lui, est fixe et stable. Le devenir est polarisé vers une fin (une cause finale dit-on).
Dans le monde qui nous entoure cette idée est parfaitement évidente : nos actions, nos actes, semblent bien être ordonnés (et même subordonnés) à un but qui leurs donne un sens. En biologie, la croissance végétale (ou embryonnaire) semble elle aussi dirigée vers un objectif. Pour ce qui est des objets inanimés, c’est le même principe : les corps sont attirés en direction de leur lieu "naturel" où ils pourront demeurer au repos. Chez Aristote, l’espace, on l’a vu, est polarisé par des différences (le haut/le bas, le ciel/la terre) qui ne peuvent être confondus ou mélangés.
Galilée
Dans son Dialogue sur les deux grands systèmes du monde Galilée introduit un concept qui va fonder la mécanique moderne : la relativité. Relativité non pas du temps mais du mouvement. Pour le savant italien, la stabilité réelle, l’immobilité absolue, n’existe nulle part dans la nature. Elle est toujours relative à un référentiel. L’immobilité n’est en fait que du mouvement annulé par un effet de perspective.
Ainsi, installés dans un train en marche les objets qui nous environnent nous paraissent stables, immobiles. Mais ce n’est qu’une affaire de référentiel : observés depuis le quai, ceux-ci paraissent alors mobiles.
Croire qu’il existe quelque chose d’immobile n’est donc que la conséquence d’un aveuglement volontaire, le choix d’isoler certains objets dans l’espace et ne regarder qu’eux. Tout est en mouvement, rien n’est immuable. Le repos n’existe pas. Or, si tout est en mouvement, il ne peut pas non plus y avoir de centre dans l’univers (ni la Terre, ni le soleil, ni rien d’autre) : idée magnifiquement pressentie par Giordano Bruno qui la porta jusqu’à ses conséquences ultimes.
Newton, avec le principe d'inertie, fera du mouvement un simple état : au repos, un corps peut se mouvoir de lui-même indéfiniment.
Demeurer en mouvement
La révolution scientifique, selon François-Xavier Bellamy, consacre la victoire de la vision héraclitéenne du monde. « A un point que le philosophie grec lui-même n’aurait sans doute jamais osé envisager, il semble désormais attesté que « tout s’écoule ». Nos conceptions du monde, notre idée de l’histoire, l’idée que nous avons de nous-même et de nos vies héritent de ce basculement sans précédent. La modernité instaure un nouveau rapport au mouvement : le changement constitue la loi fondamentale de notre époque.
Pendant un temps, les grandes idéologies de l’époque moderne furent encore marquées par une eschatologie (un accomplissement final), c'est-à-dire par un fond de théologie chrétienne. Que le changement historique mène au cosmopolitisme universaliste (Kant), à la réalisation de l’Esprit absolu (Hegel), au triomphe de la démocratie libérale (Fukuyama), à la société sans classe (Marx), celui-ci était orienté vers un état stable et durable. Le caractère presque religieux du progressisme a perdu depuis lors toute dimension eschatologique, suite aux désillusions tragiques du XXe siècle. A présent tout changement n’a d’autre but que lui-même.
« C’est comme si l’invitation que Marx adressait aux philosophes, de cesser d’interpréter le monde pour se mettre à le transformer, était devenue un impératif catégorique : le monde n’est rien d’autre qu’une chose à transformer, peu importe la manière. » (Olivier Rey).
Cette frénésie sans fin de mouvement, François-Xavier Bellamy la décrit dans le primat actuel de l’économie, assimilé à un art de la destruction par la consommation de produits superflus et rapidement rendus obsolètes. Dans l’art, où la recherche de la beauté a fait place à l’impératif de l'originalité. Dans la politique, où le leitmotiv est surtout de "s’adapter" aux évolutions de la société plutôt que de s’interroger sur les fins recherchées (comme si le changement était inéluctable…). Mais aussi dans l’invasion grandissante de la technique, abolissant les contraintes nous résistant encore (le transhumanisme nous promet "la mort de la mort").
Les conséquences sur l’habitat et l’architecture moderne sont à cet égard emblématiques. La demeure, pensée pour le long terme, a fait place au logement, neuf et pratique mais sans âme et sans grâce. Le but du logement, substituable et interchangeable, est de ne pas nous retenir trop à l’écart des flux qui font désormais l’essentiel de l’existence.
Il faut avoir bien peu de considération envers ce qui demeure, pour souhaiter le changement permanent. Jules Romains disait, dans une définition suggestive, qu’être de droite « c’est avoir peur pour ce qui existe ». Comme solution, François-Xavier Bellamy nous propose non pas l’immobilité, mais bien de retrouver un point fixe, un but, permettant de redonner du sens au mouvement et donc à nos vies.
Chesterton remarquait très justement que « tel qu’on l’énonce aujourd’hui, le mot progrès est tout simplement un comparatif dont nous n’avons pas défini le superlatif. Nous opposons à tous les idéaux précis de religion, de patriotisme, de beauté ou de plaisir animal, l’idéal du progrès : c’est-à-dire que nous substituons à toute possibilité d’obtenir une chose que nous connaissons la possibilité d’obtenir bien davantage d’une chose dont personne ne sait rien. […] Personne n’a le droit d’employer le mot "progrès" s’il ne possède une foi bien définie et un code moral d’acier. Personne n’est susceptible de progrès sans avoir de doctrine […] C’est de la masse de ceux qui ne se sont jamais préoccupés du progrès que nous pouvons peut-être l’attendre. Les individus qui en parlent le plus seraient certainement dispersés aux quatre coins du ciel dès le premier coup de pistolet annonçant le départ. Je ne prétends pas dire par là que le mot "progrès" n’a pas de sens. Je dis seulement qu’il est vide de sens sans la définition préalable d’une doctrine morale. »