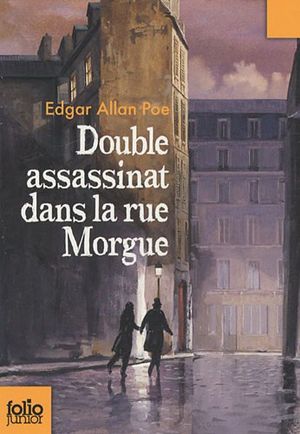Il est sans doute inutile de s'opposer à une légende aussi bien établie, mais il faut quand même le dire : Poe n'a pas donné naissance à un récit policier en rédigeant cette nouvelle, parue en 1841. Le fait que celle-ci ait fourni certains éléments aux premiers auteurs de romans policiers, vingt-cinq ans plus tard, n'y change rien. En effet, le centre de gravité du texte de Poe ne réside pas dans la découverte de faits, même si ces derniers tiennent une place importante dans le dispositif, mais dans une réflexion sur l'exercice des facultés de l'esprit devant un problème donné. A cet égard, il se plaît à comparer l'intelligence naturelle d'un particulier, très exigeant quant à la méthode, à l'intelligence en quelque sorte artificielle de l'administration policière. Ce n'est pas un hasard si l'auteur situe l'intrigue à Paris. En cette première moitié du XIXe siècle, c'est la ville d'Occident qui dispose de la plus grande organisation de police. Or, le récit tient à faire valoir l'idée que ces forces de police, malgré leurs moyens d'investigation, sont déroutées devant une affaire hors du commun, parce que leur attention ne se porte pas où il faudrait. Il convient de ne pas confondre complexité et profondeur, nous dit Poe et c'est précisément là l'erreur propre à la police en tant qu'organisation. Le simple particulier Dupin, quant à lui, ne se laisse pas enfermer dans des a priori, ni impressionner par le caractère exceptionnel des circonstances. En définitive, la police cherche des assassins, alors qu'il n'y en a pas, la mort des victimes n'ayant pas été causée par un être humain. "The murders in the rue morgue" est un conte philosophique. Le lire comme s'il s'agissait d'un récit policier ou, autre impasse, comme d'une nouvelle macabre est le meilleur moyen de passer à côté du propos de l'auteur. Ce qui serait dommage.