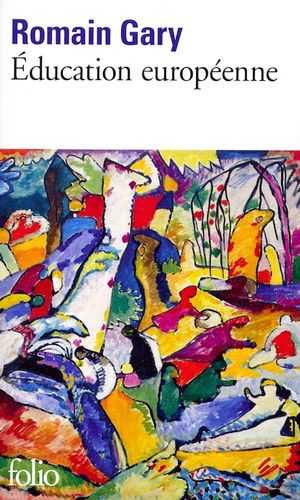Hiver 1942. Des partisans terrés dans une forêt polonaise attendent l’issue de la guerre qui se joue loin d’ici, incertaine, à Stalingrad. Voilà planté le décor de la résistance polonaise, jeune ou plus âgée. Pour tous la guerre est une (anti-)école. On y apprend, éprouvé par la violence, l’absurdité du monde. Et Janek, adolescent orphelin est loin d’y être un cancre. Comme les autres il apprend, finit par apprendre, à devenir un homme.
Une bonne part du génie de Gary est de donner à voir jusqu’où la souffrance peut gagner les hommes. Il peint les sinistres réalités de la guerre qui paraissent toujours trop lointaines, étrangères, à ceux qui les ignorent. Il crie qu’on peut souffrir à ce point, que le viol, le fait de se savoir trahi, la faim, le froid ne laissent vivants les hommes que pour mieux les abattre. Aucun personnage n’est épargné par cette souffrance qui ne souffre pas de limites : elle peut même faire vomir ! Souvent, elle fait pleurer et les larmes n’ajoutent certes rien à l’épreuve mais par elles on comprend jusqu’où l’homme est atteint.
Dans ce paysage de mort, quel espoir reste-t-il ? Tout au long du roman on le trouve personnifié dans le partisan Nadejda, dont la présence ne cesse pas d’échapper à l’occupant ennemi.
Mais Gary, en laissant poindre une possible fraternité pointe du même coup sa limite : au fond, peut-elle avoir une autre source que la haine partagée ? Ceux qui s’unissent sont-ils capables de le faire par amour ? Ou bien n’est-ce jamais que contre un ennemi commun ? Ainsi de la fraternité qui naît entre les hommes du seul fait qu’ils se sachent trompés par leurs femmes alors qu’ils sont au front. Voilà toute la complexité de l’homme que l’auteur exprime sans illusion. Ceux qui souffrent font souffrir, eux aussi, sans bien savoir pourquoi…
Ce qu’il reste à Janek, c’est Zosia, avec laquelle il apprend à aimer. C’est la musique qu’il découvre au milieu de la cacophonie de la guerre. C’est la puissance de l’art qui n’en reste pas moins un faible moyen, comme en témoigne la brève apparition d’un jeune prodige juif, qui à la question de savoir si Dieu existe répond en jouant du violon.
A la fin, donc, Janek découvre à l’école de la guerre la dure réalité humaine. Éducation faite de désillusions, il apprend ce que signifie vraiment que rien d’important ne meure. Non sans amertume, qu’alimente le triste constat d’une Europe riche de mille œuvres qui chantent la beauté (cathédrales, musique, écoles, universités, livres, …) mais qui se fait la guerre… Et voilà donc l’éducation européenne, qui en ce temps de barbarie consiste à apprendre à tuer, sans raison personnelle, mais pour de grandes idées.
Gary laisse son lecteur avec cette difficile question : Peut-on nourrir l’Espérance – qui est un autre nom de l’Amour – autrement qu’en passant par le feu de l’épreuve ? Il offre une ébauche de réponse par le seul fait d’écrire, c’est-à-dire de croire à un avenir possible, dont les illusions sont exclues, mais c’est finalement mieux ainsi. Janek peut dire plus densément son amour, à Zosia, à la musique, au monde qui s’ouvre après la guerre.