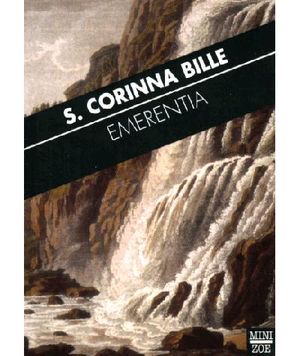« Emerentia 1713 », texte d’une centaine de pages en vingt-trois chapitres initialement publié en 1979 dans le recueil Deux passions, relate la courte vie – je n’en dirai pas plus – d’une fillette, nommée Emerentia, dans le Valais du début du XVIIe siècle. Jusque là, on l’aura compris, rien d’étonnant par rapport au titre…
La nouvelle, semble-t-il inspirée d’une histoire vraie, lorgne du côté du conte : il y est question d’une enfant de sept ans, donc, mais aussi d’un père aimant, d’une marâtre jalouse, de deux beaux cavaliers, de complicité avec les bêtes et de claustration. Résumé encore autrement : après le traumatisme de la mort de sa mère, la petite fille d’un seigneur suisse est exilée par la nouvelle femme de celui-ci, et se retrouve aux mains d’un curé et d’une gouvernante bien décidés à dresser celle qui « refuse toute religion ! » (chapitre XIII, p. 61 de la réédition « Zoé poche »).
Tout y passera, naturellement, dans la série de ce qui, pour un rigorisme tel que le catholicisme valaisien des années 1710, tient lieu de méthodes d’éducation : le conditionnement par la bigoterie, la maltraitance physique, la culpabilisation, le délaissement… La sinistre gouvernante envisagera l’exorcisme. Tout cela est suisse, mais on retrouve la même charge contre l’Église que dans certains récits belges de la première moitié du XXe siècle. (Voir aussi le Baudelaire de la Belgique déshabillée : « Emerentia retrouve à la cure cette odeur d’encens qu’elle ne supporte pas, ce triste relent des dalles récurées au savon noir et des corps mal lavés », chap. XX, p. 105). L’enfant, naturellement innocente et belle, rêve beaucoup mais ne parle presque pas. Elle aime les animaux y compris les poux, les autres enfants, les robes, a peur du feu et craint l’odeur de l’encens. On la soupçonne de sorcellerie.
Et c’est très beau.
Il faut – désolé pour le cliché ! – lire lentement pour que naissent la musicalité des mots, le rythme de chaque phrase, les silences qui ponctuent les chapitres. Ce n’est pas un orchestre qui joue dans « Emerentia 1713 », mais un petit instrument bucolique au son doucement aigrelet. Les jours qui suivent l’enterrement de la mère de l’héroïne, « Les cierges brûlent jour et nuit, ne la réchauffent pas » (p. 13) : tout est dit. C’est d’ailleurs quand le texte insiste en se répétant (par exemple quelques lignes plus loin : « Ici est le Manque, le lieu de toutes les épouvantes ») qu’il s’affaiblit ; mais ces redondances disparaissent petit à petit. Et en quelques mots toute la campagne prend vie.
Vers le milieu de la nouvelle, un peintre vient, sur ordre des parents d’Emerentia, faire son portrait. Il s’agit évidemment d’une vanité : on donne à l’enfant, vêtue de sa plus belle robe, une fleur à tenir dans une main et dans l’autre un crâne. Un crâne d’enfant, qui, plus léger, la fatiguera moins.
Un conte, je vous disais. « Rien de plus » (dernière phrase du récit, p. 123).