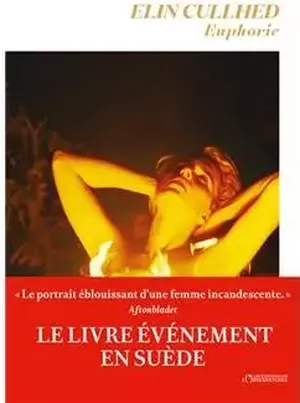Chronique vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=Ls8yJ0gXP3k
Sylvia Plath est une des plus grandes autrices du 20ème siècle. Née aux Etats Unis en 1932, elle est connue pour ses recueils de poésie, et surtout son roman The Bell Jar, roman aux accents autobiographiques, qui détaille la catabase de son héroïne, une véritable plongée dans la folie et une entrée mortifère dans l’âge adulte. En 1956, elle rencontre le poète anglais Ted Hugues et le suit en Angleterre, lui donne deux enfants, l’aide à recopier ses textes, jusqu’à ce que la maladie, les difficultés financières et les tromperies les séparent. Après la naissance de son fils, Ted Hugues quitte Sylvia pour Assia Wevill, et le couple donne naissance à une petite fille. De désespoir, Sylvia se suicide, en mettant la tête dans son four alors que leurs enfants dorment, ces derniers seront sauvés. Quelques années plus tard, Assia se suicide à son tour, de la même manière, sauf que là, leur fille n’y survivra pas. Ted Hugues sera accusé de la mort des deux femmes, de nombreux débats dans le milieu littéraire essayant de démêler le vrai du faux. Quoiqu’il en soit, le roman Euphorie de la suédoise Elin Culhed tente de retracer les dernières années du couple, et c’est donc vous l’avez compris, le livre dont on va parler aujourd’hui.
De quoi ça parle ?
Sylvia vit en Angleterre avec son mari Ted et leur fille Frieda, la maternité lui pèse, d’autant qu’elle attend un nouvel enfant. Le couple se dispute souvent, affaibli par la labilité de Sylvia et la froideur de Ted, les ambitions poétiques de chacun entrant aussi en contradiction avec le peu de temps imparti qu’offre une vie de jeunes parents. Ils sont donc ballotés entre les crises et les rapprochements, jusqu’à l’apparition d’Assia, la locataire de leur appartement à Londres.
Comme des lecteurs ont souligné que le texte pouvait trahir la personnalité de Sylvia Plath, je vais essayer de ne pas dire Sylvia, mais l’héroïne pour ne pas qu’on confonde la vraie poétesse du personnage.
Euphorie (du grec εὐφορία ; de εὖ : « bien », et φέρω, pherō : « à supporter » ; sémantiquement opposé à la dysphorie)
Il me parait important de parler du titre, pour commencer. En effet, Euphorie n’est pas la joie, ou le bonheur. S’il désigne normalement un état d’allégresse, il a aussi un sens psychiatrique. D’après Wikipédia : l'euphorie est un état d'esprit s'expliquant par le sentiment intense d'éprouver du bonheur, évalué objectivement comme étant une humeur parfois anormalement élevée et purement impulsive. Cet état est opposé à la dysphorie, et se retrouve notamment dans les troubles bipolaires, les phases maniaques (où l’on retrouve entre autres l’euphorie) alternant avec les phases dépressives. Et Sylvia Plath souffrait de cette maladie, c’est donc selon moi la raison de ce titre, bien que le roman éclaire aussi les pensées plus sombres de son héroïne.
Le roman met bien en scène l’exaltation du personnage, mais aussi une poétique de la déréalisation, de la dépossession de soi « S’emparant de ma paume transpirante, il l’a pétrie pendant que je m’éloignais du temps et de mon corps en essayant de me maintenir au centre précis de l’univers ». On voit ici qu’il y a un parallèle entre ses troubles et sa vie de couple, comment le pétrissage de la scène pourrait être assimilé au travail d’un pygmalion qui en voulant modeler sa créature la désapproprie de son identité. Mais ce n’est pas manichéen non plus, car Sylvia se dépossède surtout elle-même, en jouant un rôle, et c’est là où son exaltation met mal à l’aise. Par exemple, avec sa mère, elle joue de manière trop zélée, et l’exaltation devient possession « Voilà, très bien. Là, c’était parfait : spectacle, représentation. » La vie se transforme en mise en scène et c’est là que le texte est touchant, car tout le monde peut ressentir ça à un moment donné, quand il a des invités, quand il est à l’extérieur, le fait de se tenir, de montrer le masque social, un visage différent du moi profond, un sourire trop forcé, trop euphorique au bout des lèvres. Le problème avec l’héroïne, c’est que le visage dépouillé du réel lui fait peur, qu’elle préfère donner le change. C’est sans doute le principal problème entre elle et Ted « notre royaume provisoire, il voyait tout, et il comprenait que tout cela ne reposait que sur de l’air ». L’amour, la vie à deux est pour eux un éternel malentendu, une tension entre le dévoilement des incomplétudes, des failles, et l’envie de rester ce que l’autre a cru voir, ce qu’on a voulu représenter. Une guerre sans merci qui n’est pas tant entre l’homme et la femme qu’entre le moi social et le vrai moi.
Oppression et perpétuation
Préférer le carcan des apparences au réel est l’héritage légué par sa mère « Ma mère, qui ne se lassait jamais de me bourrer de tourments, d’idéaux, de compétences ménagères et de tous les petits secrets qu’il fallait connaitre si l’on voulait réussir à être une femme dans ce monde ». C’est souvent par les mères que passe cet apprentissage. Et on peut se demander pourquoi. Bourdieu, dans La domination masculine tente d’y apporter des réponses. Selon lui, il ne s’agit pas de « consentement » mais « d’adhésion extorquée ». Mués par un processus inconscient, les dominés peuvent collaborer à leur oppression. Oppression à multiples facettes, comme l’absence de solidarité, la rivalité, ou l’animosité. L’héroïne voyant en toutes les femmes qui approchent son foyer une ennemie potentielle. « Jeune blonde idiote. Je savais que j’aurais dû avoir de la sympathie pour elle, si jeune, bouffie de désir, intacte, mais bordel, elle se prenait pour qui […] »
Evidemment, il y a une portée féministe au texte, Sylvia Plath ayant été après sa mort le symbole des femmes broyées par le patriarcat : déjà dans l’ambivalence de la maternité « J’ai peint un cœur rouge sur mes grosses lèvres enflées de grossesse, on aurait dit un cœur écrasé sous la semelle de quelqu’un » (d’ailleurs, on observe qu’elle évoque souvent ses lèvres, ou qu’elle se compare à une bouche, ce qui n’est pas anodin, puisque la bouche, c’est la parole, c’est l’extériorité, et qu’elle est coincée en elle-même, dans son intériorité, dans ses pensées). Le début est une liste de « 7 raisons de ne pas mourir », qui parait être écrite dans l’urgence et dont il manque certains articles, ce qui ne retire pas la poésie et la simplicité des images, puis le côté tragique aussi, puisqu’on sait tous la fin de Sylvia Plath. En quelque sorte, on rentre dans le vif du sujet dès le départ. Plus loin dans le livre, les listes ont une fonction de réassurance, de se rappeler quoi faire pour bien correspondre à l’image de la ménagère parfaite, comme si elle allait oublier les règles, qu’il s’agit du recette ardue, ce qui va dans le sens de lois non-naturelles.
Solitude
Le couple est un catalyseur de son mal-être. L’incompréhension avec Ted est quasi systématique, par exemple dans cette scène qui pourrait être l’acmé de leur relation, scène où il l’amène voir la mer, mais que la peur, les sanglots irrépressibles l’empêchent de sortir, la maladie étant la première séparatrice du couple « Ted ne comprendrait pas mes excuses, il ne comprendrait jamais ce que c’était que d’être entravée, car il était libre, il avait toute liberté de porter ses jambes simples hors de la voiture et de descendre par les rochers jusqu’à cette espèce de mer grise primitive ». On voit l’opposition entre la liberté de Ted, et l’entrave qu’elle ressent par rapport à son propre corps, à son propre esprit. Il y a presque plus d’éléments perturbateurs internes qu’externes. Les premiers démaillages étant causés par leur incommunicabilité avant que n’intervienne Assia.
La solitude n’est pas reléguée au couple, puisque persiste une inadéquation entre ce que les gens disent et ce qu’elle comprend. Et au début on oscille nous-même, estimant qu’elle comprend peut-être très finement le genre humain, mais que c’est peut-être aussi une surinterprétation névrosée (et le livre oscille aussi, car ses pressentiments se révèlent souvent assez justes, bien qu’on se demande si ce n’est pas elle-même qui crée cela, qui crée l’éloignement de Ted à force de lui reprocher son éloignement).Par exemple, avec sa mère :
« — Tu peux nous faire confiance, Maman. Nous avons trouvé notre endroit sur terre.
— C’est bien Sivvy. Je ne peux que te faire confiance.
La froideur hautaine, sa volonté de tout contrôler, sa manière de me voler ma propre joie. »
On voit que la phrase « Je ne peux que te faire confiance » peut avoir deux sens, soit « je n’ai pas d’autre choix que de te faire confiance », sens auquel se raccroche l’héroïne, soit « de toute manière je te fais confiance », sens qui nous parait être le bon, puisque le début de la réponse de la mère va dans ce sens. Le problème, c’est que la mère par la suite communique par sous-entendu et par allusion, et que donc, c’est sans cesse un jeu sur le langage, sur le sous-texte qu’elle décrypte parfois, et parfois pas, comme nous en fait quand on nous parle et qu’on est aussi dans le déchiffrage.
Le style, qui passe parfois par le flux de conscience, m’a évoqué dans ces bons moments Mrs Dalloway de Virginia Woolf. Sinon, dans le souci de décrire la mort à petit feu que représente les injonctions des apparences, j’ai aussi souvent pensé au cinéma de Sam Mendes, Les Noces rebelles et American Beauty principalement. On pense au jardin, par exemple, dans ce dernier film, une des premières remarques concernant la femme de Lester Burnham, c’est qu’elle prend beaucoup de soin à assortir son sécateur à ses gants de jardinage, quelque chose comme ça — que le jardin est donc un symbole de la femme domestiquée, du visage qu’elle veut bien offrir au monde. De notre côté, l’héroïne voit dans son jardin une des rares constituantes de sa personnalité telle qu’elle était avant qu’elle devienne femme et mère, un jardin secret si je puis dire en danger « Il y avait tant d’érotisme, tant de beauté dans notre jardin, et tout ce que voyait ma mère, c’était une mauvaise herbe ». Et la conclusion du livre va dans le même sens que le film « « je croyais encore ce que je disais, que j’étais garante de ma propre réalité. Que ce que je montrais était ce qu’ils voyaient. Mais ce n’était pas le cas. J’étais déjà morte. » En résumé, les apparences tuent.
Cependant, j’ai trouvé que l’œuvre, assez vite, commençait à tourner en rond, que le ressassement de l’héroïne, les images qui s’accumulent finissaient par donner quelque chose d’abstrait, presque d’apprêté au texte.
Conclusion
Pour revenir sur la mise en garde du début par rapport à la trahison ou non de la vraie Sylvia Plath, mon avis est qu’on s’en fout un peu. Ce que je veux dire, c’est qu’à partir du moment où l’autrice assume qu’il s’agit principalement de fiction, ce qu’elle fait avec l’exergue en disant qu’il s’agit d’un roman et non pas d’une biographie, ben on devrait pas lui reprocher, quel que soit le respect ou l’admiration qu’on éprouve pour la personnalité traitée. Ça me fait penser au débat sur les adaptations au cinéma de roman, où il y a toujours cette notion de trahison en toile de fond. L’art, c’est la trahison, qu’on dise vrai, qu’on invente, traduire le réel tel qu’il est passe forcément par le prisme de la subjectivité, le réel d’Elin Culhed et le réel de la personne qui lit le livre et qui connait sur le bout des doigts la vie de Sylvia Plath ne s’emboiteront jamais totalement. Est-ce que le livre remplit sa fonction, si on peut parler de fonction en littérature ? Oui, moi je trouve que oui, il m’a donné envie de lire the Bell jar, il m’a donné envie de me renseigner sur la vie de Sylvia Plath et de Ted Hugues, que je trouve fascinante, tout en étant, un œuvre littéraire totalement indépendante de ces questions.