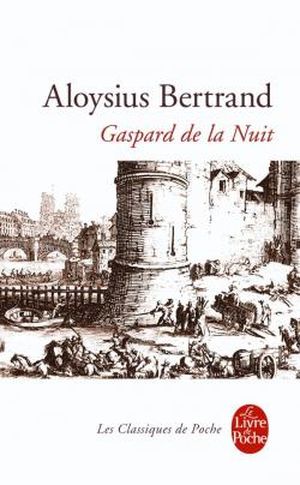Il me semble que la dette de Bertrand à l’égard de Baudelaire a son envers. D’un côté, si celui-là conserve un lectorat un peu plus étendu – si, si ! – que celui des historiens de la littérature, c’est grâce à celui-ci ; d’un autre, Gaspard de la Nuit ne peut que souffrir de la comparaison avec le Spleen de Paris.
Vingt-sept ans séparent les deux recueils posthumes, qui montrent aussi les limites de la théorie selon laquelle en histoire littéraire, une année de l’époque passerait plus lentement qu’une année actuelle : esthétiquement, c’est un gouffre qui les sépare.
Quand on voudra – mais c’est sans doute déjà fait – étudier en détails l’influence de Walter Scott sur la littérature française du XIXe siècle, quand on voudra proposer une étude sur la typographie significative dans la littérature, on trouvera tout ce qu’il faut dans Gaspard de la nuit : Aloysius – rien que ce pseudonyme ! – Bertrand, c’est le genre d’écrivains à coller un surcot, un ménétrier, un haubert et deux ribaudes dans les trois premières lignes et pour la couleur locale d’un texte dont l’histoire se passe au Moyen Âge… C’est aussi celui qui tient aux caractères gothiques pour les textes qui signalent le début et la fin de chaque « Livre » de son recueil, et qui veut des enluminures (1). Dans les années 1840.
Car Aloysius est ambitieux, soignant notamment l’organisation de son Gaspard. Il s’agirait « d’une très subtile arithmétique dont les composantes, à vrai dire, nous échappent » (p. 27), écrit pudiquement l’éditeur du volume dans la collection « Classiques de poche » (2). On peut aussi prendre moins de gants, et trouver que la surcharge de la structure (six « livres » numérotés qui sont censés avoir été recopiés d’un manuscrit, des poèmes eux-mêmes numérotés, avec pour chacun un épigraphe) et de la ponctuation (celle des dialogues notamment) nuit à des textes réussis.
Comme Gaspard de la Nuit est posthume, l’éditeur original s’est permis d’y ajouter des « Pièces détachées extraites du portefeuille de l’auteur ». Idée judicieuse, d’une part parce que que ces pièces sont loin d’être moins bonnes que celles retenues par Bertrand, d’autre part parce que débarrassées de leur gangue paratextuelle, il y a quelques pépites qui y gagnent en agrément sans y perdre en… en quoi, d’ailleurs ? Je ne vois toujours pas ce qu’apporte à son volume la surcharge à laquelle Aloysius paraissait tant tenir.
En tâchant de faire abstraction de tout cela, on peut quand même à un moment parler des textes. Entre rencontre avec le Diable et Moyen Âge reconstitué, ce n’est pas peu dire que Gaspard de la Nuit baigne dans le romantisme : « “Mon âme, haquenée boiteuse des fatigues du jour, repose maintenant sur la litière dorée des songes.” » (« Le Nain »). On peut y ajouter le goût du paysage (un peu partout) et ce fameux mal du siècle qui s’apparente quelquefois à un peu plus qu’à du vague à l’âme : « je naquis aiglon avorté ! / […] Ah ! l’homme, dis-le moi, si tu le sais, l’homme, frêle jouet, gambadant suspendu au fil des passions, ne serait-il qu’un pantin qu’use la vie et que brise la mort ? » (« À M. David, statuaire »).
Il y a dans cette œuvre des poèmes (« Départ pour le sabbat », par exemple) ou des passages tout à fait réussis, en particulier quand Bertrand joue sur la musicalité de la phrase et des mots : « Et le soir, quand la nef harmonieuse de la cathédrale s’endormit, couchée les bras en croix, il aperçut, de l’échelle, à l’horizon, un village incendié par des gens de guerre, qui flamboyait comme une comète dans l’azur » (« Le maçon »).
On trouve aussi, çà et là, des images marquantes : « Déjà la lune elle-même, clignant un œil, ne luit plus de l’autre que pour éclairer comme une chandelle flottante ce chien, maigre vagabond, qui lappe l’eau d’un étang. » (« Le Cheval mort »).
Mais tout de même, par rapport à Baudelaire… Celui-ci savait, lui, maîtriser un poème en prose. Et quand il parlait du Diable, ce n’était pas juste un nom.
(1) Un peu dans le même ordre d’idées, il voulait « qu’une fois tirés les cinq cents premiers exemplaires, les trois cents suivants portent un autre titre : la Kermesse fantastique » (p. 15)… J’en ai lu, des choses bizarres – j’ai deux volumes de Forneret en cours… –, mais là, je dois avouer que je ne comprends pas.
(2) Éditeur parfois un peu envahissant, et à qui il arrive de se tromper quand il est question de topographie, mais qui aime manifestement son sujet.