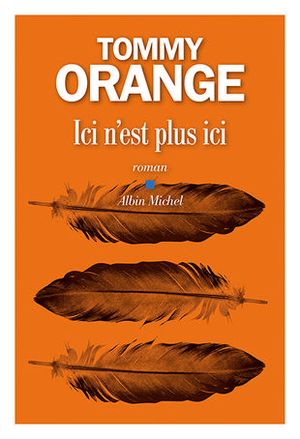Ici n’est plus ici de Tommy Orange démarre avec tout un tas de promesses. Tout d’abord, la promesse d’un titre à élucider, un titre laconique et profond, qui nous suit tout au long du roman. Puis des images, installées dès le mystérieux prologue : la tête d’indien, les massacres, l’acculturation, le gros Indien de Vol au-dessus d’un nid de coucou. Toutes ces évocations font appel à un imaginaire que nous chérissons, à ces films, à ces bd que nous avons lus enfant et où les Indiens tiennent souvent le rôle de figurants silencieux.
Ensuite, Tommy Orange nous promet encore. Il promet de mettre en sourdine ces vieux clichés éculés car lui, ce dont il veut parler c’est des Indiens d’aujourd’hui, les Indiens des villes. « Nous sommes désormais plus habitués à la silhouette des gratte-ciel d’Oakland qu’à n’importe quelle chaîne de montagnes sacrées ». Super, mais ça ressemble à quoi au juste, un Indien des villes ? Cette histoire, on ne nous l’a pas racontée. Comment sommes-nous passés des grandes plaines et des montagnes arides aux quartiers résidentiels ? Comment sommes-nous passés du XIX° siècle au XXI° ? Quid des traditions ? Quid des pow-wows ? C’est quoi un indien métisse ? Dans le prologue, Tommy Orange crée un horizon d’attente avec clarté et brio.
Et c’est aussi avec brio que démarre le récit choral où il nous offre une galerie de portraits d’Indiens des villes. A chaque chapitre son protagoniste à la première personne. Ce sont des hommes et des femmes brisés, des fantômes errants, jamais à leur place dans leurs villes, dans leurs familles, dans leur peau. Les petits chapitres défilent sans se croiser dans la première partie, tout comme leurs protagonistes isolés, en quête d’identité et de liens. On pense à la Californie des jeux-vidéo de Rockstar avec ses quartiers craignos et ses petits escrocs minables. On se rappelle l’époque des droits civiques avec le récit de la petite indienne traînée malgré elle par sa mère sur l’île d’Alcatraz où une utopie indienne prend racine (ou pas). C’est une lecture stimulante qui fait appel à d'autres références inopinées. Quant au style de l’auteur, il est fluide et contemporain, loin de la voix solennel du prologue. En parlant à la première personne, Tommy Orange enfile les masques de la petite fille innocente ou du vieil homme désabusé. Et c’est convaincant.
Encore des promesses lorsque point l’espoir d’une rencontre, un grand pow-wow où se réuniront cheyennes et arapahos. A un certain moment, c’est l’évocation d’un personnage d’un autre chapitre qui nous fait espérer la rencontre.
Hélas, cet horizon d’attente n’est, à mon avis, pas comblé. Les liens tissés petit à petit entre les personnages isolés dans les chapitres, les promesses de rencontre, sont avortés à cause d’un événement tragique. Il n’y a pas de confrontation, à peine quelques retrouvailles. Certes, je comprends le message pessimiste et fataliste de l’auteur : les Indiens des villes sont condamnés à vivre seuls et déracinés. Mais lorsqu’on fait naître autant d’attente, on ne peut pas se défiler à la fin avec une pirouette dramatique sans créer frustration et colère. On gardera le souvenir puissant du prologue et des premiers chapitres.