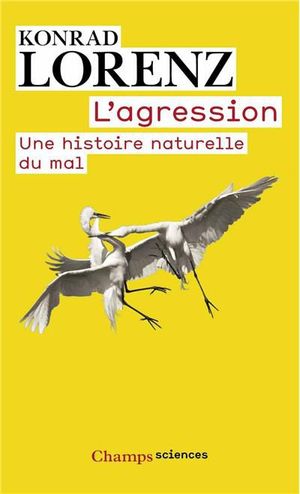Comment résumer en peu de mots un livre aussi dense et aussi complexe, qui aborde autant de thématiques aussi passionnantes qu'essentielles ? Peut-être faudrait-il commencer par cette phrase, arrivant pourtant dans le dernier quart du livre :
On reproche aujourd'hui souvent aux scientifiques d'avoir appelé de terribles dangers sur l'humanité en la dotant d'un trop grand pouvoir sur la nature. Ce reproche ne serait justifié que si l'on pourrait charger en même temps le scientifique du péché d'omission de n'avoir pas fait de l'homme aussi un objet de sa recherche. Car le danger que courent actuellement les humains provient, plus que de leur capacité à dominer les processus physiques, de leur incapacité à contrôler rationnellement les phénomènes sociaux.
Très certainement, le contexte de la guerre froide et la crainte d'une guerre atomique est pour beaucoup dans ce ton alarmiste. La remarque de Konrad Lorenz et, plus encore, l'étude qu'il présente ici demeurent pourtant d'une grande actualité.
Personnage haut en couleurs, Konrad Lorenz est principalement connu pour être l'un des grands pionniers de l'éthologie, la science qui étudie le comportement des animaux. L'agression est le fruit d'une vie de recherches, à partir desquelles — et là réside tout l'intérêt du livre — est bâtie une réflexion générale sur l'être humain.
L'idée géniale de Lorenz, c'est d'avoir voulu ouvrir une étude comparée du comportement humain et animal. À son époque, la théorie dominante expliquait le comportement comme un ensemble de réactions à l'environnement ; suivant cette thèse, l'on a imaginé qu'il était possible de faire disparaître l'agressivité chez un individu en le mettant à l'abri des stimuli susceptibles de la provoquer. En particulier, on pensait qu'un enfant ne développerait aucun caractère violent s'il ne recevait aucune contrariété durant son éducation. Les horribles enfants-roi ainsi élevés, tous devenus bien malheureux à l'âge adulte (et souvent de façon dramatique), ont suffi à démentir définitivement cette thèse — bien qu'elle semble demeurer très vivace dans les esprits aujourd'hui.
Lorenz avait donc formulé une autre thèse (en fait, très proche de celle de Nietzsche) : selon lui, le comportement, et en particulier l'agressivité, était motivé par des pulsions, lesquelles pouvant se manifester même en-dehors de tout contexte favorable. Certain type de poisson, par exemple, finira inévitablement par décharger son agressivité sur son épouse — jusqu'à la tuer — si on lui coupe toute possibilité de s'en prendre à un autre de ses congénères. Pourtant, comme le remarque Lorenz, si l'agressivité n'intervient que contre des membres de sa propre espèce, elle se ne manifeste presque jamais contre un individu du sexe opposé, moins encore contre un individu avec lequel l'animal est lié d'une façon ou d'une autre.
Le lien, constate Lorenz, est intimement lié à l'agressivité. Voilà un étrange paradoxe : plus une espèce est sociable, plus son agressivité contre ses congénères est grande.
L'explication que donne Lorenz est en fait simple. Lorsqu'un animal est peu pourvu d'armes offensives, les dégâts qu'il occasionne avant que sa victime ne parvienne à s'enfuir sont suffisamment minimes pour que l'agressivité ne mette pas en danger la survie de l'espèce. Or, celle-ci l'est beaucoup plus lorsqu'un animal est capable de tuer son congénère d'un seul coup de crocs ou de griffes, comme c'est le cas du loup, par exemple. En conséquence, pour parer à cette éventualité fâcheuse, l'évolution a inventé le lien.
Le lien se manifeste avant tout par ce que Lorenz appelle des rites. Ensemble de gestes plus ou moins instinctifs, plus ou moins innés, le rite permet de nouer une amitié ou une relation conjugale, puis, par sa répétition, de réaffirmer régulièrement l'amitié ou l'amour qui unit plusieurs individus. Or, Lorenz constate le rite être, dans sa structure-même, une manifestation ré-orientée d'agressivité ; la dimension agressive, cependant, apparaît plus ou moins selon le stade évolutif où se situe le rite de l'espèce concernée. Par exemple, le rite d'apaisement chez un couple de canards consiste, grosso-modo, pour la canne, à envoyer son mari se battre contre un canard voisin qu'elle a elle-même provoqué en s'en prenant à sa propre canne ; chez l'oie, le rite est toujours initié par l'épouse, mais l'attaque du jars peut être dirigée contre un ennemi fictif ou un objet.
Le lien, en somme, se construit contre un monde extérieur perçu comme hostile et menaçant. En psychologie, d'ailleurs, l'on parvient à des conclusions tout à fait similaires.
Mais quant à l'homme, créature hyper-sociable s'il en est, il s'est pourvu d'armes offensives d'une incroyable efficacité. Sans inhibition de l'agressivité, une technologie comme la hache en pierre, estime Lorenz, pourrait suffire à anéantir l'espèce entière, aussi primitive soit-elle. En conséquence, l'homme s'est doté de rites puissants, de plus en plus nombreux, sophistiqués et raffinés ; finalement, les hommes ont bâti des cultures qu'ils se sont transmis de génération en génération.
Les rites, ainsi qu'un certain nombre d'autres inhibitions innées (qui empêchent, généralement, un animal de s'en prendre aux femelles ou aux petits), fondent ainsi l'architecture de la morale, de l'éthique, des hiérarchies ou des normes des sociétés, ce de façon à limiter les effets destructeurs de l'agression intraspécifique.
En conséquence, Lorenz donne la culture, fondée sur les rites, comme ciment fondamental des sociétés et nécessaire à leur cohésion.
J'ai souligné aussi que tout ce que l'homme vénère et révère par tradition ne représente pas une valeur éthique absolue, mais n'est sacré que par rapport au cadre de référence de telle culture. Mais tout cela ne doit en aucune façon enlever de sa valeur à la ténacité inébranlable avec laquelle un homme bon tient aux coutumes qui lui sont transmises par la culture. Il peut sembler que sa fidélité mérite une cause meilleure, mais il n'y a pas beaucoup de causes meilleures ! Si les normes sociales et les coutumes ne développeraient pas leur vie et leur pouvoir autonomes particuliers, si elles n'étaient pas haussées à la valeur de fins sacrées en soi, il n'y aurait pas de vie commune basée sur la confiance, pas de foi, pas de loi.
Lorenz met ainsi en garde ses contemporains contre la dislocation des structures sociales provoquées par la mondialisation (il pense, en outre, qu'il est dangereux de trop mélanger les cultures).
Il est intéressant, pour faire une petite digression, de remarquer que cette importance des rites dans la cohésion sociale était déjà vivement soulignée et défendue par les anciens chinois, grecs ou romains ; ceux-ci, notamment, reprochaient aux épicuriens ou aux chrétiens leur dédain pour l'activité politique ou la participation aux cultes de la cité...
Il n'empêche : les constatations de Lorenz sont pour le moins embarrassantes. Le voici qui condamne pour l'éternité l'homme à l'ethnocentrisme, à la xénophobie, et, enfin, à la guerre !
Mais, fort heureusement, chez les animaux (par exemple, le daim) comme chez les hommes, les rivalités inhérentes à la vie sociale peuvent être maintenues dans des cadres limitatifs, empêchant qu'elles n'occasionnent des dommages trop sévères. Lorenz cite brièvement le cas de l'éthique militaire (chevaleresque, en particulier), ce en quoi il se rapproche beaucoup des réflexions de Carl Schmitt sur le droit international après la paix de Westphalie. Pareil que lui, il en vient à la conclusion que l'agressivité atteint son paroxysme destructeur lorsque l'ennemi devient un ennemi absolu, une incarnation du Mal ; sans en dire le nom, il cible les mêmes idéologies que Schmitt.
L'on discerne bien là les limites de la morale, qui, au lieu d'apaiser l'agressivité, peut au contraire la pousser dans ses retranchements les plus barbares lorsqu'on lui donne une valeur absolue.
Ce que recommande donc très justement Lorenz, in fine, c'est de développer la curiosité pour les autres cultures, de limiter l'ethnocentrisme dont nous sommes pourtant tous victimes, à notre insu.
Sans doute sincèrement pacifiste — ayant peut-être encore trop en tête sa brutale expérience des traumatisés de l'hôpital militaire où il travaillait en 1943-1944 en Pologne —, Lorenz essaye, dans un dernier chapitre peu convainquant, d'avancer des solutions pour éviter les guerres de demain. Ce chapitre entre suffisamment en contradiction avec nombre de ses conclusions précédentes pour qu'on puisse le soupçonner avoir été écrit pour se prémunir des anathèmes de ses ennemis, qui auraient alors été inévitables, comme on s'en doute.
En somme, si dans ce livre Konrad Lorenz construit une réflexion passionnante — et ô combien nécessaire — sur la nature du lien social et de l'agressivité, il échoue à clore d'une façon satisfaisante la question épineuse de la guerre, qui ne concerne, cela dit, simplement pas son domaine d'étude.
Ce livre, pourtant, est riche par la diversité de ses approches, par la volonté, surtout, de Lorenz de mettre en relation biologie, histoire et philosophie — entreprise pour le moins nécessaire, à l'époque de grande fragmentation du savoir qu'est la nôtre. Il m'a été impossible d'évoquer tout ce qu'aborde le livre. Simplement, je dirais que c'est une lecture passionnante, avançant de nombreuses réflexions sur la science, la théorie de l'évolution, la philosophie, les animaux et les hommes... et, bien sûr, développant de nombreux cas drôles et fascinants sur le comportement des animaux, en particulier des oies !