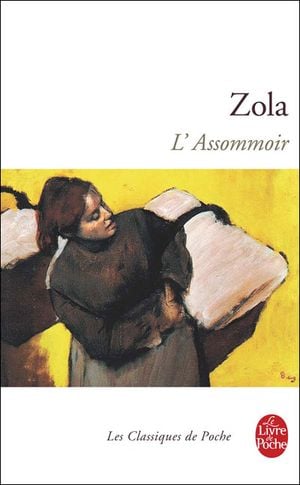Considérant que l'absence de Zola dans ma culture générale était tout à fait préjudiciable, j'envisageais donc la lecture de La joie de vivre (conseillé par une professeur au collège), pour finalement entreprendre l'intégralité des œuvres zoliennes, à commencer par les Rougon-Macquart, de façon méthodique, dans l'ordre donc. Mais j'ai eu peur, oui peur de cet assommoir dont je craignais le pire, ayant été échaudée par l'interminable faute de l'abbé Mouret. Je me voyais supporter des pages et des pages de descriptions à n'en plus finir sur l'alcoolisme, la couleur ambrée des spiritueux ou la misère des protagonistes. Pourtant, d'autres romans annoncés comme particulièrement attrayants m'attendaient après, m'obligeant à attaquer ma lecture.
Quelle ne fut pas ma surprise, ma joie, de constater que ce livre est un quasi chef-d'oeuvre. Aux premières pages parfaitement classiques mais néanmoins intéressantes, se succèdent tout d'un coup des pages écrites dans un style indirect ponctuées d'expressions imagées de l'époque (qu'un habile choix d'édition m'a permis de comprendre sans difficulté), de descriptions (mais pas « à la Zola », point de rayon de blanc ici) des mœurs de l'époque, des petits métiers, d'une vie oubliée. Le mariage et la scène du lavoir au début sont des merveilles.
Je me méfiais tout de même un peu, l'expérience des précédents ouvrages (à l'exception notable de Son excellence Eugène Rougon) me laissant supposer que le 2e tiers du livre risquait de contrarier légèrement mon enthousiasme. Tant s'en faut, Zola ne s'arrête pas, la vie de Gervaise défile, du malheur au bonheur.
Et disons le, Zola est un salaud avec la plupart de ses personnages (pas très compatissant en tout cas). Il n'a aucune pitié pour cette femme qu'un atavisme certain fait chuter. Elle tombe parce qu'elle est Gervaise, la société ne l'aide pas ni dans un sens ni dans l'autre. Et c'est ce qui m'a le plus surprise. Je pensais, car il est souvent présenté comme tel, que Zola allait « défendre » les ouvriers, nous dire finalement qu'ils ne peuvent pas s'en sortir parce que certes, il y a leur hérédité, mais il y a aussi leur milieu, une conjonction d'événements qui font que l'ouvrier demeure dans la misère. Et bien non. Gervaise échoue et elle est la cause de sa propre déchéance : elle réussit mais elle est rattrapée par une volonté de jouir de ce qu'elle a gagné et non par l'épargne (ce qui aurait été à en croire cette lecture la seule solution). Finalement, c'est jusqu'au bout leur déterminisme biologique qui les fait chuter. Coupeau, justement, honnête travailleur au début, tombe d'un toit et devient comme son père avant lui, un alcoolique qui boit littéralement l'argent du ménage. C'est donc un roman assez paradoxal où d'un côté Zola décrit la misère et la condition du monde ouvrier mais n'en propose qu'une vision très bourgeoise finalement. L'ouvrier, par son intempérance, échoue à devenir un « bourgeois ». Seule la figure du père Bru semble digne de compassion à l'en lire (figure assez effroyable que cet ancien ouvrier perclus de rhumatismes qui ne peut plus travailler et qui a perdu ses trois fils à la guerre). Cela n'empêche pas pour autant Zola de critiquer une certaine bourgeoisie, à l'exemple du propriétaire de l'immeuble où vivent les Coupeau... Ceux qui comme moi ont/avaient une image du Zola défenseur du peuple (peut-être qu'il faut attendre Germinal ?) risquent donc d'être surpris de ce côté-ci.
Toujours est-il, et peu importe finalement la vision de Zola, que ce roman est à lire parce qu'il est bon. Et non parce que le gentilhomme cultivé se devrait d'avoir un fond commun de culture générale avec le reste du monde. Non. Juste parce que c'est un bon livre.