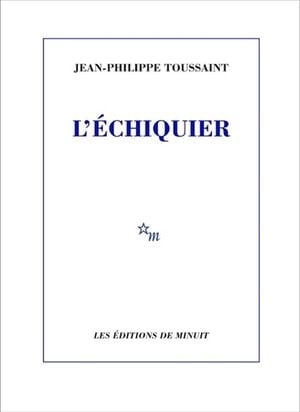Pour bien des gens, le confinement fut une expérience marquante. Nombreux sont ceux qui changèrent de profession, décidèrent de déménager, remirent en cause leur mode de vie ou de consommation. Pour ma part, ce fut comme pour Jean-Philippe Toussaint : le confinement me tourna bien plus vers le passé que vers l’avenir. Je décidai d'entamer la rédaction de mes mémoires, bien que beaucoup trop jeune pour ce genre de choses. A usage interne bien sûr. Comme Toussaint est écrivain, il fait de ses mémoires de la littérature, et les publie. Sa vieille passion pour les échecs est l'occasion d'utiliser le plateau de 64 cases pour sauter du coq à l'âne entre le présent de la pandémie et ses souvenirs, sans souci de chronologie, comme le cavalier dont le mouvement si particulier permet des pas de côté et des retours en arrière.
La littérature pour faire revivre le passé, le rendre présent, évidemment on pense à Proust. Page 102 :
Car les lieux de notre enfance n'appartiennent plus au monde matériel, ils sont devenus une composante du temps, et ce n'est qu'en moi-même que je pourrais les retrouver, ce n'est que par l'écriture que je pourrais les faire revivre.
Puis, au chapitre 34, même page :
Ce sont les lieux, beaucoup mieux que les dates, qui laissent le passé faire soudain irruption dans le présent pour nous permettre de retrouver un instant, intacte et échangée, l'essence même de ce qui est à jamais disparu.
Marcel n'aurait pas dit autre chose. Il est d'ailleurs cité, page 117 : "Me souvenant d'une réflexion de Proust dans Le temps retrouvé, j'avais conscience que je n'étais pas le relecteur du livre que j'étais en train de lire, j'étais le relecteur de moi-même. C'est moi-même que j'essayais de traquer dans les pages de ce livre". Bien sûr, Proust aurait exprimé ces choses avec un tout autre style. Mais, contrairement à Eric Laurrent, autre écrivain des éditions de Minuit, Toussaint ne tente pas de se placer sur le même terrain.
Page 114, on pense plutôt à Kundera avec cette fine analyse sur la dualité de la pensée :
Là où intervient la dualité de la pensée, c'est que ce bonheur supposé que j'imagine que je vais ressentir rétrospectivement en repensant à cette période, je ne le perçois pas pour le moment. Je sais que, plus tard, en repensant à ces journées de confinement, je me dirai que j'avais été heureux dans mon bureau à Bruxelles à travailler à ce nouveau livre, mais ce bonheur que je me promets depuis le futur, je n'en vois pas la couleur pour l'instant, je n'en éprouve aujourd'hui aucun des agréments.
Il poursuit deux pages plus loin :
C'est la crise que nous sommes en train de vivre qui me fait me rendre compte, par contraste, combien il aurait été agréable de vivre le printemps littéraire passionnant et varié qui m'attendait [car Toussaint a dû comme tout le monde annuler beaucoup de choses]. De la même manière que l'annonce qu'on est atteint d'une maladie grave, qui met en péril notre pronostic vital, doit sans doute nous faire apprécier, par contraste, les mille bonheurs simples de la vie qu'on ne percevait plus, c'est l'épidémie de Covid-19 qui me fait apprécier, aujourd'hui, à leur juste valeur, les délicieux agréments du printemps 2020 dont, justement, elle m'a privé.
Le passé
Le passé, ce sont son père, brillant journaliste un temps directeur du Soir à Bruxelles ; sa mère, ses camarades de l'Ermitage, ceux qu'il connut ensuite en pratiquant les échecs ; un champion, Youssopov, qu'il affronta pour les besoins de son film, le contraignant à perdre pour les besoins de l'histoire (l'anecdote est savoureuse) ; sa femme Madeleine (Proust !), amour de sa vie, leurs deux enfants Jean et Anna. Les souvenirs et leur biais, sur lesquels l'écrivain avance une idée intéressante :
Je me rends compte aujourd'hui que je perçois tout ce qui se rapporte à cette période lointaine de l'Ermitage à travers une double couche d'opacité. Il y a d'abord l'opacité inhérente au souvenir ou à la mémoire, qui embrume les silhouettes et nappe les lieux anciens d'un léger voile de brouillard, mais il y a surtout l'opacité effective de la réalité telle qu'elle était à l'époque [là est l'idée moins convenue], souvent impénétrable, qui me faisait soupçonner que quelque chose se cachait derrière la surface anodine des apparences sans que je sois jamais en mesure de percer à jour ses mystères.
La description de ses débuts avec Madeleine nous vaut un chouette passage, page 232 :
Je les voyais très bien, nos deux enfants virtuels, penchés à leur balustrade céleste, comme ces chérubins ailés de Raphaël, torse nu et joufflus, qu'on trouve au bas de la Madone Sixtine, qui suivaient avec attention les différentes étapes de mon manège autour de leur future mère. Sans doute Jean et Anna ont-ils dû penser que c'était mal engagé quand ils ont vu que Madeleine ne m'avait pas attendu et s'éloignait dans la rue pour rentrer chez elle.
Le jeu sur l'idée d'un avenir en germes se poursuit page suivante :
(...) il y avait quelque chose de tendre, même si nous ne nous étions pas encore embrassés. Mais, par la suite, nous nous sommes tant de fois embrassés que cela pouvait bien attendre encore un moment, et je n'éprouvais aucune espèce de hâte ni même d'inquiétude pour la suite des événements.
Le présent
Le présent c'est son métier d'écrivain. Pendant la pandémie, Toussaint prend la décision de traduire le matin Le joueur d'échecs, fameux ultime opus de Zweig et, l'après-midi, de rédiger le livre que le lecteur a dans les mains. Ecrire est une véritable protection contre une époque perçue comme menaçante, comme il le dit en fin d'ouvrage, page 193 :
Le livre, pendant que je l'écris, devient un sanctuaire, un lieu clos où je suis protégé des offenses du monde extérieur. C'est en moi qu'il se terre, c'est en moi que se trouve le livre que je suis en train d'écrire, voilé, inconnu, et c'est à moi d'aller à sa rencontre. J'émets cette hypothèse : j'écris pour mettre au jour quelque chose d'enfoui, pour délier en moi quelque chose de noué.
Ecrire c'est descendre en soi, profondément : l'idée n'est pas nouvelle, Toussaint la développe ici longuement.
Traducteur / écrivain, c'est presque le même métier. Il s'agit de trouver le mot juste, ce qui peut virer à l'obsession. Page 48, Toussaint évoque Flaubert qui, "cherchant désespérément à trouver la métaphore exacte pour qualifier une sorte de blancheur, après avoir écarté des centaines de variantes et testé des milliers d'hypothèses [un brin d'exagération peut-être ?...], finit par écrire "blanc comme neige". Ce n'est peut-être pas très original, mais c'est précis." Et l'auteur de tenter de définir la période qu'il vit, qui n'est certes pas une guerre, ni l'équivalent de la grippe espagnole de 1918. "Nous allons tous vivre, concrètement, de l'intérieur, ce qu'est l'intrusion, brutale, violente, d'un événement extérieur dans ce qui constituait jusqu'ici l'univers tranquille et familier de notre vie quotidienne". J'aurais envie de dire là aussi, concernant cette phrase : ce n'est peut-être pas très original mais c'est précis.
La littérature, c'est donc le travail de la langue. Toussaint l'a écrit à une étudiante qui avait eu l'audace de se montrer critique à son égard. Page 38, il lui écrit :
1) La littérature n'a pas pour vocation de raconter des histoires.
2) L'écrivain n'a pas à délivrer de message.
"La littérature, pour être jugée, demande un minimum de connaissance, d'expérience et de culture", ajoute-t-il. Pan sur le bec. Au-delà de l'orgueil blessé, Toussaint s'insurge contre la manie contemporaine de tout juger, de tout noter, même lorsqu'on n'y connaît rien. L'incompétence, un vrai fléau d'aujourd'hui, je suis bien d'accord. Pour autant, faut-il réserver la critique aux gens dont c'est le métier et aux "universitaires" ? Ce serait dommage tant certaines plumes de SC ont éclairé, parfois, des oeuvres auxquelles je m'étais confronté.
La traduction aussi consiste à rechercher le mot juste, ce que détaille très bien Toussaint. Passionnant de comparer les versions d'une même phrase allemande de Zweig, page 138 :
Brigitte Vergne-Cain et Gérard Rudent : "La moindre réponse comportait une responsabilité immense".
Françoise Wuilmart : "Chacune de mes réponses portait le poids d'une énorme responsabilité".
Diane Meur : "Je prenais une responsabilité énorme à chaque réponse".
Olivier Mannoni : "Chaque réponse faisait peser sur mes épaules une responsabilité monstrueuse".
Bernard Lortholary : "Chaque réponse prenait les proportions d'une responsabilité énorme".
Finalement, Toussaint optera pour une solution qu'il qualifie de "radicale" : "Quelle immense responsabilité à chaque réponse !". Fascinant.
Les échecs
Comme peut l'être le jeu d'échecs. Le cas de Gilles Andruet est à cet égard emblématique. Ce surdoué débarque un jour dans la salle d'échecs de Beaubourg et lance qu'il prend les cinq meilleurs en aveugle. Traduction : il joue cinq parties en même temps, sans voir les plateaux ! Et il les gagne toutes. Il paraît que le record est de 48 parties et 38 victoires...
La pensée de l'écrivain a quelques accointances avec celle du joueur d'échecs. Notamment pour cette idée d'enveloppe protectrice, évoquée plus haut. Page 204 :
Ce qui me frappe surtout, c'est que les deux passions qui sont nées à cette époque de ma vie - les échecs et la littérature -, ont pris leur envol au même moment, de façon concomitante, sans doute parce qu'elles m'offraient l'une et l'autre une protection inégalable contre les menaces du monde extérieur.
Ce qui est concomitant, c'est aussi cette première fois où Toussaint l'emporte sur son père - déclenchant le refus de ce dernier de jouer avec lui à l'avenir - et cette parole adoubant le jeune Jean-Philippe comme écrivain. Ce qui lui fait conclure joliment : "je n'ai pas eu la vocation, j'ai eu la permission". Pour s'accomplir il faut tuer le père, c'est-à-dire faire échec et mat. Il n'est pas innocent que la parole libératrice coïncidence avec sa première victoire devant l'échiquier.
A l'appui du parallèle échecs-littérature, Toussaint convoque également Nabokov, à qui il voue une admiration sans bornes, pour l'art avec lequel il tisse ses intrigues. Page 118 : "J'adore cette idée de préparer, très en amont, un effet qui ne se révèlera que trente ou cinquante pages plus tard. C'est très technique, et cela demande beaucoup de préparation. Cela me fait penser à certains coups d'échecs, apparemment anodins ou innocents, qui préparent en réalité une subtile combinaison à long terme." Avant de vanter, quelques lignes plus loin, la "virtuosité du détail", comme on pourrait le faire d'un tableau de maître.
* * *
Eh bien voilà. Voilà ce qu'on trouve chez Nabokov (même si je n'ai lu de lui à ce jour que Lolita) et qui fait défaut à Jean-Philippe Toussaint : le délice du style. Toussaint écrit précis, fluide, mais il fait peu ressentir le frisson de la beauté de la phrase. Sa prose contient assez peu de ces effets de surprise qu'il adore chez Nabokov, elle suscite peu ces pincements de ravissement que procure un style puissant. Jean-Philippe Toussaint est d'avantage un artisan, qui nous fait ici entrer dans l'intimité de son atelier. Toussaint n'est pas Nabokov, mais il donne envie de le lire.
7,5