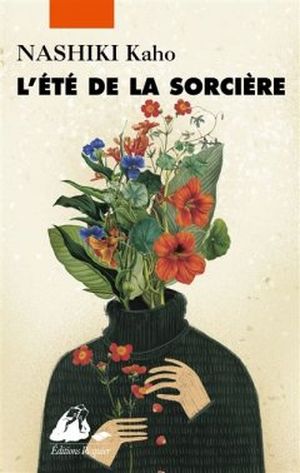Pour apprécier pleinement « L’été de la sorcière », il sera tout d’abord nécessaire de se pencher un instant sur la biographie de Kaho Nashiki. Née en 1959 dans la préfecture de Kagoshima, elle part étudier en Angleterre après avoir été diplômée de l’université privée de Doshisha, à Kyoto. Là-bas, elle se consacre principalement à la littérature de jeunesse, avec Betty Morgan Bowen pour mentor. A son retour au Japon, elle traduit et commente systématiquement toutes les publications de Garcia-Marquez (dont « Cent ans de solitude » est son favori) puis devient certes écrivaine, mais se fait avant tout connaître comme romancière jeunesse et auteure de livre d’images. « L’été de la sorcière », sa première oeuvre parue en 1994, est donc avant tout considéré comme un roman de jeunesse dans son pays natal. Il reçoit d’ailleurs trois récompenses, spécifiquement destinées à ce type de littérature: les Japan Children's Literature Association New Face Award, Nankichi Niimi Children's Literature Award et Shogakukan Literature Award.
Or, il n’est pas fait mention de la véritable nature du roman dans sa traduction français, ce qui pourrait laisser certains férus de littérature japonaise sur leur faim. On pensera par exemple à l’utilisation récurrente de la troisième personne, comme précisé dans une autre critique. En vérité, ce choix de traduction retranscrit assez fidèlement l’ambiance originale. Au Japon, les enfants parlent d’ ailleurs d’eux-même à la troisième personne. Le ton est ainsi volontairement allégé. De plus, les personnages peuvent parfois manquer de profondeur, ce qui se justifie de nouveau par le fait que le message principal doit être saisi par un enfant ou un jeune adolescent.
La grand-mère reste malgré tout un personnage nuancé. Bien qu’étrangère, elle incarne les valeurs d’un Japon traditionnel et conservateur qu’elle échoue à transmettre à sa fille, ce qui constitue un magnifique paradoxe. Derrière des apparences de perfection, elle connaît également l’échec, y compris avec Mai, ce qui en fait l’une des personnalité les plus travaillées du roman. Auprès d'elle, la jeune fille découvrira l’importance de transmettre ce que nous sommes et ce que nous possédons afin de persister au delà de mort.
Notons que cette version française est agrémenté de trois nouvelles qui avaient à l’origine été publiées au sein de revues littéraires les années suivant sa publication, puis compilées dans l’édition de poche. Si l’on regrettera leur manque d’impact en comparaison de l’œuvre principale, il reste agréable de pouvoir les parcourir.
Pour conclure, je dirais qu'il ne s'agit peut-être pas du roman japonais de l'année, mais sa traduction (tardive) en français reste un excellent moyen de découvrir l'un des romans de jeunesse les plus retentissant des années 90 sur l'Archipel.