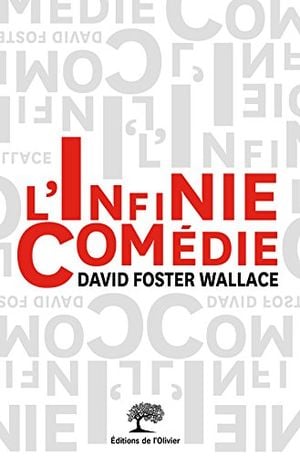Depuis le mois d’août, Infinite Jest, l’œuvre immense et terrifiante de David Foster Wallace, est enfin disponible en français. Publié en 1996 aux Etats-Unis, ce chef-d’œuvre des XX et XXièmes siècles confondus est un capharnaüm virtuose, un labyrinthe de mille-cinq cent pages, impossible à résumer.
Dans un monde proche du nôtre, noyé dans la consommation (les années portent d’ailleurs le nom de sponsors, telles l’Année des sous-vêtements pour adultes incontinents Depend, ou encore l’Année de la compresse médicale Tucks), gouverné par le divertissement (incarné par la télévision, et plus particulièrement les « cartouches de divertissement », enregistrements visant à détendre et amollir les cerveaux), un attentat se prépare, mené par les Assassins en Fauteuil Roulant, un groupe de séparatistes québécois, contre l’O.N.A.N. (l’Organisation des Nations d’Amérique du Nord, c’est-à-dire l’union formée par les Etats-Unis, le Canada et le Mexique).
L’arme de destruction massive assidûment recherchée par ces terroristes est une vidéo nommée L’Infinie Comédie, qui plonge quiconque la regarde dans un état végétatif et extatique. Son réalisateur, James Orin Incandenza, expert en physique optique et cinéaste avant-gardiste, s’est suicidé la tête dans le micro-ondes l’Année de la mini-savonnette Dove. L’un des protagonistes du livre est son fils, Hal Incandenza, jeune tennisman prodige passionné de philosophie. Ce dernier, dont le quotidien se partage entre entraînements, compétitions et drogue, est un membre de la prestigieuse Enfield Tennis Academy de Boston. Les récits de la famille Incandenza (James, Avril, Orin, Hal, Mario) se perdent dans la multitude de cris que donne à entendre L’Infinie Comédie. Ceux des résidents du centre de désintoxication d’Ennet House, pour ne citer qu’eux, au désespoir plus ou moins irrécupérable, dont nous suivons les réunions, les rechutes et les journées mouvementées.
Presque tous les personnages de David Foster Wallace sont toxicomanes, alcooliques, incontrôlables et authentiques. S’ils volent, s’ils frappent, s’ils se défoncent, c’est par excès de zèle. Par envie de bien faire, par besoin de prendre les choses à cœur. Et, à les écouter, il devient évident qu’il n’en aurait pu être autrement. Curieusement, le sentiment qui se dégage de leurs monologues à la saturation savamment orchestrée est celui du vide. Un vide triste, profond, sans appel. L’univers de Wallace se nourrit de ses propres expériences. Les développements ardus qu’il mène tiennent tantôt de la littérature, tantôt des mathématiques, disciplines qu’il a étudiées. Joueur de tennis à un haut niveau, il voit dans le sport une quête impitoyable d’excellence, et lui offre la première place (l’abnégation, les limites sans cesse repoussées, la course sans fin, la vacuité de l’ensemble, mais la beauté de la démarche). Enfin, habitué des centres de désintoxication et des hôpitaux psychiatriques dès son plus jeune âge, l’auteur ne peut manifestement se défaire d’un dégoût persistant (contre la société de consommation, les médias de masse, l’outrance américaine, et contre lui-même). Hanté comme le sont ses personnages par l’addiction, la compétition et la dépression, David Foster Wallace s’est donné la mort le 12 septembre 2008, à seulement 46 ans.
Infinite Jest est le fruit de dix années de travail acharné, souvent interrompu, commencé autour de 1986 et achevé en 1996. Le résultat est difficilement lisible, défie toute entreprise de traduction (félicitations, au passage, à Francis Kerline), et relève du génie. La phrase de Wallace, sinueuse, envahissante, empêchée par les innombrables et indéchiffrables notes de bas de page (sur les différents sédatifs légers, la filmographique exhaustive de James O. Incandenza ou le langage vernaculaire du North Shore), dénote une ambition et une désespérance sans commune mesure. Ce style brillant et découragé, d’une intelligence et d’une détresse extrêmes, font corps avec le mouvement du « réalisme hystérique » défini par le critique James Wood en 2000, et dont quelques autres auteurs américains se revendiquent.
La réception de l*’Infinie Comédie*, entre hystérie et mécompréhensions, fit beaucoup de mal à David Foster Wallace, qui déclara : « J’ai voulu écrire quelque chose de triste, et les gens ont trouvé ça drôle. » S’il est en effet impossible d’enserrer et d’englober une telle pensée, il est cependant autorisé, et même conseillé, de s’y confronter – et de s’émerveiller.
Extrait :
« Mon dossier n’a pas été acheté ! leur dis-je, tonnant dans les ténèbres de la caverne rouge qui s’ouvre devant mes yeux clos. Je ne suis pas seulement un type qui joue au tennis. J’ai une histoire touffue. Des expériences et des sentiments. Je suis complexe.
« Je lis, dis-je. J’étudie et je lis. Je parie que j’ai lu tous ce que vous avez lu, n’allez pas croire. Je consomme des bibliothèques. J’épuise les reliures et les CD-ROM. Je fais des trucs comme monter dans un taxi pour dire : « La bibliothèque, et vite. » Mes intuitions en syntaxe et en mécanique sont meilleures que les vôtres, permettez-moi de vous le dire, sauf votre respect.
« Mais ça transcende la mécanique. Je ne suis pas une machine. Je ressens et je crois. J’ai des opinions. Certaines sont intéressantes. Je pourrais parler sans relâche si vous me laissiez faire. Parlons de n’importe quoi. Je crois que l’influence de Kierkegaard sur Camus est sous-estimée. Je crois que Dennis Gabor peut très bien avoir été l’Antéchrist. Je crois que Hobbes n’est que le reflet sombre de Rousseau. Je crois, avec Hegel, que la transcendance est absorption. Je pourrais vous interfacer, vous tous, là sous la table. Je ne suis pas un simple creatus manufacturé, conditionné et formé pour une fonction. »
J’ouvre les yeux. « Vous auriez tort de penser que je suis désinvolte. »
Je regarde autour de moi. Ils sont horrifiés. Je me lève. Je vois des mâchoires affaissées, des sourcils haussés sur des fronts tremblants, des joues blanches. La chaise recule sous moi.