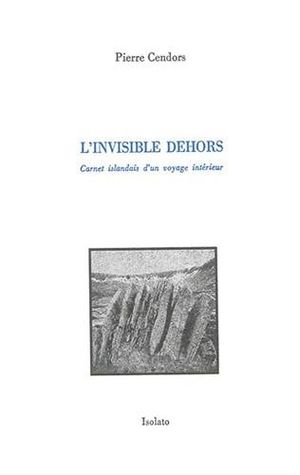Dans ce livre sous-titré «Carnet islandais d’un voyage intérieur», et paru en 2014 aux éditions Isolato, Pierre Cendors raconte, avec une langue poétique somptueuse, un voyage entrepris au printemps 2011, une confrontation avec les paysages élémentaires du grand nord islandais pour donner corps à un projet romanesque encore vague.
«Depuis mon retour du Septentrion, je me répète souvent ces paroles de Magnús Morland, les rares dont je me souvienne :
Je ne viens pas en Islande pour voir, au pied d’un glacier, un désert de lave, des geysers ou un volcan, car alors je perdrais l’écho de ce qui m’appelle ici. Je ne viens pas non plus contempler les aurores boréales. Je viens pour rejoindre l’autre côté d’une vision qui m’habite depuis de longues années, une vision dont je ne sais presque rien, sinon que le paysage archaïque, aux reliefs ruiniformes, de cette île qui a surgi de l’Atlantique Nord, il y a de cela 25 millions d’années, lui ressemble.»
Le voyage démarre à Hornstrandir, «un territoire dont le règne sauvage, à cette latitude et si éloigné de l’affairisme amnésique de nos sociétés, n’a rien d’un simulacre.» Pour cet écrivain marcheur, la solitude et la matière brute doivent nourrir la page blanche, dialogue intérieur face au vide entre le mouvement des pas et celui de l’imagination.
Prenant des accents d’une profondeur mystiques, Pierre Cendors dit l’éloignement du monde, le détachement d’une société utilitaire qui mutile, pour entrer dans la beauté puissante et muette et le temps distendu de ce paysage minéral, et renouveler ainsi la pensée et la forme.
«L’homme n’est peut-être qu’un épisode de l’évolution. À quelques kilomètres de Reykjavík, des rangées pimpantes de résidences-casernes, aussi déplacées dans ces étendues désertiques qu’une femme fardée, parfumée, permanentée au milieu du Sahara, soulignent brutalement l’évidence : la civilisation, toute civilisation, est une divinité clandestine déchue.»
Voyage au milieu de nulle part et au cœur de la matière, ce face-à-face avec le vide prend une direction inattendue, devant cette «nature affranchie de toute mainmise» humaine, ces distances et ces durées si vastes qu’elles font disparaître le but et imposent le silence, puis avec le choc de la découverte des toiles du peintre islandais Georg Gudni.
«Hvarfnúpur.
Laekjarfjall.
Látrafjall
Sphinx ruiniformes dont seuls demeurent le train arrière et les puissantes pattes antérieures, scellées à leur socle d’immobilité.
Straumnessfjall.
Skálafell.
Montagnes-enclumes sillonnées de crevées où s’agrège la dernière neige, où ruisselle l’eau de fonte. Montagnes, tours et corniches larvaires aux torsions calcinées, aux cernes de refroidissement moulurés et réguliers.
Pierres sombres, lugubres dévaloirs à avalanches face auxquels, sous la poitrine du promeneur, un vertige s’écœure en silence.
Falaise-cargos dont l’étrave noirâtre partage la baie mouvante et agglomère les nuées sifflantes dans ses hauteurs démâtées.»
Dédié à Georg Gudni, «L’invisible dehors» est un récit d’une beauté intense, tendu vers une forme d’absolu, plus tellurique que céleste, qui évoque les fulgurances d’Emmanuel Ruben et son évocation de l’œuvre du peintre danois Per Kirkeby dans «Icecolor».
«On écrit pour donner voix à ce qui, autrement, demeurerait muet, enseveli sous le piétinement des paroles. On écrit pour quitter l’insomnie des conversations, ces longs repas du langage.»
Retrouvez cette note de lecture, et toutes celles de Charybde 2 et 7 sur leur blog ici :
https://charybde2.wordpress.com/2015/07/05/note-de-lecture-linvisible-dehors-pierre-cendors/