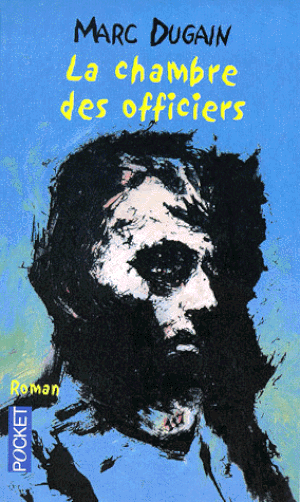La seule et unique fois qu'un citoyen s'est penché sur le sujet des défigurés de la Première Guerre Mondiale, c'est sans doute en admirant une peinture d'Otto Dix, ce peintre allemand profondément traumatisé et touché par le sort de ces infirmes du visage. Il est vrai que cette peinture fait réfléchir, presque plus que les nombreuses photos présentes dans les livres d'histoire. Pourtant, la lecture de ce petit roman audacieux (qui rappelons-le est le premier roman de l'auteur) devrait figurer dans les programmes scolaires. Cependant, comme souvent avec Marc Dugain, on ne sait jamais réellement que penser de ce que l'on a sous les yeux, c'est pourquoi on l'aime d'autant plus. Est-ce un petit chef-d'oeuvre ? Un petit conte historique ? Ou un piètre roman où les sujets ne sont pas poussés jusqu'au bout ? Ce sont les questions que l'on se pose à la lecture de l'histoire de ce jeune soldat venu de Dordogne, laïc et républicain, défiguré par un des touts premiers tirs d'obus sur les bords de la Meuse en 1914 , transporté en urgence à l'hôpital du Val-De-Grâce a Paris où il vivra pendant des années dans une chambre d'officiers avec d'autres compagnons aux gueules cassées un Breton catholique et un aviateur Juif. Le lecteur suit de par leurs yeux leur nouvelle vie et l'évolution de la société d'après guerre, et du regard de cette société sur leur nouvelle infirmité.
Le livre pose évidemment la question de l'identité. Perdre une jambe ou un bras n'est résolument pas la même chose que de perdre son visage, et par la même son être en soi. Ainsi, si les uns perdent la faculté de se mouvoir, eux perdent la faculté de se concevoir et de vivre. Il n'est pas étonnant qu'une des alternatives aux féminicides soit la défiguration des femmes au vitriol, car elle permet à l'homme en colère, non pas de tuer l'objet convoité, mais de lui enlever toute capacité de libre-arbitre en lui retirant son identité, et en même temps, d'être les derniers possesseurs de leurs visages. Il y a pire que de tuer quelqu'un : le défigurer. En perdant leurs visages, ils ne peuvent plus manger, ils ne peuvent plus être désirés et ne peuvent plus travailler : dans nos sociétés, ils ne sont plus rien. Le livre se veut certes plus optimiste qu'il n'y paraît, mais l'observation de l'histoire nous alerte sur l'horreur de la vie de ses gueules cassées, qui ont formé une communauté de vie à part, isolées de tous et rejetées y compris quand elles étaient respectées par les vieux hommes qui baissent leurs chapeaux. L'un des moments les plus étranges du roman était celui de la visite des trois hommes à la maison close pour sentir le regard des femmes sur eux. Le regard de la société n'est pas méchant, il est même plutôt bienveillant et respectueux mais s'il évolue dans le sens de la méfiance et de la peur. Je me rappelle avec une certaine émotion de la réaction de la petite fille tellement habituée à l'horreur qu'elle ne semble pas effrayée par le visage du narrateur. Peu à peu, les enfants se feront plus haineux et méchants, le souvenir de la guerre s'estompant et une autre arrivant encore plus implacable. Le livre réussit son tour de force en substituant notre regard à celui du narrateur, et l'on voit à travers ses yeux.
Concrètement, le style est un style à la Dugain, simple et aux mots bien choisis. Il vaut mieux sans doute un style simple et bien pesé, qu'un style emphatique et ridicule ou un style simple et pauvre. Le roman est assez inégal : excellent au début, moins bon à la fin. Il n'était pas vraiment nécessaire à mon sens de continuer le roman au-delà de la chambre des officiers, et la fin me semble un peu trop belle pour être réaliste. Le roman pouvait être encore plus poignant qu'il ne l'est maintenant. Donner une jolie fin à quelque chose qui en réalité est profondément tragique me semble presque incompréhensible. Quoiqu'il en soit, le livre me semble très important et fait partie des classiques de la littérature contemporaine pour comprendre le rôle si important du visage dans notre civilisation.