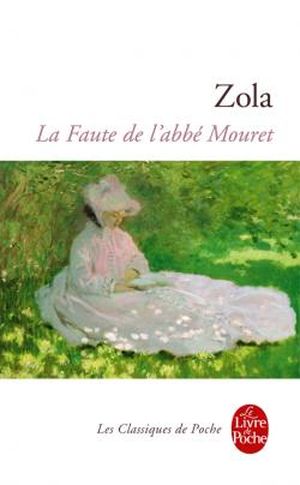Un éblouissement de quatre-cents pages : la plume déliée et virtuose de Zola est un délice, les descriptions du Paradou sont vibrantes de vie et de sensualité, le tissage serré des thématiques entre elles est parfaitement maîtrisée : chrétienté vs. paganisme, vie vs. mort, spiritualité vs. sensualité… Les motifs contrastent violemment entre eux mais Zola parvient à les marier dans des évocations sublimes : l’église qui croule sous les assauts de la nature, la communion avec la Vierge qui prend la forme d’une véritable union charnelle… La faute de l’abbé Mouret est un immense poème (je vole cette analyse à Huysmans, c’est écrit sur ma 4ème de couverture), une métaphore brodée sur le désir, la vie, les sens…
On reconnait à Zola d’être le maître incontesté du naturalisme, mais La faute de l’Abbé Mouret est un roman aux accents très surnaturels : le Paradou est un îlot aberrant, exubérant, hyperbolique, presque anormal, en réalité surnaturel. C’est le mythologique jardin d’Eden descendu sur Terre, on s’y enfonce en laissant son intellect de côté, en ratissant les moindres recoins pour se saturer de couleurs, d’odeurs et de sensations débridés.
L’opulence du Paradou fait croire à l’abbé qu’il perd la raison. C’est plutôt son fanatisme religieux qui l’assèche et le mortifie. En fuyant obstinément les forces vitales, le jardin d’Albine ressemble à une hallucination. Est-ce la stricte vérité, est-ce une vue de son esprit assoiffé ?
La narration est aussi parfaitement balancée, en trois mouvement qui vont de la Mort à la Vie puis réconcilie les deux, dans un final ironique.
Même le titre de ce roman mériterai une analyse, tant les conséquences pour l’abbé et pour Albine sont diamétralement opposées : ce qui ne sera qu’une tache dans la carrière du jeune curé, aura des conséquences funestes pour la jeune fille, le pêché de l’abbé est mortel, mais l’abbé s’absout, choisissant l’aveuglement à la vérité.
Un véritable chef d’oeuvre finement brodé, tant sur la forme foisonnante, que sur le fond riche de réflexions.