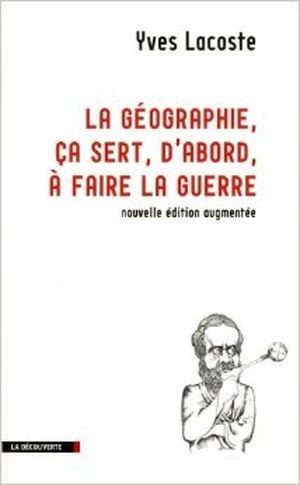Pour une géographie au service des citoyens
Voilà un ouvrage qui vient d’être joliment réédité, presque quarante ans après avoir créé de multiples débats. Cette nouvelle édition est intéressante, dans le sens où elle est augmentée d’une préface de cinquante pages dans laquelle l’auteur retrace son parcours, mais aussi de notes complémentaires à la fin de chaque chapitre. L’édition est très agréable, et l’ouvrage se lit bien, malgré les répétitions.
La préface, tout d’abord, est assez passionnante, retraçant le parcours de l’auteur, et notamment ses débuts. C’est un peu surprenant de voir ces pages autobiographiques, mais il s’agit pour Yves Lacoste de retracer le parcours qui l’a amené à écrire cet ouvrage. Il y explique d’abord ce titre un peu étonnant, qui résume assez bien une des idées essentielles de son essai : la géographie a depuis les origines été un outil au service des puissants. Le « d’abord » du titre signifiant « en premier lieu » plutôt que « surtout ». Pour Lacoste, la géographie devrait être aussi et même surtout un outil entre les mains des citoyens.
La préface revient sur son parcours, son enfance au Maroc, son intérêt premier pour la géologie, sa rencontre et ses relations avec Pierre George mais aussi Jean Dresch, son expérience de prof en Algérie, la découverte d’Ibn Khaldoun, son retour à Paris, son intérêt grandissant pour la géographie humaine, ses travaux sur la Haute-Volta ou les bombardements américains des digues du fleuve rouge au Vietnam, l’émergence de la géopolitique en France, la création de la revue Hérodote…
Puis on entre dans le cœur du sujet, Lacoste insistant avant tout sur le rôle stratégique du savoir géographique, sur son importance politique. Il relate l’histoire de la cartographie qui a selon lui d’abord été faite « par des officiers et pour des officiers », la production de la carte étant une opération difficile ne pouvant être réalisée que par un appareil d’Etat. Par la suite les cartes ont aussi été utilisées par les dirigeants de l’Etat pour structurer l’espace du pays ou celui des conquêtes coloniales ; aujourd’hui, ce sont les FTN qui utilisent ce savoir pour s’organiser à l’échelle mondiale. Ainsi, la carte est d’abord pour Lacoste un instrument de pouvoir.
En face de cette « géographie des états-majors » comme il l’appelle, Yves Lacoste dénonce aussi une « géographie des professeurs », lénifiante, ainsi qu’une « géographie-spectacle », qui dissimuleraient l’importance stratégique de la géographie. Depuis le XIXème siècle, le rôle de la géographie, comme de l’histoire, était d’abord d’édifier un sentiment national, en ancrant l’identité de la nation sur des composantes physiques.
Lacoste émet alors une critique forte de la géographie vidalienne : même s’il reconnaît aussi la qualité des analyses de Vidal de la Blache, sa grande finesse, il lui reproche surtout d’avoir inventé un « concept-obstacle », celui de région, de ne proposer ainsi qu’une seule façon de découper l’espace et d’occulter les phénomènes économiques et sociaux, et notamment l’essor de l’industrie et de l’urbanisation. Or, pour Lacoste, la présentation vidalienne, reprise par de nombreux géographes français, empêche d’appréhender correctement toute la complexité des réalités économiques, sociales et politiques. Le découpage en région proposé par Vidal ne convient pas pour l’analyse de tous les phénomènes. Lacoste met ainsi en avant la nécessité de l’analyse multiscalaire et prône une nouvelle méthodologie qu’il intitule la spatialité différentielle.
D’autres passages intéressants s’interrogent sur l’absence de réflexion épistémologique chez les géographes, alors qu’elle entretient des liens forts avec de nombreuses autres disciplines comme la géologie, la climatologie, la sociologie, l’économie, l’ethnologie, etc. Yves Lacoste s’étonne aussi de l’indifférence des philosophes à l’égard de la géographie, alors que le discours géographique pose de vastes problèmes épistémologiques, car la géographie « met en cause cette coupure fondamentale entre nature et culture », étant à la rencontre entre des données physiques et des faits humains, relevant à la fois des sciences « naturelles » et des sciences « sociales ».
Pour Lacoste, le plus important est de mettre entre les mains des citoyens le savoir stratégique qu’est la géographie. Et il critique alors les géographes marxistes qui au final ne remettent pas vraiment en question le cœur de l’analyse vidalienne. Il évoque aussi la nouvelle géographie, davantage appliquée que la géographie traditionnelle, mais du coup, compte tenu des moyens nécessaires à cette géographie quantitativiste, est davantage liée au pouvoir et donc éloignée des citoyens. Lacoste considère vital de vulgariser le« savoir penser l’espace » qui fut d’après lui, pendant des siècles, l’apanage des classes dirigeantes, de même que le savoir lire, écrire et compter. Il faut aider les citoyens à penser l’espace, avec ce qu’il appelle la pratique de la spatialité différentielle, c’est-à-dire de se référer à différentes échelles géographiques car chaque phénomène se trouve à l’intersection de multiples ensembles spatiaux de différents ordres de grandeur. Lacoste propose aussi la mise en place d’une sorte de déontologie du géographe qui contraindrait ce dernier à présenter et expliquer ses travaux et résultats aux citoyens, pour que ceux-ci ne soient pas dépossédés de ce savoir si important.
Globalement, si l’analyse est dans l’ensemble pertinente, il faut constater que Lacoste évoque peu dans les éléments ajoutés en 2012 le côté aujourd’hui obsolète de certaines de ses analyses de 1976 : on aimerait qu’il dise que certaines affirmations de l’ouvrage de 1976 ne sont plus valables aujourd’hui, mais ça a l’air difficile : Yves Lacoste ne reconnaît que du bout des lèvres certaines évolutions positives de la géographie, aujourd’hui beaucoup plus ouverte aux préoccupations citoyennes (parfois même trop avec l’idéologie du développement durable dans le programme de seconde). Aujourd’hui la carte est devenue un outil d’analyse que les enseignants essaient de transmettre, les journalistes l’utilisent de plus en plus pour mettre en avant les enjeux politiques d’une situation, même si chaque production est critiquable car par définition déformatrice. Dans cet ouvrage réédité, Yves Lacoste, malgré tous les apports de son texte de 1976 et notamment son introduction du mot géopolitique qui a aujourd’hui fait florès, ne remet ainsi que peu en question son analyse, et il règle même ses comptes avec Roger Brunet et ses chorêmes dont il proclame la défaite.
Bref, malgré quelques défauts, de trop nombreuses répétitions et des passages qui ont mal vieilli, on a là un ouvrage très stimulant pour quiconque s’intéresse à la géographie et à ses implications politiques.