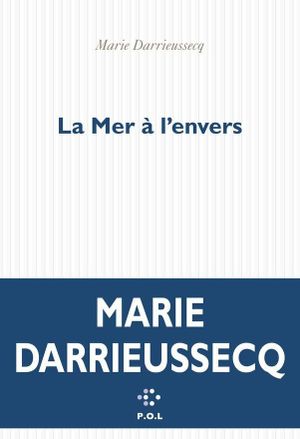J’avais presque abandonné la lecture de La Mer à l’envers à mi parcours. C’est rare que j’interrompe un roman au beau milieu mais la faiblesse de celui-ci rendait caduques tous mes efforts pour en poursuivre la lecture. Et puis, finalement, je me retrouvais confinée, j’avais le temps pour ne rien faire, alors pourquoi pas, au fond, remplacer du vide par du vent ?
Les deux premiers tiers du roman regroupent à peu près tout ce qui me gonfle dans la littérature contemporaine. C’est une sorte de condensé, d’huile essentielle de merde. C’est un constat violent, j’en suis bien consciente, mais rien n’échappait à cette effroyable consternation qui accompagnait ma lecture, je souhaitais sur le moment devenir presbyte et être née dans un monde sans verres progressifs.
Le récit est d’une vacuité affligeante, consacrant notamment plusieurs pages à la recherche d’un téléphone portable ou à l’énumération des différents loisirs de croisière, énumération exhaustive, on n’est jamais trop prudente. À cet espèce de patchwork inepte se mêle un drame humanitaire sur la Méditerranée, drame évacué en quelques paragraphes pour que la narratrice puisse s’appesantir à l’envi sur le menu détail des rendez-vous professionnels du mari agent immobilier.
Marie Darrieussecq s’efforce clairement de densifier avec n’importe quelle inspiration, n’importe quelle digression ou récit parallèle, la maigreur de son talent.
Ajoutez à ca que Rose, le personnage principal, est une psychologue en plein doute sur sa vie d’épouse et de mère, et permettez lui tout de même de vous livrer in extenso le contenu de ses séances de pédopsychologie.
Pour m’achever, un style à la limite du tweet, avec un abus outrancier de facilités narratrices et de cette esthétique de la ponctuation moderne, celle qui fait mettre à l’auteur un point après une phrase d’un mot ou deux et qui répète le procédé sur trente pages pour faire son pédant effet, avec des misères comme :
Café. Appeler son mari.
Soleil. La mer bleue.
De la poésie low cost. Du roman de fast-food.
S’agissant d’un roman sur le difficile sujet des migrants, on pouvait s’attendre à une vision sociale ou – puisque Rose est du milieu – psychologique, enfin on pouvait espérer quelque chose un tant soit peu littéraire. On a pour toute mangeaille intellectuelle ce genre de réflexion saisissante à propos d’un plein d’essence, page 169 :
Elle mesure ses gestes, je mets la carte, je fais mon code, c’est une hybride au sans-plomb, puis elle secoue le tuyau pour ne pas en perdre une goutte comme son mari lui a appris et comme les garçons font avec leur zizi.
ou encore ce sursaut d’indignation existentielle face au mauvais flic calaisien, page 176 :
Elle songea au flic qui avait tenu la porte dans ce geste si confiant, civilisé, universel : un homme tient la porte à un autre mais le gaze ensuite ? Ou bien, il y a deux sortes de flic ? Il y a deux sortes d’hommes ?
Bref, un babillage de décérébrée qui donne à Darrieussecq son diplôme de bas-bleu…
Curieusement, par une sorte de renversement aporétique, le dernier tiers du roman se rehausse à la hauteur d’une honnête partition romanesque. Le ton béotien est abandonné, le style se muscle et les personnages se chargent d’une densité qu’on ne leur soupçonnait pas jusqu’alors. Le récit, alternativement focalisé sur la traversée de la Manche par Younès et sur la cohabitation de ce dernier avec la famille néo-provinciale de Rose, prend un virage interessant, quoique lapidairement expédié.
Un ressaut trop tardif pour faire oublier le reste.