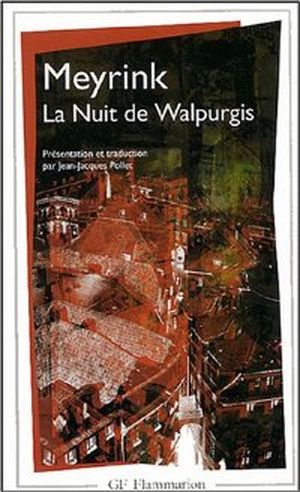Dans un monde idéal, l’expression roman ésotérique – ou simplement le mot roman – éveillerait le nom de Gustav Meyrink avant celui de Dan Brown. Or on ne vit pas dans un monde idéal, mais ça, on le savait déjà.
D’ailleurs, la Nuit de Walpurgis n’est pas si ésotérique que ça. (Dans mes souvenirs, le Golem et encore davantage l’Ange à la fenêtre d’Occident sont beaucoup plus chargés d’occultisme.) Il n’est pourtant pas si facile d’en résumer l’intrigue : mettons l’agitation sociale, politique et guerrière met Prague en ébullition tandis que quelques personnages s’aiment ou croient s’aimer. Le roman est écrit en 1917, l’action se déroule en 1917, et c’est encore ou déjà le Monde d’hier dont parlera Zweig.
Mais le récit semble surtout un prétexte à présenter des portraits insensés : Zrcadlo l’acteur « dont le nom ne signifiait pas seulement “miroir”, mais qui en était vraiment un » (p. 48) ; Liesel la vieille bohémienne (« Arrêtez de m’appeler toujours madame Lisinka ! […] Je ne suis pas une madame : je suis une putain ! Je suis une demoiselle ! », p. 72) ; le docteur Flugbeil, dit « le Pingouin », dont le ridicule devient presque touchant ; la comtesse Zahradka et le baron Elsenwanger auprès desquels les plus réactionnaires des hobereaux bretons peints par un Balzac ou un Barbey d’Aurevilly passeraient pour des avant-gardistes ; Brabetz le détective comme représentant d’une raison qui n’a plus rien que le grotesque des apparences ; cet agitateur russe qui « n’avait jamais sérieusement cru à la possibilité de mettre en œuvre les théories nihilistes ; il était trop intelligent pour cela. […] Il avait fait sienne de longue date la doctrine secrète de tous les nihilistes : “Ôte-toi de là que je m’y mette !” » (p. 150) ; Ottokar et Polyxena qui seraient peut-être presque dignes d’être considérés comme des héros ; ou alors la servante Bozena…
Pourtant ce qui frappe dans ce roman, – où contrairement à ce que son titre peut laisser penser, on ne trouve pas de véritable sabbat –, ce n’est pas seulement la satire qui s’y déploie. La haute société pragoise, haute aussi dans le sens où ses palais surplombent Prague et les Pragois qu’elle observe au télescope, n’y est pas seulement grotesque, elle est moribonde, victime de la violence perpétuellement renouvelée qui, pour Meyrink, constitue l’Histoire : « ce que l’on appelle “le temps” n’est rien d’autre qu’une diabolique comédie, mise en scène par un ennemi invisible et tout-puissant pour abuser l’esprit humain » (p. 39) se met à penser – ou plutôt à ressentir – un personnage.
J’écris victime, mais le terme n’est le pas approprié, pas davantage que responsable ; faudrait-il dire actrice ? La violence qui émane du roman – lequel ne comporte pourtant qu’une scène véritablement violente – ne vient pas de tel ou tel personnage, ni même de tel ou tel contexte historique, elle vient de l’humanité. Les seules variantes sont des variantes matérielles, 1917 offrant en l’occurrence « la plus terrifiante de toutes les guerres, la guerre des démons mécaniques contre les hommes, en comparaison de laquelle les batailles livrées par Wallenstein ressemblaient à des stupides rixes de taverne » (p. 77).
L’origine de cette violence, c’est l’aweysha, c’est-à-dire quelque chose comme une possession, un « phénomène magique » par lequel une « main invisible » (p. 206) dirige le carnage : « Le bras impitoyable de la furie de la guerre avait laissé partout l’empreinte de son action dévastatrice » (p. 58). Rien n’y échappe, pas même – surtout pas ? – la raison : « L’usage de la raison, Excellence, nous permet toujours de nous inventer toutes les explications que nous voulons. Même un usage très modeste, qui confond les causes et les effets » (p. 114), déclare Zrcadlo.
À quoi peut ressembler le salut dans un tel univers ? Peut-être à l’amour. Ou bien au jeu, à la bouffonnerie telle que s’y livre Zrcadlo. « Il s’agit simplement d’un fou. Ou bien – ou bien d’un comédien. Ou bien les deux à la fois… » (p. 65), dit de lui la vieille Liesel. De toute façon, il n’y a, semble-t-il, pas le choix : « La sagesse se promène sous nos yeux en habit de bouffon ! Pourquoi ? Parce que tout ce qui est reconnu et perçu comme un habit, un simple habit – y compris le corps –, ne peut être qu’un habit de bouffon » (p. 117). C’est Zrcadlo qui parle.
Et c’est tout le roman qui va dans ce sens. Si cette critique est saturée de citations, c’est parce que tout est dit explicitement dans la Nuit de Walpurgis.
P.S. – En citation bonus, un dialogue sur l’aweysha (p. 132-133), qui rend peut-être suffisamment justice à la noirceur du roman :
« Tout ce que les hommes font contre leur gré relève de l’aweysha, d’une manière ou d’une autre. Tu ne crois quand même pas que les hommes se jetteraient comme cela, un jour, les uns sur les autres comme des bêtes sauvages s’il n’y avait pas quelqu’un pour exercer sur eux l’aweysha…
– Ils font cela parce qu’ils croient ardemment en quelque chose… peut-être en certaines idées.
– Eh bien ! c’est justement cela, l’aweysha.
– L’exaltation pour des idées et l’aweysha seraient donc une seule et même chose ?
– Non. Il y a d’abord l’aweysha. L’exaltation vient après. »