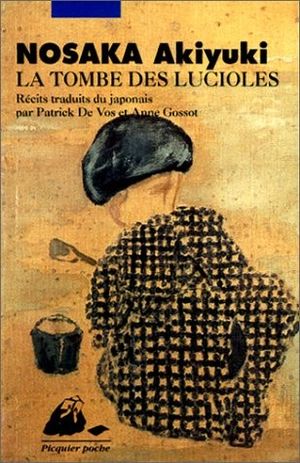Le 5 août 1945, une attaque aérienne américaine frappe en plein cœur la ville de Kôbe : tel un cauchemar de fin du monde, un déluge de fer et de feu s’abat sur la cité, réduit en cendres les corps et les biens. Dans la cohorte des survivants hagards, épouvantés, qui cherchent désespérément une échappatoire, s’éparpillant en tous sens, deux enfants : Seita, quatorze ans et sa petite sœur de quatre ans, Setsuko. Deux innocents qui bientôt se découvrent orphelins, jetés sur les routes incertaines d’un exode qui ne mène nulle part, deux êtres purs et candides, agneaux voués à l’abattoir dont nous assistons impuissants à l’effroyable agonie en même temps que nous découvrons l’amour indéfectible qui les unit. Seita porte à sa sœur une affection et un dévouement sans bornes, mais face à l’apocalypse, le jeu est trop inégal : trop jeune, trop immature, il ne prend pas vraiment les bonnes décisions, celles qui peut-être leur auraient donné une chance de survie. Dès le départ, le lecteur connaît l’issue fatale : le récit s’ouvre sur la mort de Seita, qui suit de quelques semaines celle de sa sœur pour revenir ensuite sur les quelques mois qu’a duré leur errance. L’intolérable nous est narré sans aucune concession. Rien ne nous est épargné du calvaire enduré, du désespoir, des tourments de la dénutrition, des ravages de la gale et de la dysenterie, dans l’indifférence voire l’hostilité généralisée : nulle compassion n’est offerte à ces enfants considérés comme d’inutiles bouches à nourrir tandis qu'un patriotisme aveugle et intransigeant refuse jusqu’au bout d’envisager l’inimaginable, à savoir la capitulation qui pourtant n’est plus qu’une question de jours.
Pour Akiyuki Nosaka , ce récit largement autobiographique est une forme d’expiation. Comme Seita, l’auteur a quatorze ans lorsque les bombardements ravagent son existence en même temps qu’ils réduisent à néant ses certitudes. A l’humiliation de la défaite succèdent la survie misérable, la désillusion, la révolte, la culpabilité. Nosaka s’en veut d’avoir abandonné sa mère sous les bombes (il n’apprendra qu’après la guerre qu’il avait été confié tout petit par son père à une famille adoptive suite à la mort de sa mère biologique), d’avoir été impuissant à empêcher sa petite sœur de mourir de faim. Surtout, il a du mal à supporter d’avoir, lui seul, survécu au cataclysme de la guerre. Pendant des années, il va errer dans ce Japon qui peine à se reconstruire, paria égaré au milieu des décombres, s’adonnant pour survivre au vol et au marché noir, jusqu’au jour où son père biologique, miraculeusement surgi de nulle part, viendra le tirer de la maison de correction où il croupissait. Cependant, toute sa vie Nosaka restera un révolté, rejetant les certitudes, combattant la bien-pensance, la guerre et le fanatisme. En réaction contre la littérature réservée aux élites, son langage est volontiers populaire et cru, comme celui du peuple dont sont issus ses personnages et pour lequel l’auteur entend écrire.
Dans une alchimie plutôt inattendue, La Tombe des lucioles mêle intimement argot et poésie, nous enseignant ainsi que la beauté est partout, même au cœur des guerres les plus hideuses, pour ceux dont l’âme est assez pure pour la percevoir. Pour échapper à la noirceur du monde et oublier leur désespoir, Seita et Setsuko n’ont que les tremblantes et éphémères lueurs des lucioles, grâce auxquelles ils s’inventent un univers fragile de sérénité, d’abondance et d’harmonie. Univers fugace, voué tout comme eux à une mort certaine mais n’est-ce pas de ce désir fou de récréer le monde pour en transcender l’horreur que naît la poésie ?
[Pendant ma lecture, m’est revenu en mémoire ce vers d’Apollinaire à propos de l’atrocité des tranchées :
Il y a dans le ciel six saucisses et la nuit venant on dirait des asticots dont naîtraient les étoiles.]