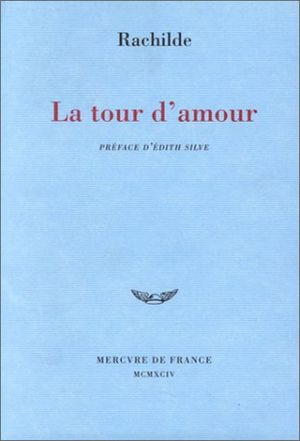La Tour d'amour, roman de Rachilde (oui, je suis partie dans un cycle rachildien, j'ai décidé de ressusciter l'écrivaine), est un roman breton bretonnisant, tout à fait différent de ce que j'avais pu voir dans La Jongleuse. Pas de décadentisme hérité de Huysmans ici, pas de beauté androgyne fardée, pas de fascination exsangue pour un être évanescent... Quoique...
On vous l'aura dit, ou pas, mais ceci est rarissime dans la littérature : cet objet que vous avez, ou pas, entre les mains, est un roman nécrophile. Je dis roman nécrophile, et non roman sur la nécrophilie, parce que :
-Ce n'est pas un roman sur la nécrophilie : ce n'est pas le thème du roman, ce n'est pas le coeur du roman, mais c'est un phénomène consécutif au récit.
-Ce n'est pas une condamnation de la nécrophilie - pas plus qu'un éloge - mais une façon subtile d'expliquer comment on peut être atteint par l'amour pour les femmes mortes. Le jugement moral n'est pas l'objet du roman : si le héros juge, pour sa part, le phénomène (j'aime bien les litotes abstraites) n'est pas blâmé intrinsèquement. Il est perçu comme choquant, effrayant par le narrateur... qui pour autant l'accepte avec une facilité déconcertante, ne le dénonce pas, voire finit par le comprendre, et éprouve de la pitié pour la victime de cette monstrueuse passion.
Vous aurez au passage noté l'intérêt certain de Rachilde pour la monstruosité. Si vous ne comprenez pas cette phrase, je vous redirige vers ma précédente critique, qui porte également sur Rachilde.
Sans développer aussi longuement les éléments centraux, je voudrais faire quelques remarques sur l'oeuvre en elle-même et comparativement à La Jongleuse. Le style, tout d'abord, n'a rien à voir : où l'on avait des affects de préciosité, un amour de la description luxueuse, une focalisation sur l'humain et ses fantaisies matérielles, on a au contraire une certaine rudesse, épuration du style, dont les traits céliniens sont absolument indéniables, flagrants dès les premières lignes... Et si la description garde une place importante, c'est bien davantage pour peindre une ambiance livide et diluvienne que pour en faire l'objet même du roman. Paradoxalement, l'amour des personnifications est évident - successivement le phare, la mer, la lune, toutes figures humaines, évidemment sexuelles (le phare est la figure phallique par excellence, la mer est la femme des gardiens du phare qui sont les protagonistes du roman, la lune tente d'épouser le phare...), qui incarnent un glissement de référentiel dans la vie des héros : le référentiel n'est plus la vie sociale, le contact à l'être humain, mais l'isolement, la seule compagnie de grands monstres qui semblent plus humains, plus tangibles, plus impactants que les humains mêmes. Les deux gardiens du phare sont seuls, même entre eux deux, la communication est impossible. Jean Maleux, le narrateur fraîchement arrivé suite à la mort de son prédécesseur, est observateur passif de la folie de Mathurin Barnabas, le gardien chef, qui ne fait que baragouiner, chanter, et gueuler. Ce côtoiement sans aucun partage (outre le devoir de maintenir le phare allumé) crée une solidarité de façade, lente, sans profondeur, qui renforce la solitude des deux pauvres êtres condamnés à passer leurs jours en haut d'un phare qui surplombe des écueils mortels, en proie à de terribles tempêtes, secoué continuellement par le vent breton, la pluie torrentielle, les vagues immenses de la mer.
Ambiance : gris, eau, mort, solitude. Un bien joli tableau... Mais si, car Rachilde propose ici une nouvelle esthétique de la noyade, de l'eau qui envahit tout, inonde tout, qu'on avale ou plutôt qui nous avale. Lisez les quelques pages superbes qui se consacrent à la description élégante, rêche, fragmentaire, précise, somptueuse des figures phares (lolilol) du roman, dans les yeux de Maleux (car le roman est écrit à la première personne). La nature, ici, abîme les êtres, dans tous les sens du terme - c'est-à-dire qu'elle les dégrade et les fait chuter. On voit comment Barnabas a chuté dans la folie en assistant à la chute, en direct, de son adjoint et successeur, à force de solitude et d'abêtissement dans le devoir, comme le montrent certains détails - par exemple, Barnabas ne sait PLUS lire, ou il se fait un étrange bonnet avec des oreilles pendantes comme des chiens dont je ne vous dirai rien de plus... Animalisation, mécanisation, noyade de l'être, fatalité de la fonction de gardien qui conduit à cette fracassante conclusion : la seule femme possible pour ces hommes est la femme morte, la femme qui se laisse faire, qui ne fuit pas cette atmosphère morbide, la noyée échouée sur les écueils au pied du phare. La seule femme vivante, la seule épouse infiniment plus réelle, c'est la mer, féroce, qui s'accapare les hommes.
C'est donc la lente dégradation d'un être qui fait l'objet de ce récit. La nécrophilie, ce n'est qu'une contingence de cette dégradation... puisqu'elle peut advenir, comme en Barnabas, ou non. La dégradation se fait sur tous les plans, mais elle se fait quoi qu'il en soit. Sexuellement, psychologiquement, physiquement, intellectuellement... Et l'exploit de Rachilde est de donner à voir cette chute dont la folie est l'apogée, en six ans dans la temporalité du récit, en 160 pages. Cela suffit, cela est parfaitement achevé.
Vous pardonnerez la rapidité avec laquelle je passe sur une analyse stylistique qui serait passionnante. Encore une fois je n'ai qu'un conseil final à donner : lisez, mes bons !