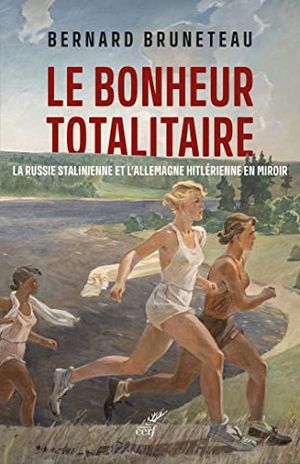Cet ouvrage est signé par Bernard Bruneteau, professeur à l’université de Rennes et spécialiste des totalitarismes sur lesquels il a déjà fait paraître plusieurs livres. Dans celui-ci, il réfléchit aux régimes totalitaires promettant le bonheur à leurs citoyens, à travers l’exemple de l’URSS stalinienne et l’Allemagne hitlérienne. Un objet d’étude inhabituel et intéressant. Des régimes s’appuyant bien sûr sur la propagande, la terreur et l’oppression, sur des arrestations et massacres de masse aussi, mais les limiter à cet aspect ne permet pas d’en comprendre la complexité. Ces régimes ont tous les 2 séduit une partie importante de la population soviétique et allemande et la terreur mise en place seule ne l’aurait pas rendu possible. Bruneteau utilise pour son sujet des sciences comme l’économie mais aussi la sociologie et la philosophie, sa réflexion et ses exemples sont donc riches : « La mobilisation des sociétés totalitaires se fait certes sur des dispositifs de promotion, de gratification et de protection très concrets qui induisent la relative réalité d’un « État social » providentiel ». L’exemple de la promotion des femmes, même dans le nazisme, est particulièrement bien développé, bien au-delà des femmes célèbres mises en avant par la propagande d’Etat (Leni Riefenstahl en Allemagne ou Lioudmila Pavlitchenko, tireuse d’élite dans l’Armée Rouge) : elles avaient de vraies possibilités de promotion et une certaine indépendance, dans les limites fixées par l’Etat totalitaire évidemment. Bruneteau écrit : « Pourtant, si le nazisme a pu mobiliser des vagues d’adhérents qui sont autant de croyants, c’est parce que son idéologie, aussi variée et hétérogène soit-elle, possède une fonction libératrice et rédemptrice ». Malgré leurs évidentes différences idéologiques, le constat est le même pour le stalinisme : « Le monde industriel soviétique (…) révèle un processus de hiérarchisation générateur de mobilité et de promotion sociale dont les bénéficiaires vont constituer une assise indéfectible du pouvoir stalinien », le régime mettant en scène le stakhanovisme par exemple pour pousser les ouvrier(e)s à produire plus et ne pas se contenter des quotas de production imposés. L’ouvrier(e) méritant(e) et obéissant(e) se voit promettre une meilleure vie, une éducation plus poussée, une hygiène plus développée. Et si ça n’est pas dans l’immédiat, ça sera dans le futur…Mais la jeunesse aussi a eu un rôle central, permettant un embrigadement précoce, à travers les différentes organisations de jeunesse, les Jeunesses Hitlériennes en Allemagne. Ce qui aboutit selon l’auteur à « (…) une nazification volontaire et joyeuse d’une majorité de la jeunesse ». Les Komsomols en URSS auront le même rôle, les enfants et jeunes se voyant attribuer des responsabilités, une liberté et une certaine confiance de la part de leur hiérarchie. L’auteur cite à plusieurs reprises le philosophe et historien Marcel Gauchet, toujours passionnant, pour son ouvrage, L’Avènement de la démocratie et ce dernier démontre parfaitement « (…) cette promesse d’une vie démultipliée par la communion avec ses pareils, au travers de l’identification à ce qui tient les êtres ensemble ». A travers l’exemple de la fabrication de la fameuse « Coccinelle » allemande, la Volkswagen (la « Voiture du peuple ») mise au point par Ferdinand Porsche, on constate « (…) la vision mobilisatrice du fol espoir d’un « peuple sur roues » dont la liberté de mouvement, assimilée à l’ivresse de l’élan vital, fait oublier l’enrégimentement politique ». L’exemple du cinéma en Allemagne et URSS est lui aussi frappant, loin, très loin, de ne produire que des films de pure propagande idéologique, « la logique totalitaire appelait le divertissement de masse et la comédie musicale en était le genre le plus adapté avec ses scénarios simplissimes et son aptitude à maquiller la réalité, ce qu’avaient compris tous les dirigeants communistes et nazis qui exigeaient des œuvres « compréhensibles » par tous ». La réflexion de Bruneteau est très éclairante, mais à condition d’avoir déjà de bonnes connaissances sur la mise en place et le fonctionnement de ces régimes (personnages, chronologie, notions-clés…) sinon le lecteur/la lectrice risque d’être un peu perdu(e) par cette analyse thématique et transversale. Pour connaître les bases de ces régimes, il vaut mieux lire un livre plus général, il existe de très bonnes synthèses. Le passage sur la construction de l’Homme nouveau soviétique et l’influence que Nietzsche a eu dessus m’a particulièrement intéressé : officiellement, Nietzsche était considéré en URSS comme le « philosophe du fascisme » et pourtant le régime stalinien a montré des « idées nietzschéennes non avouées » pour bâtir une culture communiste et mobiliser les masses, comme on le voit dans la représentation du surhomme-ouvrier sur de multiples affiches ou statues. Dans sa conclusion, l’auteur nous dit que « l’analyse d’un régime totalitaire doit ainsi intégrer ce rapport inclusion/exclusion, bonheur/terreur, qui est tout bonnement sa condition de fonctionnement ». Un ouvrage qui amène à se poser de nombreuses questions et qui permet de ne pas limiter ces totalitarismes à leur logique d’oppression, essentielle, mais de prendre en compte également leur part de séduction, une séduction perverse mais bien réelle sur de nombreux groupes sociaux concernés.