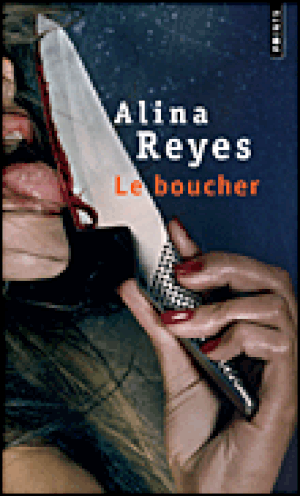Un livre parmi tant d’autres, probablement lu par mon père, récupéré chez lui après sa mort, que j’ai conservé peut-être grâce à sa couverture intrigante, la tableau d’une femme nue, allongée lascivement sur le sol, de dos, la croupe en lumière, œuvre de Georges Rohner, datée de 1948. Le titre de l’ouvrage ne colle guère avec cette couverture : Le Boucher ! De quoi éveiller l’intérêt.
Bien que l’ayant un moment envisagé, je n’ai pas tenté de réaliser le projet évoqué par un des personnages de Paul Auster dans un de ses romans, je ne sais plus lequel, celui de lire tous les livres qu’avait lus son défunt père. Trop de bouquins, des poches en très grande majorité, des centaines, peut-être des milliers. Des ouvrages intéressants mais aussi beaucoup qui ne m’attiraient pas. Le projet est intéressant, lire ce qu’a lu mon père, et par là-même en découvrir davantage sur lui, et peut-être mieux le comprendre. Mais le projet était trop lourd, je n’avais pas le temps, et nous avons donné la majorité des bouquins.
Voyons tout de même ce court roman. Un petit poche, chez Points Seuil, avec l’étiquette orange d’Euromarché, 23.75 francs. Une édition de 1988, une impression en 1990. Cela fait presque trente ans. Mon père était déjà seul depuis plusieurs années.
Alina Reyes – quel joli nom ! - entre vite dans le sujet, il est de suite question de chair, la chair froide de la viande, triste voire sinistre, ou celle de la narratrice, chaude au contraire, un corps qui vibre de désir, qui vit, tout simplement. Ce désir qui monte, mais surtout l’exultation du corps, qui peut détruire un amour, qui lui n’est d’abord qu’intellectuel.
Que trouva donc mon père dans ce livre, cet homme seul, acculé par un destin qu’il acceptait, sans combattre un instant ce coup du sort, terrassé sans retour possible ? Le corps se meurt peu à peu mais il faut qu’il exulte de temps en temps, cette formule est si vraie. Mon père aimait Bukowski, il lui ressemblait beaucoup, assurément, il aimait aussi Frédéric Dard, les grivoiseries, certaines lectures plus ou moins crues, plus ou moins érotiques, allégeaient peut-être un manque qui ne pouvait être totalement comblé. Je me souviens jeune ado un peu perdu, féru de lecture, abandonner chez mon père Jules Verne pour des lectures plus excitantes, interdites. Je me souviens notamment de Xaviera Hollander, qu’un récent article du Monde m’a rappelé à mon bon souvenir. (http://www.lemonde.fr/m-gens-portrait/article/2016/06/22/in-bed-with-xaviera-hollander_4955507_4497229.html)
Ce roman d’Alina Reyes, avec une écriture particulière mais précise, a-t-il su rappeler à mon père les souvenirs d’un passé qui était définitivement révolu ? A-t-il contribué à adoucir une forme d’irrépressible mélancolie ? En tout cas, dans ce premier roman, Alina Reyes décrit très bien la montée du désir qui seul maintient en vie et qui va vaincre l’amour, l’emporter, le déchirer, le détruire. L’importance du langage et des mots, des vibrations du corps, plus que des sentiments. Une apologie du lâcher prise, du principe de réalité. Laisser le corps vivre, ne pas le faire souffrir en le contrariant du fait de sentiments impossibles à concrétiser. Laisser le corps vivre et s’exprimer, avant qu’il meure.
Bukowski disait qu’« il faut bien que les gens s’occupent à quelque chose en attendant de mourir ». C’était exactement ça pour mon père, ce héros ordinaire, mon héros. La lecture de cet ouvrage me rapproche encore plus de lui.