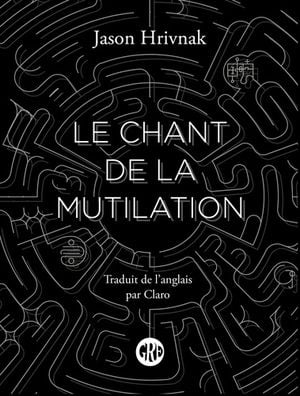Le livre de Jason Hrivnak traite principalement de souffrance physique et morale et de souvenirs – cependant, qu’on ne le prenne pas pour une énième exploration d’une mémoire, fût-elle celle d’un fou, ou pour une élégante variation autour du poids du passé. Si variation il y a, elle se fait sur un mode assez peu répandu dans la littérature contemporaine ; je ne vois guère qu’un Brian Evenson pour se placer dans une catégorie comparable, car un Chuck Palahniuk, par exemple (je pense à Damnés ou plus encore à Peste), pousserait trop clairement le macabre du côté de la farce. Mais si un livre prend à rebrousse-poil toutes les conneries de la pseudo-psychologie moderne (développement personnel, bienveillance proclamée, résilience…), c’est bien celui-ci.
Le narrateur principal, Dinn (« Diesel Ether Nuée Nuée »), démon « officier supérieur des enfers », « parle couramment et sans accent le langage de la violence » (p. 28, p. 21). Le sujet du roman, ou son prétexte : la formation d’une « recrue », vraisemblablement nommée Thomas / Tom (p. 162, p. 246) et appelée à rejoindre « la légion » démoniaque une fois parcourue « la voie senestre ». Le Chant de la mutilation – rien que ce titre ! – fait deux cent cinquante pages de tensions pures.
Cela passe par un contraste très net entre la noirceur absolue du propos et le caractère fictif du texte. Non pas que Jason Hrivnak mette en relief ce caractère fictif, car en somme il n’y en a pas besoin, mais enfin voilà : le Chant de la mutilation est un roman. On sait que c’est pour de rire, ou tout au moins pour de faux, que le livre ne va pas nous brûler ou nous ronger les mains, qu’on le refermera dès qu’il nous plaira, et pourtant de telles choses existent. Ça peut devenir drôle quand Dinn dit à Tom « Tu assistes à l’assaut de réalités embryonnaires, déchaînées par la seule force de mes paroles, car nous autres démons imposons notre volonté au monde matériel en le corrompant d’abord nommément. Ma voix et tes yeux, quand ils œuvrent de conserve, forment un instrument doté d’un vaste pouvoir transformateur » (p. 87)… Portrait d’un démon en écrivain ?
Pour prendre la chose dans un autre sens, il faut vous imaginer qu’un dentiste, sa roulette à la main – ou un scalpel, ou un fer à souder, ou un quelconque objet dont le contact avec une quelconque partie de votre corps ne promet pas grand-chose de délicieux –, s’approche de vous en répétant « C’est sans danger » ; et vous imaginer, en plus, que c’est réellement sans danger. D’ailleurs, pour le spectateur de Marathon Man, c’est en effet sans danger.
Lire le Chant de la mutilation, dont le narrateur n’est pas de ce monde, c’est donc ne pas pouvoir se raccrocher à un regard autre que son regard de lecteur, et c’est sans doute là que les ennuis s’accroissent. Le roman est constitué de passages sans aucun dialogue mais dont beaucoup reprennent les paroles de Dinn ou, plus rarement, de personnages secondaires (la mère de Tom, son ami Cubby, sa première et manifestement seule petite amie Linnea). Ces témoignages (?) ou ces anathèmes s’étalent parfois sur une demi-douzaine de pages.
La précision froide de l’écriture ajoute encore à ce malaise particulier. Qu’on pense à ce que donnerait cette histoire de folie et de démon, sous les plumes du tout-venant des auteurs de thrillers ou d’un traducteur inconséquent. (Si j’étais un écrivain anglophone, je voudrais que Claro me traduisît !) Et qu’on compare avec ceci, qui semble émaner d’un furieux hybride entre un psychologue clinicien hors de contrôle et un Lautréamont des grands jours – c’est à sa recrue que s’adresse ici Dinn : « En te raccrochant aussi furieusement au souvenir de Linnea tu l’as entraînée dans tes propres enfers privés, initiant une dynamique dans laquelle le mal qui pollue le moindre recoin de ton âme l’a également infectée. C’est dans ton attachement à cette dynamique égoïste que nous trouvons la graine la plus puissante de ton potentiel démoniaque. Et sous les lampes de serre de l’expérience extrême, je tourmenterai cette graine pour en faire quelque chose de terrible, je l’obligerai à rougir et à s’épanouir » (p. 69).
Oui, lire le Chant de la mutilation, c’est aussi lire de longs paragraphes dans lesquels chaque phrase a l’air d’une brique, et qui constituent chacun une brique d’un bâtiment qui serait le roman entier, construit en direct par Dinn, – ou sous ses ordres. Car tandis que ce dernier laisse parfois la parole à des personnages secondaires, Tom ne dit pas un mot, même avant de « devenir le démon qui ne peut pas parler » (p. 252), c’est tout juste s’il émet, à deux reprises, quelques propos confus, en utilisant le code radio des démons.
« L’air matinal était empreint d’une calme désolation, comme une trêve » (p. 10). Tout le livre est à cette image : jamais de repos, seulement des trêves. Cela se voit notamment, et c’est relativement fréquent, lorsqu’à la fin d’une phrase surgit une image inattendue : « Je fermai les yeux et m’imaginai dominant les corps brisés de toutes les recrues que j’avais assassinées au fil des ans : les cadavres s’empilaient presque jusqu’à la taille autour de moi et, enfoui sous eux, un tiède filet de décomposition coulait comme de la soie sur mes pieds » (p. 12), dit encore Dinn.
Par conséquent, si lire le Chant de la mutilation est éprouvant, ce n’est en rien à la façon de cette littérature d’horreur qui accumule les détails macabres ou même les suggère, mais plutôt comme l’illustration d’une sorte de philosophie d’horreur, ou de psychologie d’horreur. Un passage tel que « Le blasphème fondamental dont est coupable l’humain consiste dans sa croyance en sa propre individualité, et l’amour représente un jumelage de ce blasphème, un jeu de miroirs dans lequel deux animaux stupides renforcent leurs illusions de partager un destin unique et spécial » (Dinn à Tom, p. 107) pourrait tout à fait figurer dans le cerveau d’un grand dépressif ou – c’est compatible ! – sous la plume d’un Cioran, par exemple.
Il y a dans le roman des considérations encore moins discutables, en particulier dans son dernier tiers : « De toutes les habitudes répréhensibles des mortels, celle que je déteste le plus est ce retour immédiat à l’égocentrisme d’un enfant dès lors qu’ils sont confrontés à une forme de douleur » (p. 192). Oui, dans la vie, il y a d’un côté les choses et de l’autre la manière de les dire, et certaines pages du livre sont au réconfort moral ce que du papier de verre (gros grain) est à la caresse : Dinn, c’est le genre de formateur à dire à son stagiaire : « Il [son ami Cubby] se fit exploser la cervelle et pendant que tu digères la nouvelle de son suicide, je vais énumérer certains des aspects clés qui te rendent complices de sa mort » (p. 171).
Et si, pour Dinn, l’homme est un démon déchu, Jason Hrivnak sait – peut-être grâce à Mark Danielewski, en tout cas autant que lui – qu’un bon livre, comme la conscience d’un lecteur, comme l’âme d’un vivant, sont à l’image de cette installation infernale qui « comporte un énorme labyrinthe, un vaste espace intérieur qui se déchaîne sans se plier aux dimensions extérieures de son contenant » (p. 103).