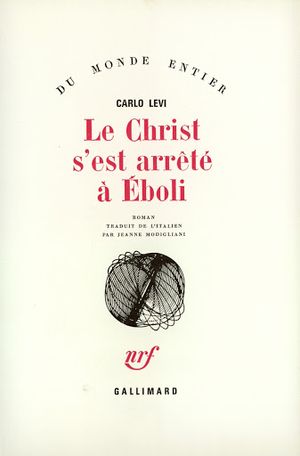La meilleure présentation de ce livre serait probablement d’en lire les deux premières pages, qui vous percutent en pleine face par leur profondeur et la violence qu’elles décrivent. Si le Christ s’est arrêté à Eboli, alors tous les territoires au sud d’Eboli ne peuvent être considérés comme chrétien. Et ne pas être chrétien dans l’Italie de l’époque, c’est ne pas être humain.
Carlo Levi était un « confinato », un homme exilé par le régime fasciste dans un village du sud, comme plein d’autres, pour des raisons qui ne sont pas toujours idéologiques. On pouvait être exilé pour toute sorte de raisons, comme étudier un sujet suspect à l’université, ou ne pas plaire au chef local qui vous envoyait alors dans des contrées que l’État avait à peu près désertée, si ce n’est pour y lever des taxes sur une richesse déjà inexistante.
Levi est un médecin, un peintre et un écrivain, il est né dans le Nord, et rien ne le prédestinait à découvrir le Sud. Le « problème méridional » est découvert par Levi dans tous les aspects que le régime fasciste, comme le royaume qui le précédait et la république qui lui a succédé ont ignoré. Tout le monde se fiche du Sud, qui vit en dehors de l’histoire, et Levi s’en serait fichu aussi toute sa vie s’il n’avait pas été forcé d’y vivre.
Ce livre décrit son quotidien dans un petit village qu’il appelle Gagliano (en fait, celui d’Aliano), dans l’actuelle Basilicata. Il ne s’y passe rien, la misère est rythmée par les saisons et les rares échos du dehors. Pourtant, des êtres y vivent, exclus de l’humanité, du christianisme, de l’Italie même, qui grattent un sol argileux ingrat pendant que les brigands ont pris du galon grâce au régime en place et se font appeler podestats, et qui porteront plus tard le nom de mafia. Parmi les paysans, la malaria fait rage. La capitale, Matera, est une capitale du prolétariat en lambeaux, lambeaux de chair et lambeaux de tissus entremêlés dans des habitations troglodytes où le soleil ne pénètre pas, alors qu’au sommet de la ville, les nouveaux édifices coloniaux du Faisceau existent sur un plan supérieur ; les deux villes ne se rencontrent jamais, sinon à l’heure de l’impôt.
Levi donne une voix à ces êtres. Il ne décrit pas leur quotidien par exigence stylistique de réalisme, mais parce que l’urgence toujours recommencée de la pauvreté exige qu’il parle, qu’il écrive, alors même que la guerre n’est pas terminée (il écrit en 1943). Levi se laisse transformer par Gagliano ; son texte décrit sa transformation. Ce n’est plus l’État fasciste qu’il abhorre, mais tous les États, l’étatisme, une autorité romaine universelle qui s’immisce dans les campagnes comme un serpent. C’est un colonialisme intérieur : la métropole réduit les âmes et les corps à de simples subalternes (pour reprendre le mot qui sera de Gramsci), sans voix et sans espoir.
Je ne peux rien dire de la traduction française. En italien, l’effet est dans le fond comme dans la forme. Sa langue est complexe et nous déstabilise, car le sujet exige d’être mal à l’aise dans notre lecture et dans notre morale. C’est un livre évidemment politique, mais qui annonce aussi des luttes à venir, et pas seulement en Europe. Tous les peuples subalternes subissent le sort de Gagliano. On ne peut comprendre une société que par ses marges : si vous voulez comprendre l’Italie, ne vous arrêtez pas à Eboli.