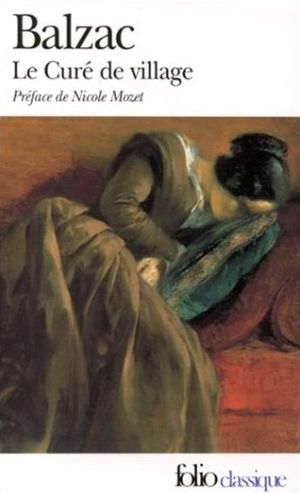Romantique, légitimiste, imparfait, mais...
"Le curé de village" ne se centre pas sur un personnage, mais sur son sujet. Balzac en a tiré d'ailleurs plusieurs versions dont il reconnaissait qu'elles n'étaient pas exactement ce qu'il désirait faire. Comment en suis-je venu à lire ce livre ? Très simplement : j'ai appris qu'il se passait en partie à Limoges. Connaissant bien la ville, ça a piqué ma curiosité.
----------------------------------------------------------------------------------------
Le livre se décompose en plusieurs chapitres. Si vous ne voulez pas savoir la suite, passez directement aux pointillés suivants.
- "Véronique" : Véronique Sauviat est la fille d'un ferrailleur de Limoges qui a fait fortune. Elle épouse la première fortune de la ville, Graslin, un banquier laid, qui ne pense qu'à l'argent et la délaisse après une courte période de grâce. Quand Graslin meurt, elle tient salon et devient une figure importante de la ville, malgré ses crises de mélancolie. A la fin du chapitre, elle devient brusquement épanouie, sans que l'on sache pourquoi.
- "Tascheron" raconte une affaire qui enflamme Limoges : un ouvrier porcelainier connu pour sa probité, Jean-François Tascheron, est accusé d'avoir dérobé l'or d'un vieil avare, de l'avoir tué, lui et sa fille. De nombreux indices l'accablent, et suggèrent la présence d'un complice, que l'on s'imagine facilement être une femme. Probablement une femme de la haute bourgeoisie limougeote. Tascheron est condamné par l'Avocat général, le vicomte de Grandville, à être exécuté. Mais l'Eglise demande à ajourner la peine. Car le condamné hurle comme un possédé dès qu'on parle de religion. Après un conciliabule dans les jardins de l'Evêché, sur conseil de l'abbé DUtheil, l'évêque envoie son secrétaire à Montégnac, sous-préfecture pauvre et patrie de Tascheron, pour en ramener le père Bonnet, pour qu'il convainque Tascheron d'accepter les derniers sacrements.
- "Le curé de Montegnac" voit l'abbé de Rastignac, le secrétaire de l'évêque, arriver à Montegnac. Bonnet accepte de revenir à Limoges avec la mère et la soeur de Tascheron, qui s'apprêtent à quitter la France avec toute la famille pour éviter l'opprobre. Tascheron accepte de révéler où était la cache de l'argent (dans la Vienne), mais fait détruire par sa soeur les pièces compromettantes pour son amante, dont il refuse de lâcher le nom. Après l'exécution, Véronique, très affectée, décide de partir refaire sa vie à Montegnac.
- "Madame Graslin à Montegnac" commence par une longue description du désert qu'est la région entre le Limousin et la Corrèze. Véronique s'installe dans le château en cours de restauration, mais dépérit. L'abbé Bonnet la convainc de faire pénitence (mais de quoi donc ?) en amenant le bonheur dans le pays. Véronique rassemble autour d'elle bien des capacités (dont Gérard, un polytechnicien désolé de s'ennuyer aux Ponts et Chaussées), fait construire un barrage qui permet d'alimenter tout une plaine sur le modèle de la plaine padane. La richesse afflue, le pays revit, elle est considérée comme une mère nourricière pour le pays.
- "Véronique au tombeau" : Les travaux ont marché, mais Véronique dépérit à nouveau. Elle tombe sur une jeune femme qui accoste le fils qu'elle a eu de... oui, de Jean-François, tu as bien deviné, ami lecteur. Cette jeune personne est la soeur du condamné à mort. Devant ce coup au coeur, Véronique sent sa dernière heure venue. Elle fait rassembler le village à son chevet. L'évêque, l'Avocat Général viennent de Limoges (Bianchon vient même de Paris !). Elle fait des aveux publics : oui, elle fut l'amante de Tascheron. Puis elle expire. Ses bonnes oeuvres lui survivent.
-----------------------------------------------------------------------
Roman déroutant, car contrairement à ce que son titre laisserait entendre, l'action ne se concentre pas uniquement sur le personnage de l'abbé Bonnet. Roman à idées, assez bavard, qui compte de longues tirades dans lesquelles Balzac professe ses opinions carlistes, plus férocement que d'habitude. Il y a notamment ce long tunnel relatant un déjeuner chez Madame Graslin, où l'ingénieur, le prêtre, le juge et d'autres sont réunis et renchérissent sur les causes de la décadence de la France : la suppression du droit d'aînesse va atomiser les propriétés, appauvrissant la France (vu que les petits paysans thésaurisent) ; la République ou la monarchie à la Louis-Philippe ne produira que des hommes médiocres, des démagogues, là où des décisions tranchées sont nécessaires. Les libertés développent l'individualisme, l'atomisation des individus, la ruine des idéaux. ça décoiffe encore plus sévère que du Tocqueville.
Le livre tourne autour de deux thèmes, outre l'exercice consistant à imaginer le développement d'une région déshéritée, que l'on trouvait aussi dans "Le médecin de campagne". Le premier thème est l'opposition entre l'Eglise, pouvoir sur les âmes, deux fois millénaires, et l'Etat, monstre froid qui ne sait pas utiliser ses capacités (voir la tirade de 7-8 pages contre l'Ecole Polytechnique, ou plus précisément contre la centralisation administrative). Le second thème, qui aurait pu être plus approfondi, est la possibilité de racheter un crime par de bonnes actions.
C'est assez hétérogène au niveau composition. Si le début rappelle du Balzac traditionnel, à la Eugénie Grandet, les tartines un peu verbeuses du milieu évoquent plutôt le Balzac bavard des débuts ("La peau de chagrin"). La fin, au contraire, avec ce paysage transformé par le génie humain, qui ne parvient pas cependant à rasséréner une âme en détresse, fait furieusement penser au Goethe des "affinités électives".
Donc oui, ce n'est pas parfait, mais ce n'est pas inintéressant non plus. Je ne conseille pas ce Balzac pour commencer, mais pour approfondir l'oeuvre de cet auteur. Pour en bien comprendre toutes les facettes, il me semble important, notamment en le rapprochant du "Médecin de campagne".