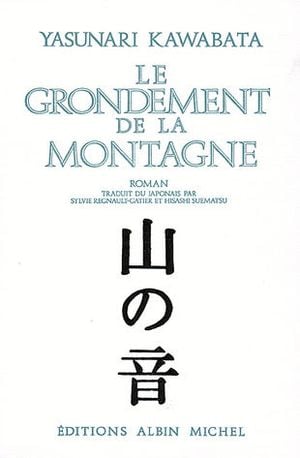Roman lu un peu par hasard ; de Kawabata, je connaissais ses plus célèbres Pays de neige et Les Belles Endormies, qui ne m’avaient ni l’un ni l’autre tout à fait conquis ; j’en gardais un souvenir plutôt vague, celui de romans au style certes sublime et raffiné à souhait, aux passages contemplatifs tout en raffinement et mélancolie, mais par ailleurs sans doute trop abstraits, se laissant peut-être justement un peu trop aller à la pure contemplation et ne prenant pas le temps d’ancrer ses personnages et ses environnements dans un monde palpable et viscéral.
Toutefois ce n’est bien qu’un vague souvenir, et il est fort possible que la faute du léger blocage qui se soit dressé entre moi et les livres ne viennent pas tant du style de l’auteur que de moi-même ; c’est du moins ce que j’ai pensé dès que je m’étais plongé dans les premières pages du Grondement de la montagne.
Après un prologue tout en sobriété et élégance, et qui pose déjà le style et quelques questionnements majeurs qui parcourent la suite de l’œuvre, Kawabata nous immerge dans le quotidien de Shingo, et de sa vie de famille. Une scène particulièrement fascinante de laquelle j’aurai bien du mal à décrire une fulgurance particulière, si ce n’est l’authenticité dont elle transpire, annonce le génie de la suite : le passage à la poissonnerie, et la précision avec laquelle sont décrites les gestes de l’artisan, l’arrivée des prostituées ; qui n’a pourtant aucun impact sur le reste du récit, mais parvient, grâce au style de Kawabata, à captiver complètement le spectateur.
C’est véritablement la force majeure de ce roman : son authenticité, et la justesse avec laquelle l’auteur s’emploie à porter un regard sur ses personnages : Shingo en premier, est aussi attachant qu’il peut paraître au lecteur lâche (repoussant jusqu’à ce qu’il soit trop tard me moment d’intervenir dans le mariage vacillant de sa fille, le comportement frivole de son fils), égoïste (alors qu’il tente « d’acheter » la maîtresse de son fils), injuste (envers sa fille et sa petite-fille, méprisées au profit de sa jolie bru lui évoquant un amour d’enfance), froid (lorsqu’il observe avec dégoût le corps vieillissant de sa femme), qu’il peut être sympathique (dans les vacheries amusantes qu’il échange avec sa femme), esthète (dans les nombreuses rêveries contemplatives auxquelles il s’abandonne), voire profondément touchant (dans les nombreux moments de complicité qu’il partage avec sa bru, dans ses questionnements et lorsqu’il éprouve ses craintes existentielles).
On ressent dans cette passion pour les personnages complexes et authentiques un génie qui évoque quelques-unes des plus belles expériences naturalistes, du cinéma français notamment, et qui confine à l’obsession, à la manière d’un Pialat ou d’un Kechiche ; à la différence près qu’ici l’élégance absolue du style et sa sobriété ajoute une dimension épurée et contemplative qui rapproche l’œuvre de Kawabata de la pure poésie.
Ainsi, il décrit avec autant de précision et d’élégance l’intériorité des personnages, leurs contradictions, que la matérialité du monde qui les entoure et les façonne : la part belle est faite à leur routine – les nombreux trajets en train pour atteindre le bureau, les séances d’introspection nocturnes pour tromper l’insomnie –, mais il détourne le lecteur de l’ennui en faisant de chaque moment banal l’occasion d’une envolée lyrique et sensuelle, en particulier grâce à la contemplation du monde : les camélias d’un buraliste, les tournesols d’un jardin voisin, un cerisier dont les branches couchées sur la route répandent leurs pétales, le néflier d’un ancien parc impérial, un pin aperçu par la fenêtre du train et jusque-là jamais remarqué…
Kawabata signe donc une œuvre hommage à la vie, y compris et surtout dans ce qu’elle a de plus vulgaire et banal. Tout événement qui mériterait d’être traité dans une œuvre vraiment romanesque est relégué au second plan : ainsi la double-vie criminelle du mari de Fusako, qui connaît une fin tragiquement théâtrale, et dont on apprend tout au détour d’un article de journal ; ou, les recherches sur une miraculeuse graine de lotus préhistorique, dont on suivra l’évolution grâce aux journaux également. Faisant office de simple toile fond, ces histoires enrichissent en fait doublement l’œuvre : d’une part, elles font ressortir avec d’autant plus de vigueur le caractère tout-à-fait ordinaire des péripéties de la famille de Shingo ; et pourtant, de ce fait, elles confèrent également à la diégèse du monde dans lequel les personnages évoluent une aura de mystère.
Car le roman est pourvu d'un aspect onirique et introspectif qui s’insère parfaitement dans la narration pourtant naturaliste, laquelle, bien que sachant prendre une certaine distance et observer les pensées de son protagoniste, éprouve le monde et les situations à travers ses yeux. Dès lors, les zones de flou n’apparaissent plus comme une imprécision ou une tentative d’abstraction de la part de l’auteur, mais bien comme les vagabondages internes d’un vieillard crépusculaire, pour qui la vie reste à bien des égards encore un mystère.
Kawabata observe un homme assailli de toute part par la mort (voyant mourir un à un ses amis de fac, aux enterrements des quelques-uns il assiste d’ailleurs), un homme dont la vie semble s’écouler comme un rêve distant ; l’omniprésence de l’exceptionnel, mais qui ne constitue qu’une trame de fond au principal de l’œuvre, les nombreux récits de rêve (au symbolisme parfois évident, parfois complètement abscons), l’importance accordée aux souvenirs – la châtaigne qui rappelle à Shingo son mariage – et à l’oubli (le prologue, la geisha dont il est certain d’oublier le nom), les éléments troublants qui ponctuent le récit (la femme assise à côté de son « sosie paternel »), les déguisements (les masques de nô dont il hérite au décès d’un de ses amis), les changements sociétaux que traversent la société japonaise (le passage au calendrier occidental, qui fait changer d’âge les personnages, l’arrivée de l’électroménager) et bien sûr, ce fameux grondement de la montagne, impossible à entendre, sont autant d’éléments dont Kawabata se sert pour tisser du monde une tapisserie sur le motif de l’illusion et du mystère, et confère à ce récit naturaliste une dimension métaphysique vertigineuse.
On retrouve là une marque des traditions bouddhiste et zen du pays ; un héritage spirituel qu’il assume parfaitement, en témoigne le chapitre où Shingo accompagne sa petite fille voir la statue du Bouddha Amida près de chez eux ; et plus globalement l’importance accordé à la contemplation de la nature, procédé qui ancre à chaque instant l’homme dans l’interdépendance du monde.
À la manière du Burning de Lee Chang-dong, qui allie lui aussi un fort caractère social à un aspect contemplatif et un rythme onirique, Le Grondement de la montagne nous offre le témoignage universel d’un homme mis face aux questionnements de l’existence. C’est quasiment le Mystère du monde qui est contenu dans ces quelques pages, et retranscrit avec brio de la perspective humaine. La plume constamment en équilibre sur un fil tendu entre matérialité naturaliste et envolée métaphysique, Kawabata parvient à toujours tirer le meilleur des deux approches et forge un livre vraiment unique.