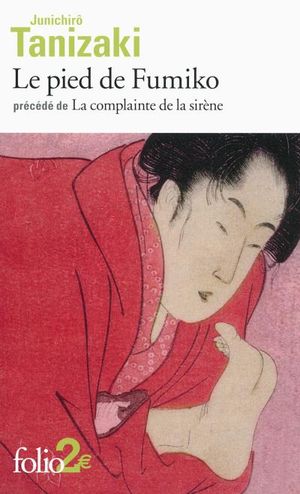Critique initialement publiée sur mon blog : http://nebalestuncon.over-blog.com/2018/12/le-pied-de-fumiko-de-junichiro-tanizaki.html
Retour à Tanizaki, avec ce très bref recueil de la collection Folio 2 €, reprenant deux nouvelles (a priori de jeunesse, j’ai croisé la date de 1919 ici ou là) du fameux écrivain nippon, un des plus grands du XXe siècle – deux textes dans lesquels l’auteur de La Clef, entre autres merveilles, dissèque la passion amoureuse, avec ce petit quelque chose d’insidieusement pervers, en même temps que d’une immense élégance, qui me paraît, pour ce que j’en sais (c’est-à-dire fort peu...), caractéristique de son art ; à vrai dire, « ce petit quelque chose » n’est pas si petit, dans la nouvelle-titre en tout cas…
Mais le petit volume s’ouvre donc sur « La Complainte de la sirène », un conte très joliment traduit par Jean-Jacques Tschudin, Madeleine Lévy-Faivre d’Arcier s’étant pour sa part occupée du « Pied de Fumiko ». « La Complainte de la sirène », en fait de nouvelle japonaise, se situe presque intégralement en Chine, sous la dynastie Qing (1644-1912) – a priori à une date assez reculée, car il nous est dit que la dynastie était alors au faîte de sa gloire, et les Occidentaux peu présents dans le pays. Mais la précision n’a sans doute pas une grande importance en la matière, car le ton est donc celui du conte (« il était une fois » inclus), ou de la fable – et si le cadre chinois peut avoir quelque chose d’exotique pour l’auteur, le héros du récit, un prince d’une grande beauté, d’une grande fortune, et qui s’ennuie profondément, pourrait sans peine évoquer une sorte de Genji (rappelons que Tanizaki consacrerait beaucoup de temps, ultérieurement, à livrer une « traduction » en japonais moderne du chef-d’œuvre de Murasaki Shikibu). De fait, ce prince est fatigué de la vacuité de sa débauche – il a longtemps prisé beuveries et coucheries, mais il est devenu las de toute cette médiocrité. Il cherche une femme qui saura susciter et entretenir sa passion amoureuse, mais, si les candidates sont nombreuses, aucune ne lui sied vraiment – il a déjà pour concubines sept des plus belles femmes de Chine, mais elles l’ennuient elles aussi.
Un jour, pourtant, un étranger venu de la lointaine Europe se rend auprès du prince, dont il a appris les ambitions frustrées, et prétend les satisfaire enfin en lui apportant la plus belle des créatures : une sirène ! Le barbare a le bagout d’un escroc, mais son esclave paraît authentique. Sa beauté inhumaine est exactement ce dont le prince avait besoin. Mais c’est une créature d’une infinie tristesse, qui ne peut que se heurter au désir maladif de ce prince qui, une dernière fois, retrouve goût à la vie. Le sort cruel de la sirène n’exclut pas une certaine cruauté de sa part à l'encontre du prince, qui perce sous une mélancolie commune et dès lors à même d’être partagée.
Cette trame, et ce d’autant plus qu’elle joue des outils du conte, ne présente rien de bien inédit. Pourtant, la nouvelle emporte la conviction, et à plus d’un titre. Ce qui m’a particulièrement séduit, ici, tient à des développements beaucoup moins attendus : ainsi, l’évocation de la beauté de la sirène entraîne, chez le barbare surtout, mais le prince s’y montre naturellement réceptif, un véritable discours esthétique, très enflammé, mais aussi joueur et pour partie au moins moqueur ou du moins ironique, qui offre comme un contrepoint mêlant sincérité et ironie au fameux essai de l’auteur qu’est l’Éloge de l’ombre, plus tardif à vue de nez – c’est à se demander ce qu’il faut vraiment prendre au sérieux… dans ces deux textes. Ceci d’autant plus que la confrontation du prince et du barbare débouche chez le premier sur une véritable fascination pour le lointain et exotique Occident – la sirène, en quelque sorte, n’est que le véhicule, même particulièrement outré, d’un désir du prince (et de l'auteur ?) d’en savoir plus quant à ce monde si différent du sien, et comme tel bien plus fascinant. On est probablement en droit de se demander, ici, ce qui relève des personnages et ce qui relève de l’auteur – Tanizaki, comme bien d’autres écrivains japonais de son temps, incluant Sôseki et Akutagawa, etc., révèle peut-être ici plus que jamais ce tiraillement obsédant, emblématique des intellectuels de Meiji et, peut-être surtout ? de Taishô. La sirène y est d’autant plus propice qu’elle évoque aussitôt, et pas seulement pour des lecteurs européens, car le marchand barbare joue pleinement de ces références, elle évoque aussitôt, donc, Andersen bien sûr, mais aussi, avec quelques accommodements de circonstance, Homère.
C’est ici, je crois, que réside la singularité de la nouvelle. Maintenant, elle brille aussi, comme de juste, par la forme : Tanizaki est un maître, et tout particulièrement en matière de descriptions – elles sont toutes d’une finesse exquise, d’une attention au détail peu ou prou unique, et suscitent des pages exprimant une beauté pure et pourtant teintée d’un soupçon de malaise, en plein accord avec la séduction quelque peu malsaine de la triste sirène.
Mais si « La Complainte de la sirène » séduit sous cet angle, « Le Pied de Fumiko », tout bonnement, stupéfie. C’est ce qui fait du premier de ces textes une bonne nouvelle, et du second un chef-d’œuvre.
« Le Pied de Fumiko » narre la passion maladive et à terme fatale d’un vieil homme plus qu’un peu pervers, du nom de Tsukakoshi, pour sa jeune et belle maîtresse, ou, surtout, pour le pied de ladite. C’est une nouvelle sur un foot fetishist, en angliche in ze texte – un trouble répandu bien au-delà des seuls films de Quentin Tarantino (pardon). Mais elle adopte une forme très particulière – celle de la lettre écrite à Tanizaki himself par un jeune homme qui lui suggère de tirer une nouvelle de l’histoire authentique qu’il lui raconte, une nouvelle qui pourrait se montrer intéressante… Le jeune homme est pourtant amené à rédiger lui-même une nouvelle, en fait de lettre.
Mais, surtout, il décrit avec un grand luxe de détails et une admirable adresse formelle (celle à n’en pas douter du Maître Tanizaki) la ronde de la perversion qui tourne autour du vieux Tsukakoshi. On ne s’étonnera guère de ce que Fumiko, ex-geisha plus qu’intéressée par la fortune de son « protecteur », fasse preuve à son encontre d’une certaine cruauté, au point du sadomasochisme d’une certaine manière, mais aussi en courant de nouveaux amants/protecteurs tandis que Tsukakoshi agonise – rassurez-vous cela dit, elle lui offrira en dernier recours la contemplation rapprochée de son pied de déesse…
Mais ce n’est pas ce qui prime, en fin de compte. Car, si la perversité du Retraité, ainsi que le désigne le jeune homme, paraît tout d’abord au centre du récit (et présage éventuellement des textes ultérieurs de Tanizaki, notamment le Journal d’un vieux fou), il apparaît bientôt que le jeune homme, peintre de son état (et à l’occidentale, même s’il est ici appelé à se pencher sur des estampes – là encore, on est tenté de voir un auteur entre deux mondes), ce jeune homme donc n’est pas moins un foot fetishist que son employeur et/ou mentor, outre que c’est lui aussi par intérêt, comme Fumiko, qu’il s’insinue dans le premier cercle des intimes du vieil homme malade – c’est après tout notre peintre, pas le Retraité, qui va, sur des pages et des pages d’une plume exquise, pousser l’habileté frappante de Tanizaki pour la description très minutieuse jusqu’à ses derniers retranchements, à l’extrême limite de l’absurde, manière étonnante de sublimer la beauté ; on reste bien dans le discours esthétique, en définitive, et la beauté de Fumiko est comme de juste renforcée par de menues imperfections, comme dans l’Éloge de l’ombre. Ceci, toutefois, le peintre l'accomplit censément pour honorer l’ultime commande de Tsukakoshi – qui entend reproduire avec Fumiko une saisissante et quelque peu acrobatique estampe de Kunisada mettant en valeur le pied de son modèle. De la sorte, Tanizaki, via son « correspondant », peint un tableau avec ses mots – et c’est très impressionnant, très fort, très beau, même si ces pages très joueuses confinent à l’exercice de style un peu moqueur sinon vain.
Mais peut-être que cela aussi doit être intégré dans cette ronde de la perversion ; qui, ici, mérite le plus d'être qualifié de la sorte : Tsukakoshi, Fumiko ? Le peintre ? Tanizaki lui-même, qui joue à feindre de ne pas être l’auteur tout en se donnant du Maître et en brillant de mille feux à chaque page ? Son lecteur, jamais rassasié de détails infimes et de situations embarrassantes ? En dernier ressort, si tous ont quelque chose en commun, je tends à croire que c’est le désir vicié, pour ne pas dire le vice tout court. Et le délice qui va avec.
C’est merveilleux, admirablement écrit, admirablement traduit. « Le Pied de Fumiko » est une excellente nouvelle, et, oui, on peut la concernant parler de chef-d’œuvre.
Une lecture hautement recommandable, donc, que ce petit volume. Et il me faudra encore poursuivre la découverte de l’œuvre de Tanizaki, assurément.