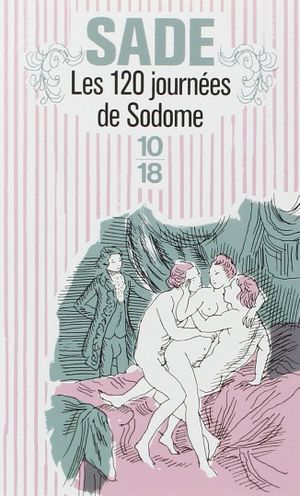Le sadisme n'est pas si effrayant, l'auto-sadisme est bien plus dérangeant ; si ce livre a de quoi glacer ce n'est pas (ou pas tant) à cause de ses descriptions de méfaits, c'est plutôt pour celle des ordures et l'obsession de dégradation dont se délectent ses protagonistes. Et quand ce goût les poussent à se souiller eux-mêmes et se transformer en carcasses, alors on tombe dans un registre des plus répugnants et démoralisants – à côté, les meurtres inéluctables ne sont rien et on comprend trop bien qu'ils aient perdus de leur valeur puisque la vie déjà, du moins la vie saine ou innocente, n'en a aucune – elle est devenue une aberration révoltante, une incitation à renchérir la souillure.
Mais et c'est un comble, la lecture est déplaisante pour des raisons autant triviales que morales ; ces 120 journées de loin inachevées (ou pour être précis, aux trois quart survolées) sont terriblement redondantes et laborieuses. Beaucoup de choses sont en suspens, celles relatives aux 'cabinets' ne seront pas éclairées ; celles tenant des narrations seront résumées ou suggérées dans les plans des trois derniers mois [quarts]. Aucun risque d'éprouver des sympathies particulières – les personnages sont passifs et aliénés, les révoltes des victimes sont minimales, leur expression à peu près inexistante ; et la litanie de leurs supplices ordinaires est un marécage de confusion permanente (culminant avec les diverses tortures incohérentes de Narcisse dans les dernières pages, où ses membres disparus sont à nouveau sacrifiés !?). Souvent l'approche tient de la comptabilité, les présentations des quatre salauds puis une partie des histoires de Duclos limitant l'abrutissement – et livrant, notamment lors du déluge de merde des pages 200, des saillies presqu'aussi drôles qu’écœurantes (comme ces clients dans leurs tonneaux d'étron avec le « vit » dépassant).
Les nouveautés aux abords de la page 300 s'avèrent rapidement décevantes ; les passages philosophiques où sont célébrés les principes d'injustice et la tyrannie croulent à leur tour sous la répétition, de même que ces passions autrement excentriques relevant de la nécrophilie. S'il y a une volonté supplémentaire à celle de salir, c'est celle d'avachir. Et même si Sade reconnaît que la première partie (c'est-à-dire l'essentiel de ce qui nous est parvenu) est trop longue, ses 120 journées finales se seraient étalées sur au moins 2.000 pages. Or l'hilarité est bien trop modérée et la nausée l'emporte à la lecture du plan non-réalisé, spécialement lors de la partie « criminelle » [la troisième], moins dans l'ultime 'meurtrière' car l'imagination y redouble et justifie l'affiliation aux surréalistes. Dans le meilleur des cas, cette lecture aurait été régulièrement ennuyante puis assommante ; sinon elle devenait gravement démoralisante et amenait le curieux dans un état proche de celui qui aurait passé trop de temps à se griller l'âme, la tête encerclée de snuff ou de black metal trve tournant en boucle dans sa prison passée d'imaginaire à constitutionnelle.
Le lecteur découvre une littérature des caniveaux et de dépravation avant une de souffrances et jouissances raffinées ; la réputation du 'Divin Marquis' est manifestement tronquée et cette portion de son œuvre est en de nombreux endroits digne des rêveries de Jean-Louis Costes, sans en avoir l'écoulement facile, sans profiter du panache de la bêtise revendiquée – mais en déployant infiniment plus de méchanceté et de détermination ! Finalement le réhabilitateur Apollinaire a livré une abjection supérieure avec ses Onze mille verges (plus ramassée, consistante, aussi transgressive et à peine moins fantaisiste – grâce notamment à sa scène du train). Quand à Sade qui vénérait cette œuvre par-dessus ses autres, il a fait mieux par la suite avec sa série Justine & Juliette – en soulignant le désespoir et montrant les coups de la vertueuse Juliette. Par contre il a dû atteindre ici son sommet dans l'horreur – et peu de créateurs, d'assassins ou de dictatures sont parvenus à le rejoindre. Dans ces 120 journées nous sommes accablés unilatéralement – pas de lutte, pas de nuances, pas le moindre conflit – nous sommes en cellule, pour abandonner toute estime et toute candeur envers nos prochains.
https://zogarok.wordpress.com/2021/03/21/les-120-journees-de-sodome-sade/
Florilège :
Le président de Curval était le doyen de la société. Agé de près de soixante ans, et singulièrement usé par la débauche, il n'offrait plus qu'un squelette. Il était grand, sec, mince, des yeux creux et éteints, une bouche livide et malsaine, le menton élevé, le nez long. Couvert de poils comme un satyre, un dos plat, des fesses molles et tombantes qui ressemblaient plutôt à deux sales torchons flottant sur le haut de ses cuisses ; la peau en était tellement flétrie à force de coups de fouet qu'on la tortillait autour des doigts sans qu'il le sentît. Au milieu de cela s'offrait, sans qu'on eût la peine d'écarter, un orifice immense dont le diamètre énorme, l'odeur et la couleur le faisaient plutôt ressembler à une lunette de commodités qu'au trou du cul ; et pour comble d'appas, il entrait dans les petites habitudes de ce pourceau de Sodome de laisser toujours cette partie-là dans un tel état de malpropreté qu'on y voyait sans cesse autour un bourrelet de deux pouces d'épaisseur. (p.29)
Il est bien certain, dit le président, que je n'aime pas la progéniture, et que quand la bête est pleine, elle m'inspire un furieux dégoût, mais d'imaginer que j'ai tué ma femme pour cela c'est ce qui pourrait vous tromper. Apprenez, garce que vous êtes, que je n'ai pas besoin de motif pour tuer une femme, et surtout une vache comme vous que j'empêcherais bien de faire son veau si elle m'appartenait. (p.165-166)
40 Il fout une chèvre en narines, qui, pendant ce temps-là, lui lèche les couilles avec la langue ; pendant ce temps-là, on l'étrille et on lui lèche le cul alternativement. (p.389)
76 Il la gonfle de boisson, puis il lui coud le con et le cul ; il la laisse ainsi jusqu'à ce qu'il la voie évanouie de besoin d'uriner ou de chier sans en pouvoir venir à bout, ou que la chute et le poids des besoins viennent à rompre les fils. (p.395)