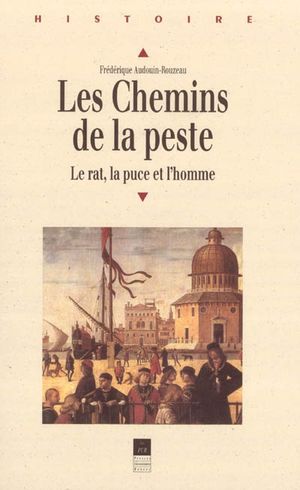Frédérique Audouin-Rouzeau est une archéozoologue de formation mais elle est bien plus connue comme une des meilleures auteures de polar française sous le nom de Fred Vargas. Dans cet ouvrage conséquent et solide, elle cherche à nous expliquer, en remontant le temps, comment précisément la peste se transmet, ce qui est essentiel pour savoir de quelle manière lutter contre cette maladie. Une maladie qui reste d’actualité : « L’histoire de la peste n’est pas close : la capacité de survie du bacille dans les profondeurs de la terre constitue une menace constante et imprévisible pour les hommes, et la maladie continue de sévir régulièrement en diverses régions du globe » nous dit-elle. Il ne s’agit donc pas ici de raconter chronologiquement les grandes épidémies de peste, de la 1ère, « la peste justinienne » du VIe au VIIIe, jusqu’à la 3e pandémie, au début du XXe s, touchant Paris en 1920 (la « peste des chiffonniers ») mais aussi Glasgow et Barcelone, avec des conséquences moindres que dans le passé. Une maladie qu’on a commencé à mieux saisir seulement à la fin du XIXe s avec la mise en évidence du rôle du rat comme véhicule de la maladie puis de ses puces comme vecteur. Toute épidémie de peste commence par une épizootie touchant les populations de rats, pas forcément visible d’ailleurs, les rats agonisants se cachant souvent (ce qui expliquerait pourquoi des sources anciennes ne mentionnent pas ces épizooties). Et j’ai découvert qu’il existait beaucoup de puces différentes, chacune ayant une « cible » différente : la puce de l’homme par exemple est la « Pullex irritans ». Le propos de l’auteure est de critiquer une théorie aujourd’hui encore très fortement implantée depuis les années 1930 : la puce de l’homme s’infecterait sur des malades pestiférés puis transmettraient la peste aux hommes. Cette puce est alors décrite comme vecteur exclusif des épidémies humaines. Cette théorie a été élaborée par 2 loïmologues, Blanc et Baltazard, à la suite d’une série d’expérimentations effectuée au Maroc en 1941-45. Selon cette théorie, le rôle du rat se trouve « réduit à celui de simple introducteur de la maladie, ou bien de transmetteur épisodique au cas par cas ». A travers des exemples nombreux et précis pris dans le temps et l’espace (la grande peste de Marseille en 1720…), Frédérique Audouin-Rouzeau réussit sa démonstration : elle identifie les puces du rat, et non pas celles de l’homme, comme « l’agent propagateur de toutes les épidémies mondiales (de peste), passées et actuelles ». Comment expliquer par exemple la « période de latence » qui existe entre les 1ères victimes humaines lors d’une peste et l’épidémie plus ou moins massive en tant que telle si la maladie est bien transmise par la puce de l’homme ? Cette période peut durer plusieurs semaines, donnant une fausse impression d’avoir évité le pire. C’est en fait la période presque toujours constatée par les sources, durant laquelle des 1ers morts isolés la peste se propage au rat puis vient l’épizootie. N’ayant plus d’hôte, les puces du rat s’attaquent donc aux populations humaines et l’épidémie peut alors se répandre. Cet ouvrage est particulièrement éclairant et pointu en même temps. Certains passages sont passionnants : la peste reste une maladie de la pauvreté et des taudis alors que les milieux plus aisés ont réussi à mieux s’en préserver, non pas grâce à une hygiène plus poussée (pendant des siècles, ça n’a pas été le cas). L’idée couramment répandue du « linge qui lave » (surtout du XVIe au XVIIIe s en Europe) voulait que dans les milieux les plus prospères, il n’était pas nécessaire de se laver mais juste de changer de vêtement, ce dernier jouant le rôle d’une éponge « absorbant la saleté » !!! Les différences dans les soins du corps ne commenceront vraiment à être visibles qu’au XIXe s. D’où la peste de 1920 à Paris qui a touché de façon limitée, le monde défavorisé des chiffonniers. Non, la différence entre les milieux sociaux vient sans doute d’habitats bien plus solides et protégés des rats que ceux des catégories précaires. Pendant des siècles, les seuls conseils aux populations touchées étaient de « fuir loin, vite et le plus longtemps possible ». Ce qui rappelle un des meilleurs romans de Fred Vargas « Pars vite et reviens tard » en 2001. Aujourd’hui, cette maladie est mieux connue même si des questions restent encore sans réponse. Alors que des cas sont rapportés chaque année, surtout dans des pays pauvres, il serait dangereux pour l’auteure de minimiser le rôle des puces de rat dans la transmission de la peste car « désintectisation, dératisation et étanchéification des habitats dans les zones menacées ou touchées » sont bien les 1ères mesures prophylactiques à adopter, à défaut d’un vaccin qui aujourd’hui semble très compliqué à mettre au point.