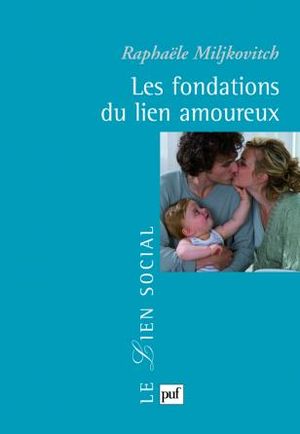Raphaële Miljkovitch est professeure de psychologie du développement social à l’université de Nanterre, et thérapeute de couple. Ce n’est pas son premier livre sur le sujet, en 2001 elle en avait déjà publié un aux PUF. Ici, elle s’intéresse à la manière dont les expériences affectives de l’enfance s’articulent aux expériences amoureuses de l’âge adulte.
Cela s’inscrit dans la lignée de la théorie de l’attachement fondée par John Bowlby. Sa collaboratrice, Mary Ainsworth, a défini en 1978 trois styles d’attachement. Hazan et Shaver étendent ces styles aux relations sentimentales des adultes et ajoutent un 4e style, « craintif-évitant » :
- Sécure : c’est le cas « équilibré », à l’aise dans l’intimité mais supportant la solitude, ayant une bonne estime soi et des autres…
- Insécure ambivalent (ou anxieux) : recherchant beaucoup d’intimité, se sous-estimant facilement par comparaison avec des autruis idéalisés, ce type se montre facilement dépendant, peu confiant et impulsif.
- Insécure évitant : symétrique du précédent, haut niveau d’indépendance, au point de taire ses sentiments et de garder à distance les partenaires. Faible estime des autres.
- Insécure craintif-évitant (ou désorganisé) : désire la proximité affective, tout en se sentant mal à l’aise. Du coup il peut faire le yoyo.
Je commence par une critique à proprement parler, et je suis avec une synthèse du livre pour les curieux ou paresseux qui seraient intéressés par la thématique.
- J’ai trouvé les infos ci-dessus hors du livre de Miljkovitch. Je trouve d’ailleurs qu’elle manque un peu de clarté dans l’exposition des cas de figures. Bien sûr, toute typologie est limitée et réductrice, mais parfois on a l’impression de se trouver face à une énumération d’anecdotes, verbatims et histoires de vie. C’est à mon sens un défaut de l’ouvrage.
- Ça se lit assez vite (le livre fait 224 pages, annexes comprises), notamment parce qu’il y a de généreux extraits d’entretiens dans chaque chapitre. On ne se farcit donc pas de trop grosses tartines de sabir psychologisant.
- En parlant de sabir, quelques notions employées ne sont pas définies, alors qu’elles ont l’air un peu ésotériques. Enfin on se fait une idée de ce que ça veut dire, mais soit a) ça n’a pas de sens précis et autant utiliser un mot courant ; soit b) c’est un vrai concept et une définition à la première occurrence ou un petit glossaire en fin de livre seraient bienvenus.
- Si vous avez eu une enfance sans ombrage et une vie amoureuse idyllique, ça ne vous parlera sans doute pas beaucoup. Si par contre les relations affectives (familiales ou amoureuses) vous turlupinent, il y a de bonnes chances que vous trouviez dans ce livre quelques éléments qui vous parleront, vu la diversité des configurations et comportements évoqués.
- Pour étudier les continuités/discontinuités dans l’attachement à travers la vie, R. M. a collecté 100 entretiens ensuite codés pour permettre un traitement statistique (on a donc droit à quelques corrélations pour étayer le propose ici où là). L’échantillon est composé de 43 femmes et 57 hommes, ayant entre 18 à 78 ans, de tous niveaux socio-économiques. C’est une dimension que j’apprécie dans ce livre, de donner dans des annexes bien fournies les caractéristiques des enquêtés, les limites de la recherche, les questions et le codage du questionnaire (« ASSSI »). On s’élève un peu au-dessus des bouquins de développement conjugal lambda – et ce même si on doute de la haute teneur scientifique du genre de sciences sociales auquel se rattache le livre.
- Dans le même registre, j’apprécie qu’il y ait de vraies notes de bas de page et pistes bibliographiques. Sans être tout à fait un manuel, ça fait office de tour d’horizon avant d’éventuellement approfondir.
Pour ces raisons, j’oscille entre un 6 (pour les gens heureux qui n’ont pas d’histoire) et un 7 (pour ceux qui ont un intérêt personnel à la thématique). Et je tranche pour le 7, faute d’avoir trouvé jusqu’à présent d’autres livres plus convaincants sur le sujet.
Edit : après avoir lu un autre ouvrage de la même autrice, je baisse ma note à 6. Les fondations du lien amoureux est résolument plus académique, donc moins pertinent pour l'essentiel des lecteurs. L'autre en est une vulgarisation bien plus utile pour l'individu "normal" qui cherche à mieux se connaître plus qu'à théoriser.
Le livre s’articule en 5 chapitres, autour de deux axes : 1/ comment des automatismes mis en place durant l’enfance peuvent se perpétuer à l’âge adulte dans les relations amoureuses ; 2/ que le couple autorise comme évolution et comme changement dans le parcours de l’individu.
Chapitre 1 - « Compter sur l'autre »
La confiance que l’on a en son conjoint est très variable selon les individus. Alors que certains vivent tranquillement en son absence, l’éloignement peut représenter pour d’autres l’occasion de s’interroger sur son amour ; certaines personnes persistent à douter de leur partenaire, aussi fidèle et amoureux soit-il. Plusieurs situations du quotidien peuvent venir alimenter ce genre de craintes : lorsqu’il est absorbé, lorsqu’il voit d’autres personnes ou a d’autres activités, lorsqu’il manifeste un désaccord...
Après quelques exemples des moments critiques de l’enfance où ce sentiment de confiance se nourrit, notamment dans la relation avec les parents (et en particulier la mère), vient la description de la manière dont les expériences de couple sont interprétées à la lumière du passé.
▶ D’abord chez les anxieux-ambivalents.
Si l'anxieux a un partenaire introverti, c'est une première source de problèmes. En effet, elle est particulièrement propice à la projection : « à défaut de savoir à quoi [les introvertis] songent, il est facile de leur attribuer des pensées de toutes sortes qui, parce qu’elles ne sont pas exprimées, peuvent être considérées comme compromettantes ou inavouables. De là peuvent naître des malentendus qui créent ou renforcent le sentiment d’être mal aimé. »
Parmi les autres occasions qui peuvent inquiéter les insécures :
- L’absence physique (pour déplacement par exemple) du conjoint peut également être interprété comme un abandon.
- « Pour les personnes qui craignent de ne pas pouvoir retenir l’être qui leur est cher, les conflits peuvent représenter des menaces pour la relation et, de ce fait, paraître insurmontables. Parfois, la simple divergence de points de vue peut être vécue comme dangereuse pour le lien affectif. »
- « Parfois, simplement voir son conjoint en contact avec d’autres personnes suffit à faire craindre de le perdre. En particulier, les gens qui ont une faible estime d’eux-mêmes. »
▶ Dans la suite du chapitre, l’autrice semble décrire plutôt les insécures évitants :
Si le mécanisme qui consiste à reproduire des interactions néfastes peut paraître masochiste à première vue, il peut en réalité constituer un moyen de se préserver contre des désappointements trop importants, qui pourraient s’avérer insurmontables. La personne insécurisée, ayant été trop frustrée dans ses attentes pendant son enfance, mise peu (ou même ne mise plus rien) sur ses relations à l’âge adulte.
On trouve donc parmi les stratégies des évitants :
- La dénégation de son propre attachement
- Le choix d’un conjoint non investi (déjà marié, à distance…)
- Conquérir sans s’engager. « La tendance à faire beaucoup d’efforts pour obtenir l’amour de l’autre pour ensuite désinvestir la relation une fois qu’on y est parvenu apparaît cinq fois plus souvent chez les personnes qui, au cours de leur développement, ont traversé [une perte ou une séparation importante durant l’enfance] ».
▶ Le chapitre s’achève par une considération sur les moments critiques que sont certains caps à franchir (cohabiter, se marier, avoir des enfants…). « Même en étant très épris de leur partenaire, certains peuvent choisir de s’en séparer au moment où ils/elles vont s’investir pleinement avec eux, parce qu’alors la peur de le/la perdre apparaît et prend le pas sur l’exaltation ressentie jusque-là. La conviction de ne pas pouvoir compter sur la présence de l’autre surgit dans la relation, la rendant alors angoissante. En choisissant de se séparer, ce n’est donc pas tant de leur conjoint que ces personnes ont envie de se libérer, mais du mal-être qui émane de l’idée de compter sur quelqu’un ».
Chapitre 2 - Garder l'autre auprès de soi
Dans ce chapitre, l’autrice étudie la manière dont les comportements auxquels l’enfant a recours dans l’enfance pour obtenir affection et protection influencent l’adulte pour les obtenir dans sa relation de couple.
▶ On commence par décrire le maintien du lien dans l’enfance : les cris, pleurs, agrippement ou poursuite du parent sont des comportements standards. Ils sont hyperactivés chez les anxieux-ambivalents (le parent répond à toutes les sollicitations → signaux de détresse intenses et durables), inhibés chez les évitants (parentalité vécue comme un poids → l’enfant est dissuadé de rechercher la proximité → extinction des signaux de détresse, voire « soumission compulsive »).
Mais, en plus de cela, les enfants peuvent s’apercevoir que d’autres comportements permettent d’attirer l’attention du parent. Des « stratégies » masquées peuvent donc se mettre en place et perdurer à l’âge adulte :
- Se plaindre d’être souffrant pour bénéficier de soins
- Se mettre en danger soi-même (grimper partout, se précipiter dans le traffic…)
- Être agressif envers les autres
▶ À l’âge adulte, il semble qu’un attachement sécure dans l’enfance favorise une « communication simple et directe, sans devoir prendre des détours pour camoufler ses demandes. Dans le cadre de la relation amoureuse, une telle aptitude favorise les réponses adaptées du conjoint, à qui il est signifié clairement ce qui est attendu de lui ».
L’hyperactivation apprise durant l’enfance tend aussi à perdurer : « Les témoignages recueillis pour notre recherche confirment que la tendance à faire appel à l’autre de façon intempestive durant l’enfance est liée à la même attitude au sein du couple. La plupart du temps, un élément extérieur à la relation est vécu comme un obstacle à la proximité et vient servir de justification à des demandes et des plaintes incessantes ».
De même pour l’inhibition durant l’enfance, qui peut donner à l’âge adulte : sentiment d’auto-suffisance, négation des sentiments, fuite et mise à distance, focalisation exclusive sur les désirs de l’autre pour se détourner des siens propres.
Quant aux stratégies masquées apprises durant l’enfance, elles ont de bonnes chances d’être inadéquates dans le couple si elles sont gardées. Le recours à la maladie pour demander de l’affection à une mère qui la prenait très au sérieux n’aura pas forcément d’effet sur un conjoint dont l’enfance s’est passée loin des soucis de santé.
D’une manière générale, la difficulté à aborder de front les difficultés rencontrées au sein du couple est renforcée, ou même parfois causée, par une incapacité à se faire entendre durant l’enfance. Face à des parents peu réceptifs, l’enfant prend l’habitude de recourir à des stratégies indirectes, qui s’avèrent plus efficaces pour mobiliser leur sollicitude.
Chapitre 3 – Avoir un contrôle dans la relation affective
Ici, Miljkovitch relève que les affects intenses de la relation amoureuse entraînent « une relative perte de maîtrise sur sa propre vie ». Cette dépendance est plus ou moins bien tolérée. Là encore, c’est en lien avec l’enfance. Quand aucune stratégie ne permette d’inciter le parent à procurer les soins appropriés, pour combattre son sentiment d’impuissance, l’enfant peut se montrer « punitif ou protecteur à l’égard de l’adulte. Le déni de sa propre vulnérabilité accompagné d’une attitude contrôlante risque de perdurer et se faire sentir dans les relations amoureuses. »
Ceux qui évoluent dans un environnement chaotique ou sur lequel ils n’ont aucune prise grandissent avec la peur d’être soumis à des épreuves insurmontables. Pour lutter contre ce sentiment, ils vont organiser leur comportement de telle sorte qu’un minimum de choses leur échappe. Cela se traduit par un perpétuel besoin de réassurance ou une attitude contrôlante envers leurs proches. Par ailleurs, leur difficulté à réguler leurs émotions persiste dans le temps et les prédispose, plus tard, à des réactions dissociatives en cas de stress. Incapables de les gérer seuls, ils cherchent chez l’autre un appui pour canaliser leurs angoisses. Le cours de leur relation de couple s’en trouve automatiquement affecté.
Quand la dépendance est vécue comme angoissante, des comportements visent à en limiter la portée :
Le plus évident consiste à vouloir contrôler le partenaire de manière que ses actes soient conformes à ce qu’on espère. Pour s’assurer de son pouvoir sur lui, la personne peut le tester continuellement afin d’éprouver la constance de son amour. Cette vérification donne parfois lieu à de vives attaques, qui permettent d’évaluer son degré d’assujettissement. Quand l’équilibre psychologique est déterminé par le partenaire, agir sur lui devient le seul moyen de dominer des angoisses autrement ingérables.
Autrement, « considérer le partenaire comme un être faible et vulnérable permet aussi de se sentir fort à ses côtés ». De toute manière :
L’impression de manquer de contrôle sur ses affects négatifs donne lieu à des exigences démesurées à l’égard du partenaire ; il est attendu de lui qu’il comble tous les manques. Cette tâche n’étant pas réalisable, le sentiment de frustration persiste et peut alors alimenter encore davantage l’avidité affective. Ce n’est qu’en acceptant que l’autre ne lui apportera pas ce qu’elle recherche que la personne parvient à cesser sa quête. Celle-ci peut alors se reporter sur un nouveau conjoint, dont elle espérera qu’il soit plus apte à répondre à ses attentes.
En conclusion,
L’attitude contrôlante a donc deux effets contradictoires. D’une part, elle tranquillise la personne, en lui donnant l’impression qu’elle gère convenablement les aléas de sa vie émotionnelle ; de l’autre, elle l’empêche de voir en son partenaire quelqu’un qui est capable de la prendre en charge. Par suite, elle retrouve avec sa nouvelle figure d’attachement l’impossibilité de soulager la détresse dont elle avait déjà souffert avec ses parents.
Chapitre 4 – Apprendre à se connaître dans la relation à l'autre
Le chapitre 4 explore l’autre axe du livre : la manière dont le changement peut s’opérer dans les styles d’attachement. La relation de couple est étudiée ici comme « un autre contexte où l’on peut approfondir la connaissance de soi. »
Une fois les besoins/frustrations hérités de l’enfance identifiés en les revivant dans la relation de couple, il devient possible de les corriger. Dans cette possibilité de changement, l’issue dépend aussi de la réaction du conjoint aux demandes du partenaire qui refait l’expérience de ses frustrations.
Ce dernier peut adopter comme stratégie l’inflexibilité : refuser de transiger sur le point problématique et exiger de l’autre qu’il s’y plie.
Il peut aussi tenter de changer l’autre. Ces efforts pour provoquer une évolution chez le partenaire témoignent d’une volonté de préserver le lien affectif, en essayant de se débarrasser de ce qui est vu comme un obstacle à la poursuite d’une vie à deux. Mais
Souvent, les moyens mis en œuvre pour obtenir de l’autre ce qu’on attend sont inefficaces, en particulier s’ils relèvent de stratégies mises en place durant l’enfance. Le malaise ressenti au sein du couple risque, dans ce cas, d’être imputé au partenaire, alors qu’il s’inscrit dans la continuité des relations avec les parents.
Lorsqu’une personne perd l’espoir de faire changer son conjoint, il n’est pas rare qu’elle se désinvestisse de la relation, songeant parfois à se séparer. La lassitude ressentie la renvoie à un mode de relation qu’elle ne peut plus tolérer. Ne parvenant pas à faire évoluer son partenaire comme elle le voudrait, elle peut voir dans la rupture l’unique moyen d’affirmer son individualité. Si ce qu’elle recherche ne paraît pas réalisable avec lui, l’établissement d’une relation avec quelqu’un d’autre, avec qui ce serait possible, peut être envisagé.
Mais l’autrice constate que l’éventuelle modification du comportement qui est en jeu n’apporte pas toujours d’amélioration. En effet, si l’objet du conflit n’était que le prétexte à l’expression d’une insatisfaction, cette dernière subsistera et la revendication se déplacera vers un autre problème. Il faut donc trouver une solution au réel problème sous-tendant la revendication.
Morale du chapitre : « Si le désagrément ressenti ne dépend pas réellement de ce que fait le conjoint et persiste bien qu’il se conforme à ce qu’on attend de lui, il convient alors de s’interroger sur le rôle que l’on a soi-même dans le mal-être que l’on éprouve ». Dans le meilleur des cas, « l’empathie du conjoint remplit une fonction de réassurance, car elle empêche le sentiment d’illégitimité de ses désirs et d’isolement qui en découle. […] La conscience de ses propres aspirations n’est alors plus à proscrire ; elle donne lieu, au contraire, à une plus grande acceptation de soi et à une plus grande intimité avec le partenaire. »
Chapitre 5 – L'évolution des relations au cours du temps
Ce dernier chapitre s’intéresse aux facteurs de discontinuité entre l’enfance et l’âge adulte. Il faut déjà noter que le répertoire de comportements de l’adulte est heureusement bien plus riche que celui du bébé, ce qui explique certaines variations : une habitude prise au contact d’un parent ne va pas forcément s’exprimer avec un conjoint, alors qu’elle peut ressortir avec un autre.
▶ Il apparaît que la relation avec le premier conjoint est très liée à celle avec la mère. Au départ, on choisit quelqu’un avec qui on se sent autant (ou aussi peu) en sécurité qu’avec sa mère.
Par contre, les liens d’attachement précoces ne permettent pas de prévoir ce qu’il en sera de la sécurité affective dans les relations suivantes. De ce fait, la deuxième relation amoureuse marque « une relative rupture avec l’enfance » (ceci sur la base d’un test de corrélation mené sur l’échantillon).
L’autrice fait cependant remarquer que :
Alors que l’impression de sécurité semble pouvoir échapper à l’influence du passé, il n’en est pas de même pour les stratégies d’attachement : qu’il s’agisse de l’inhibition ou de l’hyperactivation, on constate que celles qui sont utilisées dans la première relation conjugale sont corrélées à celles auxquelles on recourt dans la deuxième. […] En effet, dans la mesure où elles opèrent en dehors du champ de la conscience, elles sont plus difficilement remises en question. Pour ce faire, il faut prendre du recul par rapport à son propre fonctionnement et en modifier l’expression spontanée.
▶ Mais comment expliquer que certaines personnes parviennent à « se défaire de leur passé », alors que d’autres semblent « condamnées à répéter les mêmes scénarios » ?
D’une part, la multiplicité des figures d’attachement dans l’enfance peut permettre une plus grande flexibilité. « On constate que les personnes qui ont vécu une relation sécurisante avec seulement un de leurs parents arrivent, à l’âge adulte, à mettre en place au sein de leur couple, des échanges qui sont également sécurisants. Bien qu’elles ne soient pas à l’abri d’expériences amoureuses négatives, elles s’y complaisent rarement et ont tendance à ne pas s’en contenter. »
D’autre part, la « rigidité » de certains adultes tient à des « biais de perception qui empêchent d’intégrer les informations qui ne sont pas conformes aux modèles de relations déjà établis. » Cela peut tenir à des « règles » établies dans l’enfance par les parents, qui poussent l’enfant à exclure certaines informations (par exemple reconnaître les aspects négatifs de sa relation avec ses parents). Dans ce cas, le style d’attachement est « sclérosé ».
On constate que les personnes qui, dès la petite enfance, mettent en place avec leur mère des stratégies d’attachement qui biaisent leur perception des relations ont tendance à rester bloquées, à l’âge adulte, dans des relations peu sécurisantes.
▶ Devoir exclure certaines informations peut affecter l’image de soi : face à l’interdiction de penser du mal de ses parents, c’est lui-même que l’enfant remet en cause pour trouver une raison aux difficultés relationnelles. En revanche, « si les difficultés passées sont comprises comme émanant des parents, ne serait-ce qu’en partie, l’image de soi peut être préservée et prédisposer à des échanges plus gratifiants. […] Pour se sentir aimé, il faut au minimum concevoir que ce soit possible ».
▶ Mais avoir préservé une image de soi positive n’est pas suffisant pour s’attacher paisiblement. Prendre l’habitude d’accuser l’autre ou le rendre responsable des difficultés n’est pas un comportement plus sain en vue de mener une relation harmonieuse. Il semble donc à l’autrice que la capacité à faire « coexister [au sujet des parents] des représentations positives et négatives » est liée au bonheur en couple.
Sur ce point, l’aptitude à se mettre à la place de ses parents et à comprendre leurs agissements est une force pour « faire la paix » avec ses parents. C’est une aptitude qui également directement utile au couple, permettant de se distancier de ses émotions, d’analyser la situation de manière non-égocentrique et de réagir de façon constructive au problème, en tenant compte du point de vue du partenaire [elle n’a pas inventé l’eau chaude là-dessus, on est d’accord].
Conclusion
Pour l’autrice, « plutôt que de considérer que le conjoint est défaillant dans sa capacité à comprendre ce qu’on attend de lui, il peut être utile de remettre en question son propre fonctionnement et de réaliser que certaines tentatives d’agir sur lui sont inefficaces, parce qu’inadaptées à la relation conjugale. »
Fait amusant (ou pas), d’après Miljkovitch :
Lorsqu’un des deux partenaires présente certaines restrictions dans ses représentations d’attachement, l’autre développe les mêmes types de biais concernant le couple alors qu’il ne les avait pas par rapport à ses relations d’enfance.
Heureusement, si les événements du passé ne peuvent pas être effacés, les représentations qu’on en a peuvent être changées. À cette fin, Miljkovitch évoque les « thérapies basées sur la mentalisation » (développées à l’origine pour les personnes atteintes d’un trouble borderline). L’idée étant de comprendre ses propres états mentaux pour sortir de cadres rigides et dysfonctionnels.