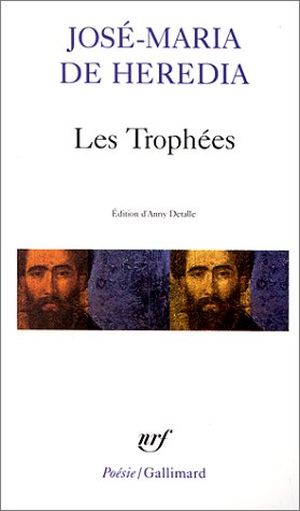Mon institutrice de CM1 m’avait fait apprendre « Les Conquérants ». Je ne sais pas pourquoi ce poème précis, ni si j’avais eu le choix. Je me le rappelle encore par cœur : j’imagine que ça m’avait valu une bonne note – mais je n’ai appris que plus tard où se trouve Palos de Moguer, et ce que signifient gerfaut, charnier et alizés. (Mais cette hussarde noire de la cinquième république nous avait expliqué hautaines, Cipango, antennes et les « étoiles nouvelles ». (Elle n’était pas allée jusqu’à dire que lesdites étoiles posent un problème d’hémisphère, et ne sauraient « monter […] du fond de l’Océan » pour des questions de reflet…)) Tout ça pour dire que si je me souviens encore de ce poème vingt-cinq années après, c’est parce que tout y vient des sonorités. (Telle était peut-être l’ambition de Mme C. : faire comprendre à des mômes ni plus ni moins cons que d’autres que la poésie, c’est la musique des mots. Puissent ses dernières années être emplies de miel et de lait !) Fin – provisoire – de la digression liminaire.
Au lycée, si j’avais étudié ce poème, on m’aurait sans doute demandé de savoir que les Trophées se rattachent au mouvement parnassien : la retenue, le non-engagement, l’art pour l’art (ou le beau pour le beau), tout ça tout ça. Ce qui implique, le bon artisan travaillant lentement, la vingtaine d’années de préparation. Maintenant que j’ai lu le recueil entier, qui finalement s’apparente à des « Poésies complètes » presque toutes prépubliées ailleurs, il me semble illustrer à merveille ce que le Parnasse peut avoir de profondément chiant.
L’« art pour l’art », j’y reviens. Outre les deux pièces finales (« Romancero » et « Les Conquérants de l’or »), les Trophées ne proposent que des sonnets. (Il s’agit, si l’on veut, d’écriture à contraintes, le « Romancero » se pliant quant à lui à la terza rima. L’idée de suivre un ordre qui se veut chronologique n’est sans doute pas étrangère non plus à l’impression de monotonie qui se dégage de l’ensemble.) Autrement dit, la structure prime sur la forme au sens large, quitte à forcer un peu pour que ça rentre – voir l’incroyable nombre de « Et » en début de douzième vers. Par conséquent, en-dehors de quelques pièces (1), les plus beaux vers surnagent au milieu de leur sonnet – et il y en a quelques-uns, de beaux vers : « La mer qui se lamente en pleurant les Sirènes », « J’entends les chiens sacrés qui hurlent sur ma trace », « Son cœur tremblant faisait trembler sa barbe blanche » (2)…
Par ailleurs, les Trophées, dans la mesure où le Dieu de la Bible en est totalement absent, semblent à leur manière une réhabilitation, sinon d’une forme de paganisme, au moins des religions antiques. Mais le poète y conserve au moins une caractéristique du christianisme (et des monothéismes en général) : l’absence de rire – dans le christianisme, seul le Diable rit. Bien sûr, là encore, c’est cohérent avec l’idéal d’impersonnalité du Parnasse. Cela montre aussi ses limites : l’impression de solennité et de hiératisme qui se dégage de la majorité des poèmes, accentuée par leur grand nombre – une bonne centaine, à vue de nez – et par l’utilisation quasi systématique du sonnet, cette impression, disais-je, plombe les Trophées à mesure qu’on avance dans leur lecture.
Heredia donne parfois l’impression de jouer contre son jeu – comme ces footballeurs amateurs persuadés d’être des grands dribbleurs alors qu’ils devraient tout miser sur leur jeu de tête. Ses plus franches réussites sont ces vers sonores à souhait, voire pétaradants – et il s’obstine à produire des pièces aussi lisses et travaillées que possible.
(1) Mes préférés, en plus des « Conquérants » : « La Trebbia », « Après Cannes », « Les Funérailles » ; à la rigueur « Le Lit » et « La Mort de l’aigle ».
(2) Respectivement dans « L’Oubli », « La Magicienne » et « Romancero » I.