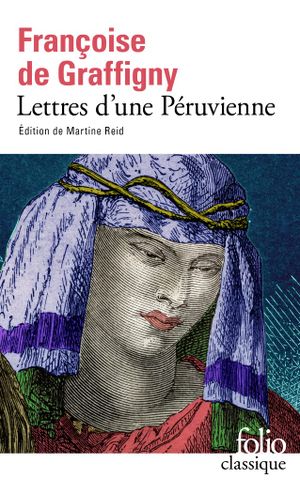Résumé
Un ouvrage intéressant et relativement accessible. On appréciera la portée féministe et humaniste tout autant qu’on regrettera le racisme et, dans une moindre mesure, les quelques facilités scénaristiques.
Détails (et spoilers)
Françoise de Graffigny va réussir à travers le personnage de Zilia et de ses lettres, à nous décrire les péripéties d’une péruvienne passant d’un cloitre à l’autre, d’un continent à l’autre, d’une domination masculine à l’autre.
Dynamique, le récit parcourt l’histoire de cette « vierge du Soleil », successivement capturée par les Espagnols puis les Français, pour atterrir dans le giron familial de Déterville, un noble français qui s’éprendra rapidement de Zilia. Les ameteur.rice.s d’histoire auront remarqué l’incohérence temporelle du récit, qui fait un bon de deux siècles pour faire cohabiter la conquête du Pérou (XVIe siècle) à la France du XVIIIe.
Cette facilité permettra à l’autrice de porter un regard d’une certaine acuité sur les horreurs de la colonisation, et de renverser le qualificatif de « barbare » du colonisé au colon. De plus, et à l’instar de Montesquieu dans les Lettres Persanes, Françoise de Graffigny utilise le roman épistolaire et le personnage étranger pour dérouler ses critiques de la société française. La grande réussite du texte réside dans cette double critique, à la fois des pratiques sociétales systémiques que l’autrice – via le personnage de Zilia – jugera injustes et indécentes, que des mœurs individuelles qui reflèteront l’hypocrisie, la vanité et le paraitre des Français·e·s.
Et bien que Déterville soit parmi les plus louables, les différences d’éducation feront émerger de ses interactions avec Zilia une situation centrale pour la suite du roman. En effet, Zilia, en voulant lui faire part de ses sentiments amicaux envers lui, utilise des termes que Déterville utilisera pour se convaincre que Zilia l’aime. Or il est évident que ces termes, au-delà de leur polysémie, ont parfois été dument mis dans la bouche de Zilia par l’éducation linguistique fournie par l'intermédiaire de Détervielle. Par ailleurs, Zilia étant éperdument amoureuse d’Aza, Déterville ne peut ignorer la distance qui le sépare de Zilia.
Cela permettra d’évoquer le trouble de Zilia, dévorer par l’absence de son amant et par la tristesse de son ami qui ne semble pas se faire à la possibilité de l’amitié d’une femme qui lui plait. Les lettres successives joueront donc de cette situation pour démontrer à quel point Zilia se retrouve accablé par ces deux hommes. La fin du récit viendra parachever cette lecture féministe d’un texte qui affirme la possibilité d’une vie émancipée des hommes.
Tout aussi intéressants que puissent être ces différents propos, on pourra toutefois regretter la présence d’un racisme incarnée par le mythe du bon sauvage, tant certains passages évoquant les Incas les font passer pour des êtres certes sympathiques et injustement opprimés, mais tout de même souvent essentialisés comme proche de la nature, et d’une simplicité parfois ridicule, comme le prouve les descriptions naïves faites par Zilia d’objet pourtant connus des Péruvien·ne·s de l’époque.
7.25/10