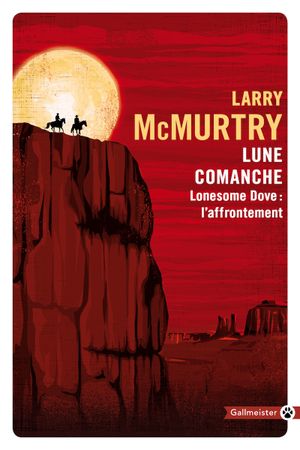Critique initialement publiée sur mon blog : http://nebalestuncon.over-blog.com/2017/10/lune-comanche-de-larry-mcmurtry.html
VERS LONESOME DOVE
Lonesome Dove est un roman (fleuve) extraordinaire – un western parfait, d’une ampleur, d’une force, d’une intelligence, d’une sensibilité incroyables. Le genre a produit bien des merveilles, sans doute – comme Warlock, d’Oakley Hall, ou Little Big Man de Thomas Berger, et, côté nouvelles, il faut mettre en avant l’extraordinaire Dorothy M. Johnson, d’abord et avant tout pour Contrée indienne. Mais Lonesome Dove, qui a valu à Larry McMurtry son Pulitzer, se hisse au moins au niveau de ces merveilles, et les dépasse probablement, tant qu’à faire.
Mais, Lonesome Dove, ce n’est en fait pas que le roman qui porte ce titre ; en effet, Larry McMurtry avait écrit trois autres romans autour des mêmes personnages, une « suite », Streets of Laredo, et deux « préquelles », La Marche du Mort et Lune comanche ; l’ensemble a connu un beau succès outre-Atlantique, et débouché sur plusieurs adaptations sous forme de mini-séries télévisées. En France, toutefois, seul le roman initial était disponible, il y a peu encore… Heureusement, les excellentes éditions Gallmeister (tournées vers la littérature américaine et le « nature writing », elles ont par ailleurs publié d’excellents westerns, signés par exemple par Dorothy M. Johnson, ou Glendon Swarthout, etc.) y ont remédié, ou ont commencé à le faire, complétant le Lonesome Dove originel (dans leur collection poche « Totem », en deux volumes) par ses deux « préquelles », La Marche du Mort l’an dernier, et Lune comanche cette année – en attendant Streets of Laredo pour l’an prochain ? Je l’espèce, de toutes mes forces !
Situons un peu les choses. À s’en tenir aux dates de publication, Lune comanche, une fois de plus un beau pavé (750 pages en grand format), est le quatrième et dernier des romans de la série, précédé, dans l’ordre, par Lonesome Dove, Streets of Laredo et La Marche du Mort. Par contre, au regard de la chronologie interne de la série, il arrive en deuxième position : La Marche du Mort le précède, et, ensuite, il y a Lonesome Dove, puis Streets of Laredo.
Par ailleurs, l’approche de la série, dans Lune comanche, diffère de celle dans La Marche du Mort, d’une certaine manière. Ce dernier roman, en guise de liens avec Lonesome Dove, développait surtout les deux héros de la série, Woodrow Call et Augustus McCrae, tout jeunes alors, et c’était l’occasion de lever le voile sur leur passé dans les Texas Rangers – Lonesome Dove y faisait maintes fois allusions, mais sans en dire davantage. La position intermédiaire de Lune comanche change la donne : non seulement les événements, finalement assez proches, de La Marche du Mort sont-ils rappelés à notre bon souvenir, via des personnages toujours présents notamment (outre nos héros, des figures telles que Buffalo Hump, Kicking Wolf, Clara Forsythe, etc.), mais aussi les événements, bien plus lointains dans l’avenir, de Lonesome Dove, sont-ils annoncés, via le nom même de Lonesome Dove, d’ailleurs, et surtout via des personnages tels que Joshua Deets, Jake Spoon… ou le petit Newt, qu’on ne peut plus envisager de la même manière. Autant de liens marqués, et en même temps d’un parfait naturel dans le cours de la narration – avec cet effet redoutable… que j’ai envie de relire Lonesome Dove, maintenant ! Satané romancier…
UNE FRESQUE, PLUS QU’UNE ODYSSÉE
Ces liens ont leur importance – et d’autres traits témoignent de la parenté entre les romans. Mais ils diffèrent par d’autres aspects sans doute pas moins significatifs. Il en est un que j’aimerais mettre en avant, même si de manière pas bien assurée, et qui distingue (peut-être) Lonesome Dove et La Marche du Mort, d’une part, et Lune comanche d’autre part. Les trois romans ont en commun une ampleur certaine – Lonesome Dove est le plus long, La Marche du Mort le plus (relativement) bref, et Lune comanche, à cet égard, se situe pile entre les deux – comme dans la chronologie interne, tiens. Cependant, Lonesome Dove et La Marche du Mort ont tous les deux un caractère d’odyssées, en mettant l’accent, même à titre de prétexte, sur un voyage, considérable et entrecoupé d’autres choses, néanmoins tendant vers un but – aussi absurde soit-il dans les deux cas : le roman originel narre comment Augustus et Woodrow convoient un troupeau de Lonesome Dove, à la frontière entre le Texas et le Mexique, au Montana, 5000 kilomètres plus au nord, au bas mot ; La Marche du Mort, sur un mode de l’odyssée peut-être plus strict encore d’une certaine manière (car le voyage, c’est aussi le retour), accompagne la désastreuse « Texas Sante Fe Expedition » de 1841, et en ramène les survivants chez eux. Le cas de Lune comanche est un peu différent, car il est davantage constitué d’allers-retours indécis, souvent interrompus en fait, sur une zone sans doute conséquente, mais sans commune mesure avec ce qu’on trouvait dans les deux autres romans ; en contrepartie, le roman, plus flexible, s’étend sur une période bien plus longue – on traverse en fait deux décennies ou presque, les années 1850 et 1860, avec des ellipses parfois conséquentes (nous commençons donc en gros une dizaine d’années après La Marche du Mort).
Ceci dit, très clairement dans Lonesome Dove, sans doute aussi dans La Marche du Mort, ces voyages sont à maints égards des prétextes – et il reste quelque chose de cet esprit dans Lune comanche, oui. Mais à plusieurs reprises, du coup !
Le roman débute quelques années avant la guerre de Sécession, alors que nos Texas Rangers – survivants de La Marche du Mort mais aussi petits nouveaux qui tétaient le lait de leurs mères il y a peu encore – traquent l’agaçant voleur de chevaux comanche Kicking Wolf, plus ou moins associé au redoutable chef Buffalo Hump (deux personnages importants de La Marche du Mort). La chose à ne pas faire, sans doute – car Kicking Wolf en profite pour commettre son plus grand forfait : voler le magnifique cheval du capitaine des Rangers, Inish Scull ! On ne le connaît pas sous le nom de Big Horse Scull pour rien. Un personnage haut en couleurs, légendaire aussi bien parmi les Blancs que parmi les Indiens… Kicking Wolf, grisé par son audace, décide de se rendre au sud, dans le Mexique, pour y accomplir un exploit de plus en offrant le cheval au tristement célèbre Ahumado – un bandit sanguinaire, le pire de tous… et avec lequel Inish Scull avait déjà eu maille à partir. Une occasion rêvée, pour l’aventurier bostonien, de revenir à l’héroïsme individuel, en traquant ceux qui l'ont dépossédé, à pied (hein ?) et accompagné d’un unique compagnon, l’éclaireur kickapoo Famous Shoes. Et ses Rangers ? Eh bien, il les laisse tomber – en confiant à la hâte à Woodrow Call et Augustus McCrae, ses deux meilleurs éléments, le grade de capitaines ; hop, là, comme ça. Nos deux héros font l’apprentissage amer des responsabilités – et Gus, tout particulièrement, qui souhaitait tant être récompensé de la sorte, doit bientôt constater que cela ne lui facilite pas la vie autant qu’il le croyait…
Lune comanche est un roman monstrueux, à sa manière ; sur cette base viennent se greffer bien d’autres histoires, d’autant que des années, voire des décennies, séparent le début du roman de sa fin. Mieux vaut ne pas en dire davantage ici, même si la fresque, du fait de son ampleur, n’en serait probablement qu’à peine abîmée.
FIGURES MYTHIQUES
La grande force de Larry McMurtry, m'est avis à en croire ces trois romans, ce sont ses personnages – et leurs dialogues, sans doute. Woodrow Call et Augustus McCrae en tête, mais pas au point de reléguer leurs comparses dans l’ombre, sont d’une humanité exemplaire, d’une complexité authentique – personnages qui peuvent s’avérer tragiques, ou drôles, ou les deux, en même temps si ça se trouve ; et admirables aussi bien qu’agaçants… Des personnages, enfin, qui sonnent juste, et interpellent avec astuce le lecteur, qui s’y attache très vite, y compris, si ça se trouve, pour les plus répugnants d’entre eux. Lune comanche ne déroge sans doute pas à la règle – mais ce roman m’incite, davantage que les deux autres, à opérer une distinction qui vaut ce qu’elle vaut : c’est que, dans le contexte plus ou moins crépusculaire de Lune comanche, certains personnages se parent des atours des héros, voire de figures proprement mythologiques ; un phénomène peut-être pas absent des deux autres romans (la gamine dans Lonesome Dove, la putain magnifique et la cantatrice lépreuse de La Marche du Mort), d’autant que deux d’entre eux figuraient déjà dans le roman précédent. J’ai tout de même l’impression qu’on est cette fois un cran au-dessus. Quatre personnages me paraissent devoir être envisagés sous cet intitulé, mais c’est bien sûr à débattre.
Commençons par Inish Scull, capitaine des Texas Rangers de son état ; un cas rare d'officier compétent dans une série souvent guère tendre à l'encontre des donneurs d'ordres (et cela vaut aussi pour le présent roman, bien sûr)... C'est un personnage qui détonne au sein de cette troupe qu’il mène au combat : Scull est un Yankee, issu de la meilleure société bostonienne ; plus qu’un soldat, il est d’abord et avant tout un aventurier – mais il sait très bien que les galons peuvent être porteurs d’aventures, à condition d’être au bon endroit au bon moment. Au milieu des combats, par ailleurs, Scull est un érudit – qui cite volontiers les poètes, récite en grec ou en latin, et dont les allusions culturelles saugrenues laissent systématiquement perplexes ses hommes : hein, quoi, Napoléon ? Et qui c'est, ça, Hannibal ? Scull, d’une certaine manière, a en fait tout pour être agaçant, et même insupportable. Seulement voilà : c’est un héros. Oh, rien de « moral » à cet égard, notre homme n’est pas le dernier à faire couler le sang, et, s’il jure par « la Bible et l’épée ! », sans doute est-il plus épée que Bible ; enfin et surtout, son ego surdimensionné ne l’amène guère à prendre en considération les autres… Qu’importe : ce qui compte, c’est qu’il est tellement haut en couleurs, tellement plus grand, tellement plus fort, tellement plus tout… Le charisme écrasant du bonhomme paralyse ses comparses comme le lecteur, qui ne peuvent tout simplement pas en dire du mal, et sont même régulièrement portés à l’admirer pour l’exception qu’il est. Sans doute était-ce le seul homme à pouvoir véritablement se confronter à Ahumado. Et il lui fallait une femme au moins aussi haute en couleurs… Mais je parlerai d’Inez Scull un peu plus tard.
Kicking Wolf, nous l’avions déjà croisé dans La Marche du Mort. Ce Comanche se définit par sa fonction : il vole des chevaux. C’est le meilleur à ce petit jeu. Personne ne vole des chevaux comme Kicking Wolf. Nulle vantardise, ici, rien que des faits – ce qu’il démontre avec une certaine forme de classe en soustrayant peu ou prou sous ses yeux le cheval légendaire du légendaire Inish Scull, pourtant lancé sur sa piste justement pour mettre fin à ses larcins… Kicking Wolf, ici, est celui par qui tout commence, d’une certaine manière. Et je crois que ça lui confère des attributs peu ou prou mythiques – à la façon d’un trickster, disons ? Pas de manière générale, certes. Mais il en a le défaut récurrent : une certaine arrogance, derrière la malice… S’emparer du cheval de Scull était en soit un exploit, mais qui ne lui suffit pas – désireux de briller davantage encore, il se rend auprès du redoutable Ahumado pour lui faire don du cheval légendaire. Une très mauvaise idée… Mais cela participe de son essence, au fond : tellement doué dans sa partie que la manière dont il s’y prend relève peu ou prou du surnaturel, Kicking Wolf ne se montre pas toujours très malin en dehors… Ou bien est-ce qu’il est également, voire avant tout, un rêveur ?
Buffalo Hump, lui aussi découvert dans La Marche du Mort, aurait sans doute bien des choses à dire à ce sujet. En fait, le voleur de chevaux l’irrite régulièrement – et si les deux Comanches se croisent plus qu’à leur tour, liés par le sang et la tribu, ils ne s’apprécient guère. Ils s’estiment, pourtant, d’une certaine manière : le voleur reconnaît en la personne du bossu le dernier grand chef des Comanches, et ce dernier ne saurait nier le génie dont fait preuve Kicking Wolf à l’occasion – ils ont tous deux cette stature mythique qui les élève au-dessus des autres Comanches. Mais Buffalo Hump, c’est sans doute la classe au-dessus encore : il est littéralement le dernier des Comanches. Un chef aussi brutal qu’intelligent, prompt à violer, torturer, tuer, prompt à vaincre enfin – la pire des menaces planant sur les Texas Rangers, qui vivent dans la crainte permanente de tomber dans une de ses embuscades. Woodrow Call et surtout Augustus McCrae n’y ont réchappé que par miracle, dans La Marche du Mort ; ce souvenir les hante, et les pousse à admirer, en même temps, leur si redoutable adversaire – lequel, ainsi que ses hommes, en a autant à leur service : Silver Hair McCrae, et plus encore Gun-in-the-Water, sont connus de tous les Comanches – et, parmi les Texans, seul Inish Scull peut en dire autant. Mais la gloire de Buffalo Hump est d’un autre ordre – et, bien au-delà de ces affaires personnelles, il entend offrir à son peuple un baroud d’honneur, une grande offensive concertée qui pousserait jusqu’à la mer… Meurtres, viols, destructions : le chef comanche n’est pas un tendre, il est même tout sauf ça – nulle vision Bisounours des guerres indiennes, si l’auteur ne fait bien sûr pas non plus dans la charge unilatérale, et consacre à ses personnages indiens la même attention, extrême, qu’à ses personnages texans, aussi sont-ils aussi marquants. Mais viendra enfin, pour Buffalo Hump, le temps de mourir – il se sait vieux, et d’un autre monde… Il est la Lune comanche. Notez qu’ici, comme en d’autres endroits, Larry McMurtry, s’est inspiré de personnages et de faits réels, mais sans y asservir son récit : il y a bel et bien eu un chef comanche du nom de Buffalo Hump, et dont le plus grand fait d’armes fut, en 1840, un grand raid dans tout le Texas, que la mer seule a arrêté… Les dates ne correspondent pas, il ne faut pas trop s’attacher à cette image (comme dans le cas de Bigfoot Wallace dans La Marche du Mort), mais je suppose que ça méritait tout de même d’être relevé.
Évoquons une dernière figure mythique – la plus troublante peut-être… Il s’agit d’Ahumado, et il est une véritable incarnation du mal – mais sur un mode plus brutal que le Juge dans Méridien de sang, de Cormac McCarthy, plus intemporel aussi. En fait, c’est un personnage insaisissable, littéralement, et dont on ne sait pas grand-chose. Le bandit mexicain, surnommé « Black Vaquero », sème la terreur avec sa bande cosmopolite, dans le nord du Mexique et le sud du Texas. L’horrible personnage prise les supplices raffinés, les tortures les plus atrocement inventives : il terrifie tout le monde, et d’abord ses propres hommes – qui restent pourtant à ses côtés, sans doute justement parce que cette peur omniprésente ne leur laisse pas d’alternative. Mais qui est-il ? À deux ou trois reprises, on semble avancer qu’il serait un Maya (si cela veut dire quelque chose au milieu du XIXe siècle ?) ; il semble bien entretenir une relation avec les jungles loin au sud, et Jaguar – paysage et animal-totem dont les Texans comme les Comanches n’ont tout simplement pas idée. Mais cela renforce son caractère anachronique – et terrifiant, comme une ombre surgie du passé… Un homme (un homme ?) qui a son destin entre ses mains. Un homme sans pareil – car le mal est trop banal chez les autres. Il faudra bien un Inish Scull pour ne serait-ce que le déstabiliser temporairement... et encore le Yankee n'en sortira-t-il certainement pas indemne.
D’autres figures du roman ont quelque chose de mythique, mais leur statut de seconds rôles me dissuade d’en faire davantage état ici – pensez à ce couple de Français qui tient un saloon désert en un endroit paumé du nom de… Lonesome Dove ; mais j’y reviendrai !
FIGURES HUMAINES
Cependant, à ces figures qui me font l’effet d’être mythiques, il faut bien sûr en associer d’autres, qui brillent quant à elles par leur humanité. Le lecteur est fasciné par ceux qui précèdent, mais ils sont au-delà de l’identification – ceux dont je vais parler maintenant en sont par contre des véhicules tout désignés. Ils n’en sont pas moins complexes – car c’est au fond cette complexité qui fait les bons personnages, puisqu'elle fait l’humanité.
Au premier chef, il faut bien sûr citer nos héros, Woodrow Call et Augustus McCrae – en rappelant toutefois que Larry McMurtry use d’une multiplicité de points de vue, changeant sans cesse mais avec une grande habileté narrative, ce qui fait que les deux capitaines ne se voient finalement pas accorder beaucoup plus de champ que tous les autres personnages du roman (mais peut-être vaudrait-il mieux l’exprimer à l’envers). Cependant, ils sont nos compagnons, depuis La Marche du Mort jusqu’à Lonesome Dove (et après ?). Et ce sont toujours des personnages aussi magnifiques – y compris dans ce qu’ils ont d’agaçant. Membres des Texas Rangers depuis une dizaine d’années maintenant, ils ont considérablement plus de bouteille que les petits cons qu’ils étaient quand ils avaient intégré la milice, à l’époque de La Marche du Mort. Ils sont sans doute de bons Texas Rangers, meilleurs que beaucoup. La décision d’Inish Scull de les nommer capitaines a beau être précipitée, on peut supposer que le fougueux Bostonien n’aurait pas pu tomber mieux. Mais la nouvelle n’enchante finalement pas tant que ça nos deux amis, qui comprennent bien qu’on leur a refilé une patate chaude, et que leurs responsabilités accrues ne sont guère compensées par une meilleure paye ou un statut social véritablement plus élevé. C’est avant tout Gus qui en fera l’amère expérience, lui qui n’attendait que ça pour convaincre enfin « sa » Clara de l’épouser… Mais je m’aventure ici dans un terrain que je souhaite traiter plus spécifiquement après ; disons tout de même que les relations malheureuses de nos héros avec les femmes, pour des raisons très différentes (on prend en pitié Gus, on maudit Woodrow), impriment de leur marque le cours de l’histoire – peut-être autant, sinon plus, que la menace de Buffalo Hump ou le pays qui se déchire entre Bleus et Gris. Au-delà, les personnages sont égaux à eux-mêmes – et ce n’est pas une critique, c’est pour ça qu’ils sont si bons. Woodrow bourru et très premier degré, Gus bavard et excessif, forment un duo idéal, avec quelque chose d’archétypes qui ne les prive pourtant pas de leur humanité. Où la « naïveté » joue une part essentielle, toujours aussi délicieuse :
— J’ai pas vu de larmes, moi, dit Call quand ils furent à nouveau dans le buggy et redescendaient la colline vers les quartiers des rangers. Pourquoi il pleurerait s’il nous apprécie tellement ?
— Je sais pas et peu importe. On est capitaines, maintenant, Woodrow, lança Augustus. T’as entendu le gouverneur. Il dit qu’on est l’avenir du Texas.
— Je l’ai entendu, répondit Call. Je comprends pas ce qu’il a voulu dire, c’est tout.
— Ben, ça veut dire qu’on est des gars bien.
— Comment il peut le savoir ? Il nous avait jamais vus avant aujourd’hui.
— Allez, Woodrow… Sois pas toujours contrariant. Il est gouverneur et les gouverneurs peuvent deviner ce genre de choses bien avant les autres. S’il dit qu’on est l’avenir du Texas, alors je veux bien le croire.
— Je suis pas contrariant, dit Call. Je comprends toujours pas ce qu’il a voulu dire.
Il est bien d’autres personnages, dans Lune comanche, qui se détachent en demeurant humains, mais un emporte vraiment ma sympathie, que j’ai envie de mettre en avant : il s’agit de Famous Shoes, l’éclaireur kickapoo (et les Comanches détestent les Kickapoos…), qui va et vient à pied, au gré de ses envies et de ses curiosités ; censément au service des Texas Rangers, il n’est pas du genre à se restreindre pour cette raison – même pas par rébellion, en fait : avec le plus grand des naturels. Il veut bien obéir aux ordres, mais à sa manière ; et c'est une manière qui, pour certains, frôle l'insubordination, voire la désertion... Mais voilà, Texas Rangers ou pas, Kickapoos ou pas, et ses femmes, et ses ennemis, qu’importe : il va où il veut, au gré des vents – en faisant souvent montre d’une curiosité qui ne le rend que plus aimable, quand il s’improvise archéologue, en quête de pointes de flèches des Anciens (une menace pèse sur lui ? Quelle menace ?), ou, son obsession à long terme, quand il se lance sur la piste de ce trou d’où le Peuple a jailli, il y a bien longtemps de cela – il doit se trouver… par-là… Ce personnage aussi fait preuve d’une forme de « candeur » plus ou moins réelle, mais, sous ses excentricités, se dissimule à peine une bonne couche de sagesse pratique. Et c’est un personnage très attachant.
Un peu l’antithèse de Blue Duck – qui le hait, par ailleurs, au point où cela va décider de sa vie. Blue Duck est un des fils de Buffalo Hump – un métis, fruit du viol d’une Mexicaine enlevée par les Comanches et qui n’avait pas fait long feu. Blue Duck n’en déteste que davantage les Mexicains et les Texans – ou, dit autrement, il se veut plus comanche que tous les Comanches. Et son père le méprise… Blue Duck, aux yeux de Buffalo Hump, ne comprend tout simplement pas ce que signifie être un Comanche – il y a trop de Blanc en lui, sans doute. Le jeune imbécile ne respecte rien ni personne, il se vante mais n’a rien d’un brave, il est mesquin, cruel et irrévérencieux… Que le constat soit fondé ou pas, cela ne peut que déboucher sur l’opposition ouverte entre le père et le fils – à vrai dire, le plus étonnant dans tout cela est peut-être que Buffalo Hump n’ait pas encore tranché le débat d’un coup de poignard… Peut-être a-t-il malgré tout quelque chose d’un père ? Blue Duck, d’abord un brin victime, puis de moins en moins, est systématiquement associé à la notion d’injustice, je suppose. Au-delà, il est un personnage clairement maléfique, et ils ne sont pas si nombreux dans la série « Lonesome Dove » – ici, comme Ahumado, oui, mais sans son brillant mythique ; bien plutôt médiocre… Injustice, donc, et mépris, voire dégoût. Blue Duck est un salaud – un tueur sans foi ni loi, une brute puérile. Il est détestable, et on le déteste. On continuera de le faire dans Lonesome Dove. Mais, de temps à autre, on perçoit bien qu’il y a plus, en ce personnage. L’humanité, c’est aussi des Blue Duck, après tout.
Et tant d’autres personnages pourraient être cités, qui sont si humains, si vivants… Peut-être les trouve-t-on surtout parmi les Texas Rangers ? Joshua Deets, ou encore Long Bill Coleman, vieux compagnons de route puisqu’ils étaient de La Marche du Mort, valent bien un Woodrow Call, ou (surtout, c’est davantage leur genre) un Augustus McCrae, dans leur humanité essentielle. Le sort du second – le bon bougre un peu niais – n’en est que plus déchirant. D’autres encore, parmi les plus jeunes ? Jake Spoon, qui a sans doute ses mauvais côtés, ou Pea Eye Parker… Tant d’autres…
MAIS SURTOUT, LES FEMMES !
Pour l’heure, je n’ai peu ou prou cité que des hommes. On peut s’attendre à ce qu’ils aient un rôle prédominant, dans un genre aussi supposément « viril » que le western… Du moins, avant de découvrir les nouvelles de Dorothy M. Johnson, ou de lire des romans tels que Homesman de Glendon Swarthout, ou, m’a-t-on dit, La Veuve de Gil Adamson… et, bien sûr, les romans de Larry McMurtry. Lonesome Dove comprenait des personnages féminins très puissants, que la fin du roman, sauf erreur, mettait tout particulièrement en valeur. La Marche du Mort n'était pas en reste, avec des personnages de femmes « mythiques » là encore, comme la prostituée Matilda Roberts (et sa tortue ! Dix ans plus tard, on en parle encore), ou, sur un mode quasi fantastique, l’incroyable Lady Lucinda Carey, la noble lépreuse à l’aplomb sidérant ; mais le roman avait aussi introduit des personnages de femmes à dimension plus humaine – en fait les deux grands amours de nos héros, Clara Forsythe qui obsède tant Gus, et Maggie Tilton, la prostituée à laquelle Woodrow Call ne comprend absolument rien… ou qu’il n’ose pas comprendre, par lâcheté.
Deux personnages qui reviennent dans Lune comanche, les ancres de nos héros dans la ville d’Austin, où d'autres femmes jouent par ailleurs le même rôle. En fait, au premier abord, cette approche m’avait un peu déconcerté – je ne percevais pas bien pourquoi le roman abandonnait régulièrement les Texas Rangers et les Indiens pour revenir à Austin… alors que c’est probablement ici que se joue l’essentiel du récit, en vérité, ce qui apparaît progressivement. Lune comanche, plus encore que les deux autres romans, accorde une place essentielle aux femmes. La société du temps incite à les (mal)traiter en tant que « femmes de », mais elles s’illustrent pourtant par elles-mêmes – sans toutefois se faire d’illusions quant à leur sort ultime.
Mais d’une manière différente ? Car Maggie Tilton, la prostituée, se berce bien trop longtemps de ce genre de songeries… Son statut lourd d'opprobre réclame qu’un homme vienne la tirer de la rue ; elle a jeté son dévolu sur Woodrow Call, tout le monde le sait – sauf Call lui-même. Call guère à l’aise avec les femmes, qui continue de voir Maggie, mais insiste pour payer ses passes, Call surtout qui ne veut pas entendre parler mariage, et encore moins d’un enfant – ce Newt que l’on retrouverait dans Lonesome Dove, et sans doute ne peut-on plus dès lors le regarder du même œil… Maggie Tilton, la pauvre Maggie, a tous les attributs d’un personnage tragique, au niveau du mélodrame – elle n’en est pas moins touchante, et moins fragile qu'elle ne le croit elle-même ; aussi, même si elle ne se le permet jamais, le lecteur, lui, se met à haïr Woodrow Call, en certains passages (notamment quand il se montre jaloux de Jake Spoon, montrant qu'il est plus que jamais perdu dans ses contradictions) ; tout en ayant bien en tête combien ce personnage que nous adorons par ailleurs, n’est tout simplement pas en mesure de vivre en société, et de comprendre quoi que ce soit aux hommes et femmes, ses semblables, qui l’entourent bien malgré lui.
Clara Forsythe – une des rares femmes à apprécier et aider Maggie Tilton sans se pincer le nez devant sa condition de putain – réagit d’une tout autre manière. Dans La Marche du Mort, nous avons vu Gus faire sa rencontre, et décider dans la minute qu’il devait l’épouser. Nous le savions homme à femmes, bassinant Woodrow Call avec ses commentaires sur les prostituées du coin, et nous avions pu apprécier en Clara celle qui ne se laissait pas marcher sur les pieds, même si elle n’était pas la dernière à badiner non plus. Clara aime Gus, à sa manière… Même après dix ans d’une cour toujours à recommencer. Ils ne s’en lassent donc pas ? Quoi qu’il en soit, Gus, tout surpris de se voir nommer capitaine par Inish Scull, en saute bientôt de joie : les galons, enfin ! Clara va forcément l’épouser, maintenant ! Eh bien… Non. Car Clara Forsythe sera sous peu Clara Allen. Elle ne se vend pas – et M. Allen est un brave homme. Mais épouser un Ranger ? Un homme qui part sans cesse, pendant des mois, et qui court après la mort chaque jour davantage ? Non. D’où ce retournement de situation : nous détestons Woodrow Call parce qu’il refuse de s’engager avec Maggie Tilton, nous ne détestons certainement pas Clara Forsythe pour avoir fait le choix de se marier loin des Texas Rangers et du brave Gus – parce que nous connaissons ses sentiments, et la devinons libre en dépit du mariage, et parce que nous savons très bien, au fond, qu’elle a raison, et qu’épouser Gus aurait été le pire des choix. Nous ne lui en voulons pas, donc – ce qui ne nous empêche certes pas de pleurer avec Gus, et de partager ses cuites à répétition, alors qu’il cherche naïvement à noyer son chagrin dans l’alcool et la bagarre, à la limite extrême de l'autodestruction. Clara Forsythe, non, Clara Allen, n’en demeurera pas moins à jamais le grand amour de Gus – celui qui demeure beau, même triste, justement parce qu’il ne s’est pas réalisé. Le jeu d’ellipses du roman ne fera que confirmer ces sentiments douloureux mais justes : nul ne peut être heureux en amour, sans doute, mais Gus peut-être moins encore que quiconque – ses mariages sont déprimants… Ne reste plus qu’à espérer que les choses se sont mieux passées pour la belle et vibrante Clara.
Femmes de Rangers comme femmes d’Indiens, au-delà, ont leur rôle à jouer – quitte à ce que ce soit d’abord celui de victimes. Le roman revient régulièrement sur le thème des femmes violées par les Comanches, et parfois enlevées par eux, au rythme de scènes très dures, proprement insoutenables. Pearl, l’épouse de Long Bill, permet de rendre cette thématique soudainement bien plus concrète – et en résulte un tableau doublement tragique : celui de ces femmes que l’on rejette pour avoir été les victimes de viol, au nom d’un réflexe idiot de souillure qui semble l’emporter sur la compassion et la révolte ; celui de ces hommes qui, même avec les meilleures intentions du monde, ne savent absolument pas comment réagir. Heureusement, toutes les femmes du roman ne se voient pas systématiquement accoler ce motif très dur.
Il faut évoquer aussi les Indiennes ; le roman mentionne souvent, via les personnages masculins le cas échéant, certes, leurs épouses parfois nombreuses. Elles ne sont pas mieux loties que les Blanches, certes. Buffalo Hump ne rechigne pas au viol et est porté à croire qu’un bon époux se doit de battre ses femmes de temps en temps (il y en a des émules dans toutes les sociétés, faut-il croire). Cela n'exclut pourtant pas des relations complexes avec certaines de ses épouses, notamment la jeune Lark, aux rondeurs agréables, et les plus âgées et plus sages Heavy Leg et Hair-on-the-Lip ; de même pour Kicking Wolf ; et Famous Shoes, aussi, dont l’indifférence affichée est moins brutale et sans doute moins réelle. Et si Ahumado ne saurait susciter ce genre d’attachement, il conserve plus ou moins consciemment dans son ombre un personnage féminin impressionnant, quand bien même très éphémère – de manière presque insupportable, en fait.
Mais, à l’instar de ce qui se produit pour les hommes, et dans la continuité de ce que l’on avait pu lire dans La Marche du Mort, d’autres femmes, ici, se hissent à leur tour au niveau de figures peu ou prou mythiques – si ce n’est qu’en contrepoint des femmes du commun, plus qu’à leur tour tragiques, elles ont souvent ici les attributs de personnages de comédie, ce qui n’entame en rien leur charisme et leur évidente supériorité.
La première dans ce registre n’est autre qu’Inez scull – l’épouse du capitaine Inish Scull, et un personnage pas moins exubérant ! Les deux ensemble dans une même pièce, c’est une tornade garantie – heureusement, cela n’arrive qu’assez rarement ; Inish Scull a bien des raisons de partir à l’aventure… et son épouse, issue d’une vieille famille du Sud profond, d’une richesse considérable (que la dame entretient en acquérant des plantations à Cuba), professe sans cesse le mépris qu’elle éprouve pour son Yankee de mari, et pour les pénibles Bostoniens cul-serré qui s’offusquent d’un rien, qu’ils aillent au diable ! Ce qui ne l’empêche pas de forcer la main des Texas Rangers pour les contraindre à ramener Inish à la maison. Reste qu’en son absence, Inez ne se calme pas vraiment : loin de là, nymphomane assumée, elle raffole – avant de s’en lasser, quelques minutes à peine peuvent y suffire – des petit jeunots d’Austin qui intègrent le service de son époux… Ce qui peut en fait inclure des Rangers moins jeunes : Gus y passe comme les autres, et Woodrow Call ne comprend absolument pas comment prendre un thé en compagnie de Mme Scull peut durer aussi longtemps… Ceci étant, au-delà du cliché de la folle du cul, rassurez-vous, Inez Scull est un vrai personnage ; sans doute figure-t-elle avant tout dans des scènes de vaudeville, versant bien salace, mais, même à pister badine en main un jeune homme en caleçon qui ne s’avère finalement pas très satisfaisant, elle conserve une aura incroyable.
Sur un mode assez proche, même si autrement secondaire, j’ai envie de mentionner Thérèse Wanz – la Française qui tient le saloon désert de Lonesome Dove, au milieu de nulle part. Face à son époux bien falot, on ne se demande guère longtemps qui, selon l’expression, porte la culotte dans leur couple. Elle autorise à son tour des scènes très amusantes, qui ne l’empêchent pour autant pas de briller à sa manière.
En tout cas, tragédie ou comédie, mythe ou réalité, Lune comanche est un roman riche de très beaux personnages féminins, et c’est clairement une dimension à mettre en avant à mes yeux.
MOTIFS DU VOYAGE
L’histoire de Lune comanche est complexe, avec sa structure éclatée sur quinze à vingt ans, au rythme d’interruptions et d’ellipses brutales. Encore une fois, j’ai le sentiment d’une fresque qui, en apparence du moins, ne présente pas vraiment l’unité relative de Lonesome Dove et de La Marche du Mort. Ce qui ne signifie pas que nous n’allons nulle part – enfin, métaphoriquement… Disons du moins qu’il y a, au-delà de la peinture des personnages, et de l’importance des femmes sur toute la durée du récit, différents motifs qui participent bel et bien, en définitive, de l’unité de la narration – et qui relèvent en même temps de la même thématique du voyage. J’en vois au moins deux : partir – seul (ou presque)… et arriver trop tard (ou ne jamais arriver).
Notez que je vais probablement livrer ici quelques SPOILERS, attention donc.
Partir – seul (ou presque)
L’idée de « partir » semble omniprésente dans le roman – elle touche nombre de ses personnages, et avec un caractère récurrent de « coup de tête ». Bien des figures du récit, quand elles y succombent, s’en vont donc – seules ou, aussi souvent voire davantage, à deux.
Le fil rouge du roman, entre Texas Rangers, Comanches et bandits (d’Ahumado puis de Blue Duck), multiplie ce genre de scènes, offrant dès lors un complexe jeu de miroirs, où tel départ ne peut qu’en entraîner un autre, et réveiller les échos d’un précédent. Ainsi de Kicking Wolf et son camarade Three Birds, après que le voleur de chevaux s’est emparé de la plus belle de ses proies, et qui partent sur une impulsion empreinte d’arrogance pour livrer la merveille au redoutable Ahumado. À peine Inish Scull a-t-il appris le larcin qu’il décide aussitôt de faire exactement la même chose – ce qui n’en parait que plus absurde : le capitaine des Texas Rangers part donc pour le sud, à pied, accompagné de l’infatigable Famous Shoes. Ahumado, après quelque temps, sentant la mort venir, fera le choix de partir seul pour les jungles du sud, sans en avertir personne ; à la fin du roman, Buffalo Hump ne fera pas autrement, mais en se rendant dans cet implacable désert hérissé de pierres noires que l’on suppose magiques. Il y a d’autres départs entre les deux, non moins marquants – ne serait-ce bien sûr que celui de Woodrow Call et Augustus McCrae, à Lonesome Dove (eh !), préférant, dans leur quête d’Inish Scull prisonnier, ne pas s’encombrer des jeunes Texas Rangers, trop lents et qui risqueraient leur vie pour rien ; ce départ, comme sans doute pour les deux autres duos envisagés auparavant, a de faux airs de suicide – ce qui les rapproche en même temps des départs d’Ahumado et de Buffalo Hump s’avançant d'eux-mêmes vers leur trépas. Et Blue Duck ? Lui quitte un monde – celui des Comanches… pour se faire bandit, hors-la-loi, hors toute communauté sinon celle dont il tolère l’agrégation autour de lui, par vanité. Mais je reviendrai plus loin sur les Comanches et le départ.
Le motif apparaît également à l’arrière, à Austin. Ce départ peut être très concret, comme avec Clara Forsythe devenant Clara Allen – mais, pour le coup, ce départ n’a rien d’un suicide métaphorique, c’est même tout le contraire : il sauvera la vie de la jeune femme. Toutes n’ont pas sa chance – ainsi de ces femmes qui, une fois enlevées et « souillées » par les Indiens, ne peuvent tout simplement pas revenir parmi les Blancs ; le courage de Pearl offre un contrepoint à cette approche – mais, pour le coup, c’est Long Bill qui commet en conséquence le départ fatidique. Et bien des personnages sans doute voient, que ce soit réfléchi ou non, dans la mort le plus grand et le plus certain des départs – ce qui inclut à terme aussi bien Maggie Tilton que les malheureuses épouses de Gus.
Mais le motif du départ peut avoir davantage d’ampleur, en dépassant les seuls personnages, plus ou moins conscients de ce qu’ils veulent au juste, pour se sublimer dans un but – une destination, ou une cause à défendre. Les Texans partent pour le Mexique, ou repartent dans l’Est ; bientôt, la guerre de Sécession éclatant, conformément aux prédictions du Yankee Inish Scull, nombreux seront ceux qui partiront pour le front – côté Union ou côté Confédération ; pas le plus rationnel des choix, sans doute…
Mais ce sont les Comanches qui illustrent le mieux cette approche – ces Comanches qui sentent, qu’ils le veuillent ou non, qu’il leur faudra partir, comme sont partis les bisons : Buffalo Hump est agacé par les songeries de Kicking Wolf, l’imbécile croyant encore que les bisons reviendront… Mais que faire ? Autour de l’intraitable Buffalo Hump, d’autres Comanches, las des tueries, plus « réalistes » peut-être, supposent qu’ils n’ont plus le moindre choix : il leur faudra bien négocier avec les Blancs, et partir pour ces réserves qu'ils leur destinent, si loin de leurs terres… D’autres entendent encore résister, mais ils n’ont plus que le désert comme refuge. Buffalo Hump ne se leurre pas : pour les Comanches, partir de cette région, c’est partir tout court – sortir du monde. Peut-être est-ce inéluctable – mais, une dernière fois, il entend prouver au monde la gloire des Comanches, et leur assurer ainsi l’éternité.
Et nos héros, Woodrow Call et Augustus McCrae ? Cela les titille depuis un moment – eux aussi, il leur faudra partir… À Lonesome Dove, peut-être ? Pourquoi pas. Même si au final, ce ne sera qu’une étape de plus au fil d’un plus long voyage, et il y aura un ultime départ – au crépuscule du temps des pionniers, comme un écho de la Lune comanche.
Arriver trop tard (ou ne jamais arriver)
Dans certains cas, le départ se suffit à lui-même. Mais c’est loin d’être systématique : on avance souvent, çà et là, tel ou tel but justifiant le périple – mais ces buts sont plus qu’à leur tour absurdes… et, même quand ils ne le sont pas, il n’y a aucune certitude que les voyageurs y parviennent ; c’est même plutôt le contraire.
D’où cette structure relativement éclatée, où les interruptions brutales et les ellipses, finalement, font davantage de sens que les « grandes quêtes » : trouver Ahumado, libérer Inish Scull, capturer Blue Duck, que sais-je…
Nos Texans, tout particulièrement, ne cessent de partir pour quelque mission, et de la laisser tomber en cours de route, pour revenir – et refaire exactement la même chose quelque temps plus tard. L’absurdité de leurs quêtes n’en est que plus flagrante – et, sinon au plan purement narratif, ils ne sont finalement jamais là où ils devraient être, mais toujours dans un entre-deux qui ne rime à rien.
Conséquence non-négligeable : pour l’essentiel, les événements les plus cruciaux au plan historique, nos Texas Rangers passent à côté – ils ne sont pas là quand Buffalo Hump lance son grand raid sur Austin et jusqu’à la mer ; ils ne sont pas davantage sur le front où Bleus et Gris s’entretuent, ratant toute la guerre de Sécession – et on ne leur en voudra pas. La grande histoire se fait sans eux : ils ont bien assez à faire avec la « petite ». Au point, en fait, où ces « grands événements », pour l’essentiel, sont au mieux traités en hors-champ.
Bien sûr, ce sous-titre (français) de Lonesome Dove : l’affrontement n’en est que plus improbable ; en fait, une fois achevées ces 750 pages, la conviction du lecteur est bien plutôt que l’affrontement promis n’a justement jamais eu lieu ! Et quelque affrontement que ce soit. Parce que c'est bien le propos : les personnages arrivent trop tard, ou n’arrivent pas, donc – Clara s’est déjà fiancée, le raid sur Austin a déjà eu lieu, Ahumado est déjà parti, Buffalo Hump est déjà mort… et le front de la guerre de Sécession est bien loin. L’affrontement ? Pas vraiment, non…
Lune comanche, se déroulant dans les années 1850-1860, une époque classique du genre, n’est probablement pas à cet égard un western « crépusculaire », comme on dit souvent. Il y a sans doute davantage de cela dans Lonesome Dove, mais même ce roman n’est pas non plus, disons, Le Tireur, de Glendon Swarthout – ou bien d’autres livres, j’imagine. Cependant, dès son titre, le roman qui nous intéresse aujourd'hui pointe vers ce genre de connotations, concernant les Comanches – eux sont sans doute déjà « trop tard », et Buffalo Hump n’est certes pas le dernier à s’envisager comme un anachronisme. Une page se tourne – celle des Comanches, des autres Indiens des plaines bientôt, de tous les peuples autochtones à terme. Les Buffalo Hump, même les Kicking Wolf, n’ont plus vraiment leur place dans ce monde. Les Blue Duck davantage ? Peut-être… mais peut-être aussi les Famous Shoes, parcourant plaines et montagnes en quête de ce qu’ils sont supposés être – avec un regard plus serein sur le monde ?
Mais une page s’est tournée – et les Texas Rangers aussi le savent : les Comanches ne dureront pas beaucoup plus longtemps que les bisons. Autant lâcher l’affaire, qui ne rime plus à rien – d’autant que, la guerre civile achevée, les Tuniques Bleues reviennent dans leur réseau de forts sur la Frontière, pour « gérer » le problème indien. C’est sans doute déjà trop tard pour les Texas Rangers ; mais peut-être pas encore trop tard pour Woodrow Call et Augustus McCrae – ils peuvent se rendre à Lonesome Dove.
Et, à terme, ils en partiront. Trop tard ?
LES YEUX SUR L’HORIZON
Vous vous en doutez, Lune comanche est à nouveau un roman brillant, d'une grande richesse, un superbe western, parmi les meilleurs du genre. Je n’irais pas jusqu’à le hisser au niveau de Lonesome Dove, et je ne sais finalement pas s'il est meilleur ou moins bon que La Marche du Mort ; au sortir du roman, j'avais un peu l'impression d'avoir préféré le précédent, mais, avec un peu de recul...
Bah, peu importe, on atteint toujours des sommets de toute façon : c'est bien un excellent roman, palpitant et fort, porté comme d’habitude par des personnages admirables et humains (quand ils ne sont pas mythiques), aux répliques piquantes autant que justes. Comme les deux autres livres traduits de la série, Lune comanche fait preuve d’une habileté narrative irréprochable, et d’une fluidité dans l’expression qui n’a guère d’équivalent ailleurs.
Roman palpitant, émouvant, hilarant, déprimant, intelligent, sensible, tout cela et bien d’autres choses encore, Lune comanche fait honneur à sa série et à son auteur. Indispensable !