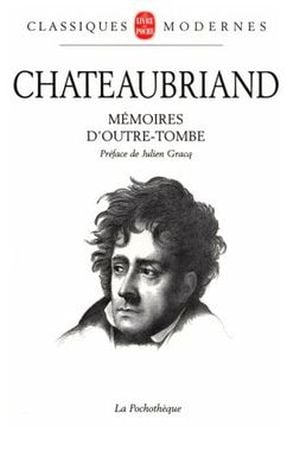Mémoires d'outre-tombe par Nébal
Chateaubriand est un con.
« Te voilà bien hardi, jeune Nébal ! Mais pourquoi commences-tu par une assertion aussi lapidaire et puérile ? »
Certes, certes, cela mérite bien une petite explication. Comprenons-nous bien : je n'entends certainement pas établir par-là une quelconque ressemblance entre le père du romantisme français et le sinistre pouacre scribouillant ce blog miteux. Si l'on peut bien relever chez le fameux Breton quelques traits caractéristiques du Nébal – une certaine naïveté à l'occasion, la dépression, la tendance à s'en foutre plein la gueule avec plus ou moins de sincérité, l'égocentrisme, l'orgueil, la mégalomanie et la paranoïa –, il est néanmoins évident que la comparaison est hors de propos. D'ailleurs, et bien évidemment, je ne suis pas tout à fait sincère quand je dis que Chateaubriand est un con... Si je commence par-là, c'est pour une raison bien simple : poser rapidement que je n'entends pas me livrer à une étude sérieuse, fine et pertinente sur le grand-œuvre du grand homme. Vous en trouverez aisément des dizaines, pour ne pas dire des centaines, et je n'aurais certainement pas grand chose à y ajouter. Alors j'ai pris le parti – probablement débile – d'envisager le compte rendu de cette lecture comme j'envisagerais celui d'un Perry Rhodan, par exemple. Normalement, quoi.
Le fait est, pourtant, que je ne me suis pas risqué à entamer les Mémoires d'outre-tombe par pur plaisir, ou simple désire inconsidéré d'améliorer quelque peu ma culture classique (qui en a bien besoin). Non, j'ai avant tout répondu à l'appel du devoir : travaillant sur la répression politique durant la première moitié du XIXe siècle, je pouvais difficilement passer à côté de ces mémoires, qui font à vrai dire figure d'incontournables (quand bien même, à mon sens, et au-delà du prestige littéraire, on en trouvera pour, à peu de choses près, la même époque de bien plus pertinentes – Rémusat, Tocqueville... Je vous en reparlerai probablement, en tout cas pour ce qui est du génial auteur de La démocratie en Amérique), et présentent à mes yeux l'avantage certain d'évoquer un homme qui s'est retrouvé des deux côtés de la barrière, si j'ose dire : l'homme politique légitimiste et contre-révolutionnaire est indissociable de l'opposant à Napoléon, du héraut de la liberté de la presse et du défenseur de cette petite dinde de duchesse de Berry. Indispensable, donc.
Maintenant, j'avouerai que, au-delà du seul plan littéraire – où l'importance de Chateaubriand est indéniable, il suffit de se rappeler la fameuse déclaration d'intention de Victor Hugo : « Être Chateaubriand ou rien ! » –, la faveur accordée à cet homme m'a toujours paru quelque peu exagérée. Sur le terrain pratique, Chateaubriand constitue indéniablement à mes yeux un nain politique dès l'instant qu'on le compare à la multitude de figures marquantes qui ont traversé cette complexe période de l'histoire de France, y compris au sein de son parti (prenez Berryer, par exemple), et a fortiori au-delà (on aura bien évidemment l'occasion de revenir sur Napoléon...) ; sur le plan des idées, de même, la contradiction fondamentale au cœur de sa pensée, le vœu pieux de réconcilier légitimisme et liberté, en fait un théoricien à la postérité mort-née, un auteur quelque peu confus, en tout cas isolé, et finalement de peu d'influence, d'autant que la concurrence était particulièrement rude à cette époque. Qui, aujourd'hui, pourrait prétendre sans rire (ou sans faire rire) reprendre à son compte les conceptions politiques de Chateaubriand ? Oh, on trouve bien encore quelques légitimistes de nos jours, étranges atavismes bornés affichant leur haine de la modernité à chaque messe du 21 janvier, mais ceux-là sont sans surprise d'une tendance plus haineuse, se ressourçant auprès de Joseph de Maistre, de Louis de Bonald, et probablement plus encore de Charles Maurras : le libéralisme de Chateaubriand les sidère... Et sans doute, pour cette raison, ne se reconnaissent-ils pas davantage, sur le plan spirituel, dans « l'esthétisme » catholique du Génie du christianisme ; je doute à vrai dire qu'il s'en trouve beaucoup aujourd'hui pour vanter la finesse et les mérites de cet ouvrage qui fut pourtant en son temps un best-seller... Comment expliquer, dès lors, le prestige dont continue de jouir Chateaubriand, plus d'un siècle et demi après sa mort, au-delà du seul plan littéraire ? Peut-être faut-il y voir avant tout le choix « par défaut » d'une contre-révolution « présentable », « respectable », éventuellement conciliable, dans ses aspects les plus modernes, avec l'évolution ultérieure des événements... Je ne sais pas. Mais il me semble en tout cas que, pour cette raison, Chateaubriand représente bien – de même que, plus tôt, un Bossuet, disons – un pan de la « culture officielle », qui ne doit véritablement sa survie de nos jours, par une sorte de raisonnement circulaire, qu'au statisme de cette culture. Bon, je dis peut-être beaucoup de bêtises... Mais voyez plus haut.
Abordons maintenant l'ouvrage en lui-même (Pléiade, tome 1). Par un regret, tout d'abord : l'appareil scientifique me paraît d'un intérêt très limité, au-delà des variantes ; les notes dispensables sont abondantes, quand nombre de points importants – concernant l'idéologie ou les personnalités évoquées, notamment – sont royalement ignorés... Et on regrettera de même, dans l'appareil scientifique comme dans l'introduction, une certaine tendance à l'hagiographie, négligeant les travers les plus évidents de l'auteur.
Chateaubriand a consacré une quarantaine d'années à la rédaction de ses mémoires : on peut bien parler, ici, de l'œuvre d'une vie. Rappelons d'ailleurs cette justification du titre : Chateaubriand, qui n'a cessé de revenir sur son texte, souhaitait qu'il ne soit publié que longtemps après sa mort (une cinquantaine ou soixantaine d'années)... quand bien même il ne rechignait pas à en lire régulièrement des extraits à ses proches. Ce souhait ne sera pas réalisé, les mémoires étant publiées peu après la mort de l'auteur.
L'œuvre en elle même se découpe en quatre parties, et ce premier volume reprend les deux premières en intégralité (le jeune homme, le voyageur, le soldat pour la première partie, la deuxième étant consacrée à l'homme de lettres) et le début de la troisième (l'homme politique ; ce tome s'achève avec le livre XXIV, c'est-à-dire avec l'Empire : Chateaubriand, après les Cent Jours, s'est projeté dans l'avenir pour évoquer Napoléon à Sainte-Hélène, sa mort et le retour des cendres). Au-delà de ce tronçonnage quelque peu artificiel, il est bien des traits que l'on retrouve tout au long de l'ouvrage : outre une tendance à la digression et à la confusion de la petite histoire et de la grande, l'ambiguïté inhérente à la pensée de Chateaubriand, ainsi, apparaît très tôt, de même que son orgueil démesuré, maladroitement caché sous une fausse modestie stupéfiante d'hypocrisie. Chateaubriand, de toute évidence, se considérait comme un géant ; ainsi, il s'attribue plus d'une fois un rôle déterminant dans le cours des événements : si la France est redevenue catholique après la Révolution, c'est nécessairement du fait du Génie du christianisme ; si la Restauration a eu lieu, c'est parce qu'il a publié De Bonaparte et des Bourbons, etc. Il ne peut, de même, résister à l'envie de se comparer aux grands hommes de son temps, et systématiquement à son avantage : les vies de Chateaubriand et de Napoléon sont ainsi placées sur un pied d'égalité ; et quand il fait l'éloge de Lord Byron ou de Walter Scott, il en arrive nécessairement, très vite, à faire son propre éloge, puisque ces auteurs, nécessairement, lui ont tout emprunté... Autre trait frappant et regrettable, tout en n'étant bien évidemment guère surprenant : le romantisme exacerbé de ces pages ; on y pleure beaucoup, et avec un lyrisme extrêmement lourd ; on parle souvent de se donner la mort, de même : Chateaubriand peut bien se montrer sarcastique sur la triste postérité qu'il a engendré d'une multitude de René, il n'en a pas moins régulièrement des états d'âme puisant directement aux Souffrances du jeune Werther... On ne peut bien sûr guère critiquer l'auteur pour cette raison, c'était l'esprit du temps, tel qu'il a bel et bien, cette fois, contribué à le façonner. Il n'en reste pas moins que certaines pages, aujourd'hui, sont proprement illisibles, notamment quand Chateaubriand cite dans le texte des échanges épistolaires avec des dames de son entourage : le lecteur se prend à vouloir de toute force hâter leur décès (ben oui, elles souffrent, mais nous aussi, du coup...).
Détaillons un brin, maintenant. La première partie de l'ouvrage est donc consacrée à la jeunesse de Chateaubriand, et à ses « carrières » – le bien grand mot ! – de voyageur et de soldat. C'est bien le portrait d'un homme de l'Ancien Régime : Chateaubriand, quoi qu'il en dise à l'occasion, reste bien un noble attaché à ses prérogatives et à son illustre ascendance ; il avait, il est vrai, quelques grands noms dans sa famille, et notamment Malesherbes (dont l'influence fut probablement déterminante : rappelons que l'avocat de Louis XVI fut aussi un des premiers défenseurs de la liberté de la presse...), puis, plus tard, Tocqueville (lequel n'atteindra cependant la célébrité qu'au moment où Chateaubriand se retirera de l'avant-scène).
On en retiendra surtout le portrait amusé, quand bien même nostalgique, d'un jeune homme un peu vain, aux ambitions démesurées, mais qui se cherche encore : difficile de ne pas sourire à l'évocation de ce jeune crétin partant en 1789 à peu de choses près les mains dans les poches, sans préparation aucune, pour découvrir le légendaire passage du Nord-Ouest... Il abandonnera bien vite ce projet dément, heureusement ; mais il découvrira Atala... Son voyage en Amérique n'est que brièvement évoqué, ceci dit.
Chateaubriand rentre bien vite : l'honneur lui commande de prendre les armes pour son roi, malmené par la Révolution. Il rejoint les rangs de l'émigration, et entame alors sa « carrière » de soldat ; fort brève, à vrai dire : l'échec des tentatives de l'émigration apparaît bien vite, et, lors d'un siège, Chateaubriand, blessé et atteint de la petite vérole, manque de perdre la vie... Il part alors pour l'Angleterre, et ne ménage d'ailleurs pas ses critiques pour la sottise des nobles émigrés désireux de restaurer la monarchie capétienne au prix de l'invasion de la France par les troupes étrangères...
L'exil britannique de Chateaubriand est à mon sens le passage le plus intéressant de cette première partie : l'auteur y livre une peinture richement colorée et cocasse des émigrés qu'il y fréquente, et dépeint de même la société qui l'environne à la manière des innombrables « lettres anglaises » du XVIIIe siècle. Et, surtout, il commence véritablement à écrire, gardant encore ses œuvres romanesques en brouillons, mais publiant néanmoins son Essai sur les révolutions, où il affirme déjà sa volonté de concilier libéralisme et légitimité, ce qui lui attire les hostilités tant des libéraux que des légitimistes...
Il rentre bientôt en France, néanmoins, d'abord sous un faux nom, mais il reprend bien vite le sien propre : c'est que la publication du Génie du christianisme, à peu de choses près au moment où le Premier Consul entend réconcilier la France révolutionnaire avec l'Eglise, en a fait une star, dirait-on aujourd'hui. Succès de circonstances pour l'homme de lettres qui entame ainsi brillamment sa carrière (deuxième partie) : Atala, Les Natchez, et surtout Les Martyrs, rencontrent un accueil plus mitigé ; l'apôtre du « nouveau style » (le romantisme) déplait aux tenants du classicisme littéraire, souvent ces mêmes conservateurs que ses idées politiques l'amènent à côtoyer...
C'est aussi l'époque où débute le grand duel opposant Chateaubriand à Napoléon. L'auteur ne cache pas, et c'est tout à son honneur, sa profonde admiration pour l'homme qui a mis fin à la Révolution, qui a réconcilié la France avec l'Eglise, pour le grand génie militaire aussi, bien sûr, et, dans un premier temps, pour l'homme qui semble être le mieux à même de concilier l'ordre et la liberté. Chateaubriand, ainsi, accepte un poste de secrétaire auprès de l'ambassade de Rome que lui confie Napoléon. Il démissionnera bien vite, cependant, à la nouvelle de la mort du duc d'Enghien : Chateaubriand y consacre un livre entier (le livre XVI), véritablement passionnant. Le libérateur et le restaurateur de l'ordre devient dès lors l'ogre et l'usurpateur : Chateaubriand rentre dans l'opposition, et jongle avec la censure pour multiplier les pamphlets contre celui qui se proclame bientôt Empereur. Il devient ainsi une figure importante de la légitimité, et sera tout naturellement associé à la Restauration.
Mais avant d'aborder véritablement sa carrière politique, quand bien même quelques aspects en figurent déjà dans la deuxième partie, Chateaubriand consacre tous les livres de la troisième partie qui figurent dans ce volume à l'évocation de Napoléon. Le mémorialiste se fait ici historien, à plus ou moins bon droit. Il ressort souvent de ces pages une impressionnante confrontation d'ego, où l'orgueil démesuré des deux grands hommes est sans cesse mis en balance. Chateaubriand a ainsi une attitude assez ambiguë à l'encontre de son meilleur ennemi : en nombre de pages, son admiration ne saurait faire de doute, il ne nie pas, à l'inverse de bon nombres de ses contemporains légitimistes, le talent et le génie du vainqueur d'Austerlitz ; il sait qu'il s'agit bien d'un géant, et son admiration confine même à l'amour émaillé de regrets dans certains passages remarquables, notamment vers la fin du volume, quand il évoque le triste sort de l'ange déchu, et les mesquines trahisons de ses proches, des sénateurs s'empressant de ramper devant Louis XVIII et de proclamer la déchéance de l'Empereur, avant de se parjurer une deuxième fois, puis une troisième... Sa haine, Chateaubriand la réserve surtout à ces gens-là, et notamment à Talleyrand et Fouché, qu'il ne cesse d'accabler des plus cruelles invectives, souvent méritées il faut bien le reconnaître. Il n'est d'ailleurs guère plus tendre pour certaines grandes figures du légitimisme, hommes d'un autre temps, ne comprenant rien à la société française post-révolutionnaire, et qui, à force d'anachronismes, ne peuvent que susciter à terme le mépris pour le roi, et une nouvelle révolution, inéluctable : le peuple a goûté à la démocratie, et Chateaubriand sait bien que le combat pour la légitimité est perdu d'avance. L'esprit de parti ressurgit régulièrement, pourtant, et il ne faudrait pas déduire des lignes précédentes que Chateaubriand se livre à un éloge de son ennemi : bien au contraire, et sans surprise, c'est une virulente charge contre le dictateur ; il s'attarde complaisamment sur les méfaits les plus abominables de Bonaparte, sur ses crimes innombrables (Jaffa, le duc d'Enghien, etc.), sur ses erreurs politiques aussi : il n'a pas de mots assez durs pour condamner le sort réservé par Napoléon à l'Espagne, et, bien évidemment, la campagne de Russie. Ici, régulièrement, l'historien, le mémorialiste et l'homme politique laissent la place à l'écrivain : certaines pages, alors, sont d'une force impressionnante, ainsi la description cauchemardesque de la retraite de Russie et du passage de la Berezina, ou encore le périple de Napoléon en route vers l'île d'Elbe, où il montre l'ogre sous un jour inattendu, celui d'un homme faible, pleurant sans cesse sur son sort, et habité par la crainte omniprésente, et littéralement paranoïaque, du châtiment que les Français ne manqueraient pas de lui infliger s'ils mettaient la main sur lui... A vrai dire, il est des passages où Chateaubriand s'oublie quelque peu, se laisse emporter au-delà de sa tâche d'historien, et ne rechigne pas à la calomnie, ce qui n'est guère à son honneur, cette fois : on pouvait imputer bien assez de torts à Bonaparte, sans doute n'était-il guère utile de lui en inventer, surtout d'aussi mesquins (ce n'est pas un Français, il a toujours détesté les Français, il était à peu de choses près analphabète, etc.).
Ainsi s'achève ce premier volume. Ce fut long. A la fois passionnant et horripilant. Et c'est à suivre, bien entendu...