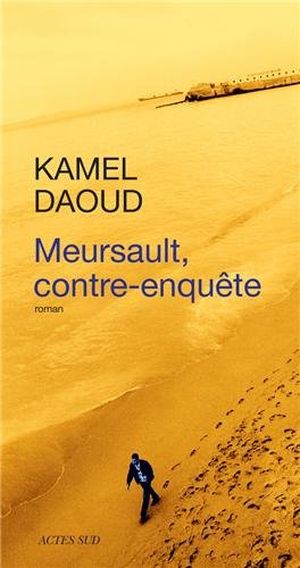Au début de ma lecture, j’ai pensé que ce roman à l’écriture déconcertante allait me donner du fil à retordre. Dans un bar d’Oran, un vieillard évoque des souvenirs qui semblent imprécis, se perdant parfois dans les méandres d’une mémoire tourmentée. A qui parle-t-il ? Apparemment à un jeune universitaire, un doctorant peut-être, un admirateur de Camus, sûrement. L’alcool aidant, sa narration s’effiloche, se répète ; souvent, il croit sentir derrière son épaule la présence d’un double fantomatique. Cette histoire, cela fait 70 années qu’il la porte, dit-il. Il s’appelle Haroun et sa mère à lui est toujours vivante, improbable centenaire emmurée dans sa douleur et son mutisme. Son frère aîné, Moussa, fut, prétend-il, cet Arabe anonyme tué par Meursault, le héros de L’Etranger
Passé ce premier moment d’étonnement dû à une écriture, certes élégante mais parfois un brin exaspérante tant elle tournoie volontiers sur elle-même, ce qui m’a accrochée à ce roman, c’est la pertinence du point de vue choisi. Car oui, c’est vrai : qui s’est jamais soucié de la victime du meurtre commis, l’été 42, sur une plage inondée de soleil par le héros de Camus ? Quelqu’un s’est-il demandé quel était son nom, s’il avait une famille, ce qu’il faisait au juste sur cette plage en ce jour fatidique ? En ce qui me concerne, j’avoue que jamais ces questions ne m’ont effleuré l’esprit. D’ailleurs nous le savons bien, la véritable raison de la condamnation de Meursault n’a que peu de rapport avec les actes commis et c’est plus un fils qui n’a pas su pleurer la mort de sa mère que le meurtrier d’un Arabe qui fut condamné à avoir la tête tranchée au nom du peuple français.
On pourra m’objecter que les personnages des romans ne sont après tout que des êtres de papier, qu’ils n’ont aucune existence une fois sortis de leur cadre fictif. On pourrait ajouter qu’il eût été bien peu concevable que Meursault, héros de l’absurde incapable d’éprouver le moindre sentiment, se soit préoccupé de l’identité de l’homme auquel il avait ôté la vie sans trop même savoir pourquoi. Il n’empêche : je dois admettre qu’épousant le point de vue du narrateur de L’Etranger, je n’avais jamais éprouvé le moindre intérêt, la moindre compassion pour la victime sans nom de ce crime inexplicable et le malaise suscité par cette révélation n’a pas été pour rien dans mon désir de poursuivre ma lecture plus avant, comme s’il fallait, à travers Moussa rendre justice non seulement à cet Arabe anonyme mais au-delà de lui, à tous ces laissés pour compte de la colonisation.
Tout au long d’un récit qui parfois s’égare, revient sur lui-même et finit par se déployer, livrant peu à peu sa part de vérité ou de mirage, nous découvrons ce que fut la vie d’un homme auquel on aura tout volé : son pays, son enfance, sa colère contre les colons, son droit à l’amour, son identité. Comment ne pas trouver légitime sa rancœur, lui qui n’avait que sept ans lors du meurtre de ce frère dont on n’a jamais retrouvé le corps et qui vécut désormais dans l’ombre omnipotente de celui qui avait été élevé au rang de héros par une mère inconsolable ? Oui, on peut le comprendre, le narrateur est devenu un être meurtri, révolté. Désabusé aussi. L’Algérie contemporaine est en train d’arracher ses derniers pieds de vigne et de voiler ses femmes. Les hommes ont perdu leur élégance, les villes sont devenues de vieilles catins aux murs décatis, aux rues pleines de miasmes putrides. Et voici que notre héros se découvre plus étranger à la société de son pays que ne l’était Meursault à sa propre existence. Deux étrangers donc, deux assassins aussi : comme nous le découvrirons au fil des pages, jusqu’à l’éblouissant final, le narrateur est bien le double de Meursault, même jusque dans son absurdité.
Par une de ces ironies qui font qu’un lecteur procède parfois à des rapprochements inattendus entre ses lectures, dans ce roman qui se veut un vibrant hommage à Camus et à la langue française, j’ai trouvé quelque chose qui m’a un peu rappelé Modiano et sa quête impossible d’une identité qui toujours se dérobe. Il y a ce frère mort, dont on n’a jamais retrouvé le corps, happé par la mer. Il y a l’ami, seul témoin du meurtre, mystérieusement disparu après les faits. Il y a la mère de Meursault, dont la tombe ne figure dans aucun cimetière, la maison où était censé vivre le meurtrier et où personne ne l’a connu. Et puis, il y a ce narrateur dont on ne sait en définitive s’il ne nous a pas menés en bateau. C’est que finalement, tout est vrai sans l’être dans ce livre en miroir, écrit de droite à gauche, porteur d’une autre vérité qui méritait d’être entendue.