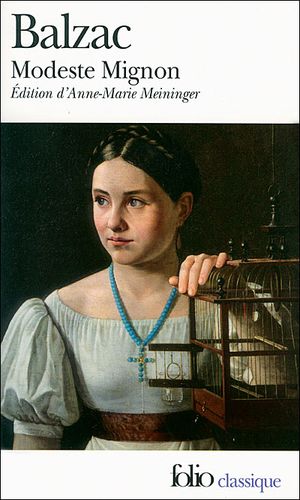Modeste, modeste, c’est vite dit : la jeune femme ainsi prénommée, qui, comme souvent – voir la Princesse de Montpensier –, donne son titre au récit au centre duquel elle reste tout en cessant, pendant l’essentiel de l’histoire, d’en être le sujet ; cette jeune femme, dis-je, se prend vite au jeu des exigences.
Prise d’un amour de tête pour Melchior de Canalis, poète à succès fort imbu de lui-même, elle entame avec lui une correspondance – cf. Balzac et Mme Hanska –, sans savoir que c’est d’Ernest de La Brière, « ami » et secrétaire de l’homme de lettres, qu’elle s’entiche. Et l’amour devient réciproque. Ajoutez-y le nain bossu Butscha, « clerc obscur » nain et difforme présentant des « contresens physiognomiques » (p. 472) qui se sachant laid, préfère d’emblée manifester l’amour d’un chien pour son maître que celui d’un amoureux pour celle qu’il aime (1). Puis bientôt le duc d’Hérouville, paraissant n’être qu’un nom, qui « ne tiendra pas plus de place ici qu’il n’en tiendra dans l’Histoire » (p. 614)…
En termes de narration, cela donne, dans l’ordre : une introduction plus balzacienne que Balzac, une séquence de roman épistolaire, une véritable partition (!) quelques scènes de vaudeville et un combat de coqs qui se termine, il n’y pas de hasard, en partie de chasse : le lecteur – j’allais dire le spectateur (2) – peut s’y perdre, mais comment ne rira-t-il pas ? L’humour chez Balzac passant rarement par la parole – encore que la verve de Butscha ivre donne lieu à quelques réjouissants bons mots –, ce sont ici des caractères vus qui prêtent à rire.
Or il me semble qu’il n’y a pas un personnage de Modeste Mignon qui, quel qu’en soit le degré, ne soit ridicule – au premier chef Melchior, bouffi d’orgueil littéraire et de prétentions politiques. Si je rentrais ici dans les détails, cette critique triplerait de volume. Indiquons seulement que chacun à sa manière, même les personnages qui semblent suivre le plus dignement la morale de 1830 ont leur part de ridicule – Butscha le fidèle plus-que-platonique, Charles Mignon comme une incarnation de ces pères balzaciens qui sont souvent les pivots des intrigues dans la mesure où ils sont fixes…
Ce ridicule – et c’est là où je reviens à Modeste Mignon comme spectacle, autrement dit à ce Balzac visionnaire dont parlait déjà Gautier – passe par le regard. Pour l’auteur, les apparences parlent à qui sait les analyser (2 bis). Cela me paraît manifeste dans cet assez long passage : « Elle [Modeste] regarda fièrement la duchesse de Chaulieu. Ce fut un regard doré par huit millions. / “Monsieur Melchior !…” dit-elle. / Toutes les femmes levèrent le nez et jetèrent les yeux alternativement sur la duchesse qui causait à voix basse au métier avec Canalis, et sur cette jeune fille assez mal élevée pour troubler deux amants aux prises, ce qui ne se fait dans aucun monde. Diane de Maufrigneuse hocha la tête en ayant l’air de dire : “L’enfant est dans son droit !” Les douze femmes finirent par sourire entre elles, car elles jalousaient toutes une femme de cinquante-six ans, assez belle encore pour pouvoir puiser dans le trésor commun et y voler part de jeune. Melchior regarda Modeste avec une impatience fébrile et par un geste de maître à valet, tandis que la duchesse baissa la tête par un mouvement de lionne dérangée pendant son festin ; mais ses yeux attachés au canevas, jetèrent des flammes presque rouges sur le poète en en fouillant le cœur à coups d’épigrammes, chaque mot s’expliquait par une triple injure » (p. 699).
Outre l’impression d’un authentique plaisir pris par Balzac à évoquer cette scène presque muette mais saturée de sens, outre la richesse de celle-ci, une expression me paraît digne qu’on s’y attarde : « un regard doré par huit millions ». Que l’amour et l’argent constituent les thèmes constitutifs des Études de mœurs, c’est évident – le second traverse toute la Comédie humaine. Mais on aurait tort de croire qu’ils s’opposent dans Modeste Mignon. L’argent est ici infusé dans l’amour – comme il commence à s’insinuer partout dans le capitalisme naissant dessiné par Balzac (3).
D’ailleurs, le capitalisme naissant est un autre sujet de ce récit. Mais ce qui intéresse l’auteur, c’est surtout le déclin définitif d’un monde : l’Ancien Régime, qui n’est plus présent ici que sous forme de vestiges en train de sombrer. Ceux qui ont la fortune cherchent certes un nom, mais surtout ceux qui ont un nom cherchent la fortune – l’amour-propre qui meut les personnages ne semble en définitive que la partie émergée de cet iceberg d’ambition. Il me semble bien que La Brière propose une analyse réductrice en déclarant à Canalis que « Modeste […] se trouve tout simplement entre la Poésie et le Positif » (p. 621) : le « Positif » a déjà pénétré la « Poésie » – ce dont Canalis est l’illustration la plus triomphante.
Le dénouement ne mentionnera plus Butscha, qui me semble pourtant l’un de ces personnages secondaires – voir aussi Lebas dans la Maison du chat-qui pelote, Du Halga dans la Bourse… – que Balzac semble avoir placés là pour être les véritables observateurs, doubles du lecteur et de l’auteur lui-même. Du reste, les deux cent cinquante pages de Modeste Mignon ne sont pas avares de ces digressions généralisantes d’une ou deux phrases qui font le charme des romans de Balzac, et en sont comme les respirations. Une dernière pour la route : « La plupart des drames sont dans les idées que nous nous formons des choses. Les événements qui nous paraissent dramatiques ne sont que les sujets que notre âme convertit en tragédie ou en comédie, au gré de notre caractère » (p. 480).
(1) « Prenez-moi comme vous prendriez un chien vigilant ! je vous obéirai, je vous garderai, je n’aboierai jamais, et je ne vous jugerai point. Je ne vous demande rien que de me laisser vous être bon à quelque chose », déclare-t-il à Modeste (p. 573). Il me semble remarquable que la plupart des critiques et des résumés lus çà et là – et même le second volume de l’édition originale, intitulé les Trois Amoureux – parlent d’un trio : Canalis, La Brière, Hérouville. C’est d’autant plus étonnant que le clerc dit encore : « Je resterai caché, comme une cause que les savants cherchent » (p. 573), et que l’une des visées de la Comédie humaine est précisément de rechercher des causes cachées.
(2) Dans une de ses digressions généralisantes, Balzac parle d’« un spectateur instruit, [pour qui] ce contraste entre la complète ignorance des uns et la palpitante attention des autres eût été sublime » (p. 480).
(3) On trouve ailleurs une amusante digression qui préfigurerait une critique de nos sociétés de contrôle, s’il ne s’agissait avant tout, pour Balzac, d’amorcer une critique de la province : « Essayez donc de rester inconnues, pauvres femmes de France, de filer le moindre petit roman au milieu d’une civilisation qui note sur les places publiques l’heure du départ et de l’arrivée des fiacres, qui compte les lettres, qui les timbre doublement au moment précis où elles sont jetées dans les boîtes et quand elles se distribuent, qui numérote les maisons, qui configure sur le rôle-matrice des Contributions les étages, après en avoir vérifié les ouvertures, qui va bientôt posséder tout son territoire représenté dans ses dernières parcelles, avec ses plus menus linéaments, sur les vastes feuilles du Cadastre, œuvre de géant ordonnée par un géant ! » (p. 530).