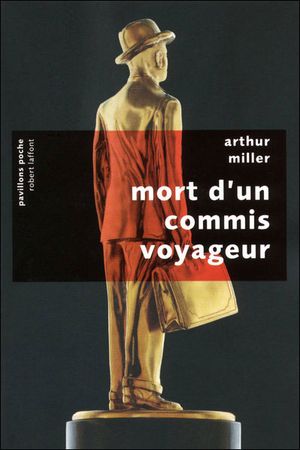Willy Loman est un commis voyageur de la fin des années quarante, qui doit avoir autour de la cinquantaine et a toujours cru au mensonge du rêve américain. Il a voulu acheter une tranquille petite maison pour sa famille - sa femme Linda, son fils aîné Biff, qui ne vit plus avec eux, et Happy, le cadet. La petite maison tranquille s'est retrouvée emmurée dans un ensemble d'immeubles, et le rêve américain s'est mué en cauchemar. Malgré tout, Willy Loman fait encore semblant d'y croire, alors qu'il gagne à peine sa vie, se traînant de ville en ville, son chiffre d 'affaires baissant chaque année davantage. Il reporte ses espoirs sur ses fils : Biff, rétif aux projets illusoires de son père et maintenant d'assez mauvaises relations avec lui, revenu pour un temps sous le toit familial, et Happy, qui lui, croit encore pouvoir "réussir". Linda a compris depuis longtemps que son mari n'était pas un bon commercial, que les fins de mois seront toujours difficiles, et elle écoute ses rodomontades sans illusions, mais avec tendresse, se rendant compte à quel point son mari est malheureux (ce qui échappe aux deux fils), mais ne pouvant pas grand-chose pour lui. Willy se referme sur lui, refuse la plupart du temps d'avouer sa détresse, se mure dans une dignité factice et inutile. On ne saura jamais ce qu'il vend ; lorsqu'on posait la question à Miller, celui-ci répondait que Willy Loman se vendait lui-même.
C'est une pièce âpre, amère, terriblement réaliste. Une pièce politique, bien entendu, puisqu'Arthur Miller dénonçait ici, en 1949, comme il l'a souvent fait, les dégâts du capitalisme et des illusions que le gouvernement américain vendait à sa classe moyenne et à ses citoyens en général ; illusions qui sont toujours d'actualité, aux États-Unis et presque partout dans le monde, à travers l'invention du concept du fameux ascenseur social, dont on voit aujourd'hui qu'il fonctionne plus que jamais à vide. Willy Loman, comme tant d'autres, a cru toute sa vie qu'il fallait gagner de l'argent, que là était le Graal. Or, non seulement il passe à côté de sa vie, mais il ne sait même pas comment gagner de l'argent. C'est un homme déphasé, qui ne correspond pas à l'image qu'on lui a toujours renvoyé de l’Américain idéal, celui qui doit gagner de l'argent pour l'argent - et qui est pourtant le fruit de la société de consommation et de l'idéologie capitaliste et libérale - une idéologie qui se révèle chez Miller, une fois de plus, destructrice.
C'est une pièce aussi terriblement efficace, dès le titre qui annonce la fin du drame. Une pièce en deux actes, où Willy Loman se raccroche encore, dans une première partie, à ses rêves qu'il sait pourtant perdus à jamais ; et où l'instabilité mentale s'installe peu à peu, dans une seconde partie, Willy se raccrochant alors à son passé, parlant tout haut et seul, ou du moins avec des personnages issus de sa mémoire, invisibles à ses proches mais visibles du lecteur/spectateur. Tennessee Williams ayant influencé Miller et Albee, j'imagine que la scénographie de La ménagerie de verre n'est peut-être pas pour rien dans ces flash-back, le côté un peu kitsch en moins. C'est que chez dans Mort d'un commis voyageur, on va droit au but, et que si on voyage dans la mémoire de Willy Loman, le ton reste d'un réalisme acerbe : pas de chichis dans les dialogues, ni dans la construction des personnages. Ibsen n'est encore pas très loin, en ce sens que dès le début de la pièce, la situation dramatique est déjà à l’œuvre depuis longtemps, et que ce sont les réactions et les choix de Willy Loman qui vont constituer l'argument de la pièce ; le pire étant que Willy Loman, qui dira valoir plus cher mort que vif, va transmettre l’idéologie qui va le tuer à son plus jeune fils.
Il paraît qu'il faut des jeunes Français qui aient envie de devenir milliardaires... M'est avis qu'il faudrait également plus d'Arthur Miller en ce bas-monde.