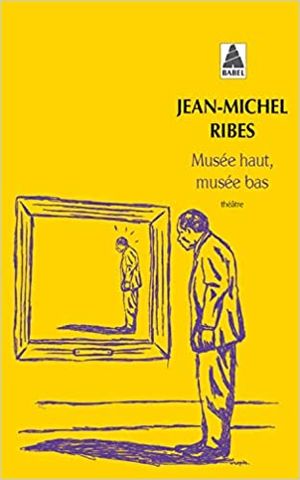"C'est du toc, la nature, de l'art mal copié!"
critique réalisée pour un concour d'entrée en médiation culturelle, à bordeau. Elle ne devait pas comporter plus de deux pages, donc elle est assez incomplète, et en plus rédigée sur un ton très académique, je m'en excuse. Néanmoins, je pense que ça pourrait éclairer certains lecteurs sur quelques points, à en juger les retours que j'ai eu sur cette oeuvre...
Musée Haut, Musée Bas, est une pièce de théâtre de Jean-Michel Ribes écrite en 2004. L'œuvre a connu deux publications différentes, et a été portée au cinéma par l'auteur lui-même.
La première édition de Musée Haut, Musée Bas proposait au lecteur de lire chaque scène indépendamment, comme l'on visiterait aléatoirement les salles d'un musée. L'adaptation théâtrale et la version que nous allons étudier reprend cependant la seconde édition de l'œuvre. Ici, les scènes ont un ordre précis et mènent à une réflexion sur la culture, les musées, l'art et la société. Elles sont écrites et jouées comme une comédie et pourtant pleines d'un sérieux presque dramatique quant à leur sens.
Nous allons étudier l'œuvre en trois parties : on verra d'abord l'art comme un objet devenu incompréhensible. On comprendra ensuite que cette pièce est une mise en abîme forçant le spectateur à observer des spectateurs. Enfin, nous verrons dans l'art une force à la fois créatrice et destructrice.
Dans cette pièce, l'auteur montre l'art comme un objet de société que l'on peine à comprendre.
On en voit un parfait exemple dans la scène « salles 12 à 18 » l'art français. Les visiteurs sont dans la salle du musée dédiée aux impressionnistes, mais n'apprécient en rien les tableaux : ils se contentent de passer devant en dissertant sur les peintres plutôt que sur leurs œuvres. Ils n'apprécient pas l'art, ils apprécient le fait d'être devant l'art. Rapidement, Jean-Paul passe devant le dernier tableau et annonce : « c'est incroyable ce que ça passe vite les impressionnistes ». L'effet prend tout son comique lorsque l'on sait que le groupe a erré dans tout le musée avant de trouver cette salle, qu'ils parcourent en quelques minutes à peine, sans vraiment prendre le temps de voir les œuvres.
Ce genre d'incompréhension du public face à l'art se retrouve tout au long de la pièce, comme un effet comique à répétition : une mère de famille qui déteste Picasso, tandis que sa sœur lui dit « tu sais, il dessinait bien, avant, Picasso », une certaine Josette qui affirme : « On aurait dû prendre un guide Jean-Louis » « Un guide ? Pour quoi faire ? » « Je n'y comprends rien », mettant encore une fois en avant ce vague sentiment d'incompréhension qu'ont les visiteurs face aux œuvres. Ils entrent dans le musée en sachant qu'ils vont y voir quelque chose d'important, quelque chose qui a marqué l'histoire, mais ils n'en comprennent pas le sens. Ils se posent les mauvaises questions : pourquoi c'est connu ? Pourquoi ça a marché ? Ils appliquent aux œuvres un raisonnement basé sur la société de consommation dans laquelle nous vivons.
Les visiteurs ne sont pas les seuls à ne pas comprendre l'art : les employés du musée, jusqu'au directeur, n'y voient pas plus clair. Les guides, par exemple, passent d'une pièce à l'autre rapidement sans laisser le temps aux visiteurs de regarder les œuvres : leur but semble juste être de montrer le nombre de pièce dont dispose le musée. Ainsi, dans la scène « salles 12 à 18 » l'art français, un guide entre en scène avec des touristes norvégiens, annonce dans leur langue le nom de la salle, puis repart avec eux. Dans le film, les guides et les touristes courent le plus vite possible, afin de voir un maximum de salle : c'est qu'il faut que la visite soit rentable, et on suppose que plus on verra de choses, plus elle sera rentable. Encore une fois, la vision capitaliste est appliquée à un domaine qui la rejette naturellement.
Les dirigeants du musée eux-mêmes, qui semblent pourtant sortir du lot, ne sont pas mieux placé, puisqu'ils bafouent les valeurs des artistes qu'ils défendent en faisant preuve de racisme et d'intolérance. Ainsi, même eux qui sont en mesure d'apprécier les œuvres, n'en retirent rien.
Enfin, les œuvres elles-mêmes ne se comprennent pas, ou ne cherchent pas à se comprendre. On assiste ainsi à un intéressant échange entre Sulki et Sulku, deux œuvres d'art personnalisées : « Tu veux dire qu'on doit signifier quelque chose ? » « C'est ce qu'ils veulent...ne crois pas que ça me fasse plaisir, Sulki ». En fait, c'est nous même, visiteurs ou spectateurs, qui donnons sens aux œuvres. Mais, incapable de les comprendre et cherchant leur sens dans ce qu'a voulu dire l'auteur ou ce qui les a amenées dans un musée, nous les dénuons nous-même de sens ! On assiste ainsi à la scène absurde d'un groupe de visiteur entrant dans une salle, le guide annonçant « Mesdames et messieurs, je suis heureuse de vous annoncer que vous êtes la dernière œuvre de Karl Paulin », les visiteurs composant eux-mêmes l'œuvre, cherchant à voir de la beauté, de l'art, quelque chose de particulier, là où il n'y a qu'eux.
L'art est donc représenté comme un objet que l'on cherche à s'approprier, à comprendre, à apprécier parce que l'on sait qu'on est censé l'apprécier, sans réellement y parvenir, chargés d'à priori. Cela donne lieu à de nombreuses scènes comiques et à des dialogues frôlant l'absurde. Finalement, ce ne sont pas les tableaux qu'exposent ce musée, mais des visiteurs dans un musée.
Il y a là une mise en abîme : le spectateur observe d'autres spectateurs, qui observent de l'art. Un art invisible lorsqu'on lit le livre, renforçant encore cet aspect de l'œuvre, puisqu'il n'y a plus de véritable support aux conversations décousues des personnages. On se moque ainsi d'attitude que l'on a soi-même pu avoir dans des musées.
Cette mise en observation des visiteurs du musée permet à l'auteur de montrer la société humaine face à un art qui est en constante surenchère. L'exposition de photographies de sexes en est un parfait exemple : les visiteurs s'extasient devant 350 photos de bites, tandis que ceux qui ne comprennent pas l'exposition sont rejetés. La scène atteint son paroxysme lorsque mickey allume son « sexe », qui était un bâton de dynamite, pour faire sauter la salle ; un groupe de visiteur arrive alors avec une guide, qui affirme qu'il s'agit là de la dernière œuvre d'art traitant du terrorisme. Les visiteurs qui ont subi l'explosion agonisent, mais les visiteurs qui pensent qu'il s'agit là d'une œuvre d'art n'interviennent pas au nom de l'art. On dénonce ici une montée de violence dans l'art, que l'on croit justifiée parce que l'on nomme cela « art »...mais plus que cette violence, c'est l'absence de réaction de ceux qui la voient dans les œuvre, qui est terrible. Du moment que l'on nomme cela « art », on est prêt à tout accepter.
Enfin, l'art est montrée dans cette pièce comme une force propre à l'homme : l'homme qui créé, qui bâtit la civilisation, mais aussi l'homme qui détruit.
En effet, Mosk parle sans cesse de l'art comme la marque même de la civilisation, l'objet qui élève les hommes au-dessus de la nature. Dans ses longues tirades emportées sur la force de l'art et sur son importance, il est bien difficile de ne pas sentir ce souffle épique nous envahir. On lit une pièce de théâtre, une œuvre d'art, et tout à coup on se sent, nous aussi, tenir entre nos mains ce qui fait de nous plus que des êtres vivants : des hommes.
De même, l'auteur renverse le rapport nature/artiste par les paroles des gardiens de musée, dans la scène « Musée Malraux », Mammouths. Un gardien s'écrie qu'il serait bien incapable de vivre à la campagne après avoir vu les tableaux des peintres ; qu'il est impossible d'apprécier un coucher de soleil qui ne soit pas de Turner. « C'est du toc, la nature, de l'art mal copié ! » : on a tant élevé l'art au-dessus de la nature, au-dessus de l'homme même, que la simple beauté du monde devient trop banale, si elle n'est pas magnifiée par l'artiste.
Pourtant, l'art est également montré comme une force destructive. Ainsi, s'il a supplanté la nature, c'est en construisant par-dessus des musées, des bâtiments, des blocs de bétons. C'est en repoussant la nature avec la violence de Mosk lorsqu'il aperçoit des plantes dans son musée. Derrière la création, qui est une affaire de divin (on a d'ailleurs de nombreuses références bibliques tout au long de la pièce, rappel des origines de l'art, étroitement lié à la religion, aux croyances, à la mort), il y a la destruction de la nature, et même la destruction de la civilisation elle-même, de l'art lui-même. Comme si pour créer il fallait nécessairement détruire, mais que faute de nature à malmener, on en venait à s'en prendre à notre propre civilisation. Ainsi l'artiste dans la scène « salle 4 » Mum Art constitue-t-il son chef d'œuvre avec le cadavre de sa mère, avant de songer à s'en prendre à sa tante. On peut aussi évoquer encore une fois la fin de la scène « salle 5 » vernissage et l'acte de terrorisme.
La pièce prend fin sur la destruction du musée, c'est-à-dire la destruction de l'humanité, de la civilisation. Mosk, en défenseur de l'art et de la civilisation, aussi imparfaite soit-elle, se lance dans une dernière tirade aussi héroïque que vaine, seul face à la nature déchaînée, avec pour seules armes des œuvres d'art que l'on ne comprend pas, ne comprend plus. Peut-être est-ce cela la raison de cette fin apocalyptique : l'incompréhension de l'art, donc l'incompréhension de ce qui a vaincu la nature pour nous établir au-dessus de ses lois, finalement l'incompréhension de l'humain.
La dernière scène, particulièrement spectaculaire dans le film, montre quelques survivants du musée dérivant sur une parodie du Radeau de la Méduse, ultime construction bancale de l'humainté.