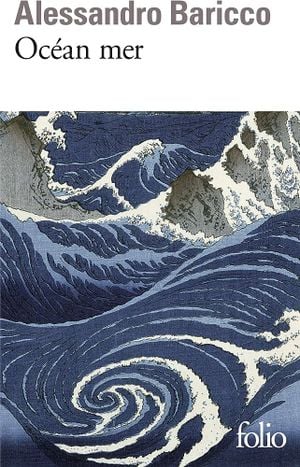Certains auteurs aiment la littérature comme on aime une amante, avec la fougue d’une passion nouvelle, et l’amertume délicate de l’expérience. Avec Océan Mer, Alessandro Baricco dessine les contours d’une obsession, celle d’une mer sans limite, et traduit dans un souffle grandiose et lyrique tout l’héritage de ses propres lectures. Musicologue et philosophe de formation, co-fondateur d’une école d’écriture à Turin où il enseigne depuis 2004 de nouvelles techniques de narration, Baricco révèle dans sa prose un goût pour le rythme et la déconstruction qui confère à ses récits une étrange folie douce, révélatrice d’un monde où l’homme construit autant qu’il rêve son propre chemin.
Récompensé par un prix Médicis étranger en 1995 pour son premier roman Châteaux de la Colère, on connaît surtout de lui Soie, une œuvre plus tardive sur les aléas d’un voyage tissé de larmes délicates et de fantômes fragiles, aussi ténus que la vie elle-même. L’auteur italien s’empare cette fois-ci de sept personnages à la dérive qu’il rassemble en un seul corps, en une seule voix, afin de composer une ode à cette mer que chantaient les aèdes, ce monstre sublime et cruel qui dévore et engendre les destins.
Comment en effet ne pas reconnaître dans la prose de l’auteur italien l’empreinte d'Homère, de Conrad et de Melville, trois auteurs emblématiques qui se lancèrent jadis à la poursuite d’un horizon à jamais insondable ? Baricco leur emprunte d’ailleurs – hommage s’il en est – des noms et des lieux grâce auxquels il établit la carte d’un voyage commun, quasi mythologique, vers cette immensité, ce « tout » qu’est l’océan mer, «plus puissan[t] que tous les puissants, plus merveilleu[x] que toutes les merveilles ». C’est ainsi qu’un certain Ismaël Bartleboom – parent direct du narrateur de Moby Dick et du personnage de Bartleby – se lance dans l’écriture d’une "Encyclopédie des limites et cetera", dans l’espoir de comprendre où finit la mer. Mais à la quête torturée d’un Achab se substitue celle plus douce d’un rêve à la recherche des « yeux de la mer » ; ces yeux qui se dérobent sans cesse au regard des hommes, les envoûte et les perd, pour mieux les ressusciter.
Dans le sillage de son compatriote Dino Buzatti lorsqu’il écrit *Le K* en 1966, et sous l’apparence d’un conte aussi philosophique qu’étrange, Baricco s’attache ainsi à dire le sens de la mer, mais aussi son secret : ici point de monstre marin ou de divinité providentielle, point de perle merveilleuse ou de richesse longuement convoitée, mais la certitude d’un abandon total et absolu dans lequel laisser glisser son âme, avec comme point de fuite l’espoir d’une rédemption, ou peut-être seulement d’une réponse.
Car face à la mer, posée sur le rebord du monde, une pension s’élève comme un naufrage insolent sur la courbe du ciel : là se retrouvent les cœurs noyés en mal de guérison et les échoués d’une existence qui s’efface déjà. Sept chambres pour sept pensionnaires, c’est toute la place qu’il faut à la pension Almayer où le temps semble suspendu, prisonnier d’une fin qui hésite et se fait attendre. Il y a Plasson, le peintre aux tableaux blancs, Ann Dévéria et son sourire triste, Elisewin, la jeune fille trop fragile pour exister, Bartleboom et ses lettres à l’oubli, le père Pluche et ses poèmes au ciel, Adam l’homme sans passé, et un septième encore, mais… qui sait ? Tous attendent en silence, et pansent leurs plaies d’un peu de sel et de mots partagés, gardés par des enfants étranges qui ont l’air d’avoir dix ans et en ont sûrement mille lorsqu’ils courent en riant la nuit, lanternes à la main sur la corniche des falaises. Tous attendent une révélation sans trop savoir si elle viendra, si ce sera la mort ou bien la vie, mais tous savent qu’elle ne dépend que d’elle, la grande mer immense dans laquelle ils se noient sans oser y entrer.
La narration procède par ellipses successives, détournements, interruptions, répétitions, comme pour invalider le phénomène même du temps : ici, il est possible de se laisser aller à sa propre folie puisqu’il n’est question que d’un cheminement vers une illumination intérieure, celle de se voir enfin et de s’accepter tel que l’on est, d’oser se regarder dans les yeux de la mer comme dans un miroir. Aussi monstrueux soit-il. Le roman est conçu comme une expérience quasi mystique dont le dieu référent n’est autre que la mer, partout la mer, comme un déluge implacable dans lequel l’âme se plonge et en ressort éteinte, ou purifiée. L'ombre de "La Méduse" – frégate française qui fit naufrage en 1816 et dont Géricault s’inspira pour réaliser son plus célèbre tableau – plane d'ailleurs sur le roman et illustre toute la violence de cette confrontation entre l'homme et la mer, sa dissolution dans la bestialité animale du monde.
« Plage. Et mer.
Lumière.
Le vent du nord.
Le silence des marées.
Des jours. Des nuits.
Une liturgie. »
Dans *Océan Mer*, Alessandro Baricco donne une voix à l'immensité, celle d'une chant aussi fracassant que le tumulte des vagues dans la tempête, aussi doux que l'écume dans le sillage des navires, une ode enfin à ce tout dans lequel l'âme se confond et se reconnaît enfin, insondable et secrète alchimie du vide. Car comme le signifiait Lautréamont dans les Chants I de *Maldoror*, « Quel est le plus profond, le plus impénétrable des deux, l’océan ou le cœur humain ? »