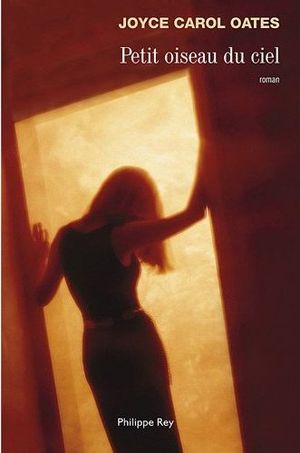Petit oiseau du ciel par BibliOrnitho
Attention : critique teintée d'une certaine dose de partialité !
Zoe Kruller est décédée. Assassinée une nuit de février 1983 dans sa maison de Sparta – NY. A 34 ans, elle aimait chanter avec son groupe et espérait enregistrer un disque. Percer. Etre heureuse. « Petit oiseau du ciel » est sa chanson qui a eu le plus de succès. Un succès néanmoins local. C’est également le surnom qu’elle avait donné à son fils. Zoé était belle, sexy et avait des rêves de carrière. D’ailleurs, ne devait-on pas l’emmener à Végas un jour prochain (preuve que ces espoirs n’étaient pas infondés) ?
La police a deux suspects (qui ne seront jamais arrêtés). Delray, le mari d’avec lequel elle vivait séparée : un homme peu bavard, un peu rustre à l’ascendance indienne Seneca incontestable. Et Eddy Diehl, un « blanc » comme elle : l’amant. Ou un des amants comme l’affirment les mauvaises langues. Car Zoe, après avoir travaillé comme vendeuse à la laiterie locale, était employée dans un bar. Et pas seulement comme serveuse à ce qu’on dit. Qui est le coupable ? Delray ou Eddy ?
Dans la première partie du livre, le lecteur suit les traces de Krista, la fillette d’Eddy. Agée de 11 ans à l’époque des faits. Elle adore son papa malgré son penchant pour l’alcool. Et son papa l’adore en retour. Lui aussi à surnommé son enfant chérie « Petit oiseau du ciel ». A la suite du meurtre (pudiquement appelé « les ennuis de papa »), le lecteur assiste à ses côtés à l’explosion de la bulle familiale. Papa qui quitte la maison pour s’installer chez un oncle. Ben, le grand frère se met à détester son père qui les a « abandonné ». Maman qui critique papa (adultère) à chaque occasion. Elle a d’ailleurs obtenu du juge une ordonnance interdisant à Eddy d’approcher maison, femme et enfants. Maman cherche à préserver les enfants. Elle s’enferme pour parler au téléphone. On ne regarde plus la télévision (surtout les actualités). Le journal ne traine plus sur la table. Mais Krista est une jeune fille intelligente : elle perçoit le malaise ambiant, elle voit sa mère pleurer, ses camarades de classes répéter ce qu’ils entendent chez eux. La haine de Ben est également dirigé contre les Kruller, les criminels responsables de leurs « ennuis » : rien de bon à espérer avec ces indiens. Pourquoi ne pas les maintenir dans leur réserve comme le demandent certains ? Bien sûr, il déteste Aaron qui a le même âge que lui. Même âge mais une classe d’écart car Aaron a redoublé. Même âge mais bâti bien plus solidement : un bagarreur, un délinquant multirécidiviste (déjà !) qui sait à peine lire et écrire et qui finit par être exclu définitivement du lycée (bon débarras).
La seconde partie donne la parole à la seconde famille. L’autre face de la médaille : comme un droit de réponse pour mettre en avant les spécificités, les différences mais aussi tous les points communs. Après Krista, la narration est confiée à Aaron. C’est lui, âgé de 15 ans qui a découvert le corps de sa mère : il venait chercher son cadeau de Noël que sa mère n’avait pas encore trouvé le temps de lui remettre. Le lecteur assiste cette fois à la séparation du couple Zoe/Delray, à l’admiration générale (et pas toujours muette) que la population masculine de la ville voue à la jeune femme. A l’antipathie et la discrimination tout aussi générales que son père et lui-même doivent subir au quotidien de la part des « blancs ». Les difficultés d’argent, le garage du père que les clients désertent un peu plus à chaque nouvelle publication de la photo de Delray à la une. Aaron, cet adolescent ténébreux, secret, qui fascine les filles et que les garçons craignent. Que les professeurs rabrouent sans cesse. Que la police surveille de loin attendant le faux pas non sans une certaine fébrilité malsaine. Le lecteur fait alors corps avec ce « sang-mêlé », gêné de la condescendance des « blancs » bienveillants, offusqué de l’injustice des plus radicaux (délit de « sale-gueule »). Irrité de l’indifférence du plus grand nombre.
A l’occasion de ce crime, Joyce Carol Oates nous décrit les deux mondes qui vivent côte à côte, se détestant souvent, se mélangeant rarement. L’affaire policière demeure à l’arrière plan : un simple fil conducteur jalonnant le livre. Le lecteur ne fera qu’apercevoir les enquêteurs, ne lira que quelques manchettes. Un prétexte, donc : un simple point de départ comme un autre pour initier une critique de la société américaine, ces environs des Chutes du Niagara, du lac Ontario et des Adirondacks que JCO connaît si bien. L’omniprésence du qu’en-dira-t-on, la force des rumeurs colportées de bouches à oreilles et qui font le tour de la ville en quelques heures. Les esprits rarement critiques toujours prêts à accepter une nouvelle (surtout les mauvaises), à croire l’incroyable. Les langues peu charitables proptes à invectiver, critiquer, calomnier. A répéter sans analyse et sans retard.
Une nouvelle fois, l’auteur étudie davantage les répercussions d’un évènement sur la population que l’évènement lui-même. Malgré son crime initial, ce livre n’a rien d’un roman policier mais reste une étude de mœurs dans laquelle JCO excelle. Comme à son habitude, elle distille ses indices par petite touches impressionnistes et ne n’attache pas trop d’importance pour la chronologie, sautant fréquemment d’une époque à l’autre, ajoutant une à une les pièces du puzzle. Un opus haut de gamme, à mi-chemin entre « Nous étions les Mulvanney » et « Johnny Blues » et qui, selon moi, rivalise avec les meilleurs. Un des JCO les plus noirs que j’ai eu l’occasion de lire. Un moment de lecture exceptionnel
Cet utilisateur l'a également mis dans ses coups de cœur.