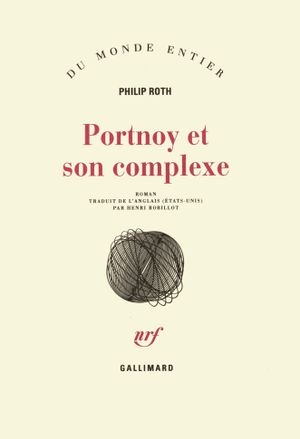Autant l'avouer : j'ai commencé ce livre avec un a-priori négatif vis-à-vis de Philip Roth. J'avais lu une interview de lui dans un magazine culturel, et j'avais été frappé par ses affirmations à l'emporte-pièce, du genre "l'oeuvre de Hemingway, à partir de tel titre, ce n'est que de la merde".
Avec la vague idée de dépasser ce préjugé, j'ai donc choisi d'en lire un, et tant qu'à faire le plus connu, "Portnoy et son complexe".
L'histoire se présente comme la confession- monologue d'un Juif New-yorkais à son psychanalyste, le Dr Spielvogel. Bien entendu, on part de l'enfance pour aller vers le plus récent, avec cependant des aller-retours. En gros, Portnoy est tiraillé entre son métier de haut fonctionnaire démocrate, son identité yiddish et ses perversions sexuelles assez déjantées. Et tout le livre tourne autour de cela. Un coup d'oeil aux titres des chapitres suffit pour comprendre que la libido remplira 2/3 du récit.
"L'être le plus inoubliable que j'aie jamais rencontré". Ce premier court chapitre est évidemment dédié à la mère juive, d'origine polonaise, mère possessive, qui ne cesse de castrer son fils tout en le portant aux nues. Souvenir traumatique : elle le menace un jour avec le couteau à pain. Le père, agent d'assurance, est surtout caractérisé par sa constipation chronique.
"La branlette" décrit toutes les ruses de l'adolescent pour se branler. Dans la salle de bain, dans le bus, n'importe où. Pendant les repas, avant, après, n'importe quand.
" Le blues juif" décrit la tristesse et la mentalité d'assiégés des parents. Leur déménagement de Jersey City à Newark. Les études à Wheequahic. La première rupture, quand Portnoy refuse d'assister à Rosh Hashana. Les remarques continuelles sur la nécessité d'être un bon Juif. La chaleur, aussi, avec l'amour du baseball.
"Fou de la chatte" raconte les ébats de Portnoy. Avec d'abord un long passage sur les avertissements de ses parents : ne te marie pas avec une "shikse" (fille goy). Avec notamment le récit d'une scène de triolisme à Rome, entre sa régulière, Mary Jane Reed (alias le Singe) et une prostituée. Il revient sur la première rencontre avec le Singe. Et aussi la première branlette par une Italienne de Hillside, Bubbles Girardi.
"La forme la plus courante de dégradation dans la vie érotique" parle des relations avec le Singe, grande fille superficielle et quasi illettrée, et des tensions que cause la culture de Portnoy au sein du couple. Leur voyage dans le Vermont et à Woodstock en décapotable, avec la scène-clé où il récite un poème sur Léda et le cygne pendant qu'elle lui fait une fellation. Puis le retour à New York et lui qui fait tout foirer. L'échec à faire de MJ une fille cultivée, et l'horreur devant son orthographe exécrable. Une scène horrible dans un taxi, car Portnoy l'emmène à une réception et elle a mis une tenue olé-olé.
Puis le narrateur enchaîne sur d'autres conquêtes antérieures qu'il a fait souffrir : une gentille étudiante Wasp et progressiste, Kay Campbell (méchamment surnommée "la citrouille), qui l'invite loin de sa famille. Il se met brusquement à la détester quand il lui demande pour rire de se convertir et qu'elle demande innocemment "pourquoi ferais-je ça ?", sans malice ni humour. et aussi "La pélerine", Sarah Abbott Maulsby, la fille d'une brillante lignée de républicains, dont Portnoy essaie d'obtenir une fellation, et qui fond en larmes de ne pouvoir bien le faire.
"En exil" mêle les remords d'avoir poussé le Singe à du triolisme et les souvenirs d'une virée en Israël, où Portnoy, comme maudit, n'arrive pas à bander. Tentant en vain de séduire une caricature de sabra convaincue, qui accable en lui le valet de la bourgeoisie, Portnoy finit par essayer de la prendre de force mais renonce devant son impuissance. Le livre se termine sur un délire parano et la seule réplique du psy : "Pon, alors maintenant, nous beut-être bouvoir gommencer, oui ?".
L'écriture est fluide, et les coqs-à-l'âne maîtrisés, l'oralité, le flux de conscience rappellent un peu le Samuel Beckett de "L'innommable". Cependant j'aime beaucoup moins que Becket, et c'est sans doute snobisme de ma part. La scatologie, la vulgarité ne me gênent pas chez Beckett, mais chez Roth elles me semblent de la facilité. Je trouve infiniment plus spirituel quand le narrateur de Beckett se demande si on aurait écouté Jésus s'il avait fait caca en public que les délires de Roth autour de ses éjaculations qui se collent à l'ampoule électrique.
Sans doute parce que chez Beckett le narrateur est une conscience, mais n'est pas aussi autocentré. Chez Roth, nous nageons ouvertement en pleine psychanalyse, et ce n'est jamais que moi, moi, moi. Ecriture nombriliste que l'on peut tenter de présenter comme le comble du modernisme, mais chez moi ça ne fonctionne pas.
Sinon, le livre pourrait être intéressant pour le regard qu'il porte sur le monde juif, la culture yiddish (méprisée par la Sabra comme "culture du ghetto"). Mais tous les caractères sont tellement outrés de façon à faire un récit rigolo que ce n'est guère amusant. Et le récit suppose trop de conventions à connaître pour ne pas être quelque peu désagréable, par moments.
Finalement, la manière la plus subtile de prendre ce livre, ce serait de s'intéresser à la manière dont Portnoy fait tout rentrer dans des cases, joue sur les outrances, invente des surnoms pour mettre le monde à distance de lui. Mais sincèrement, qui aurait envie de se faire le psy de ce type, de faire le tri entre ses fantasmes et la réalité ? Moi désolé, mais il faudrait me payer, et au moins à hauteur des honoraires du Dr Spielvogel.
Maintenant je sais que je n'aime pas Philip Roth.