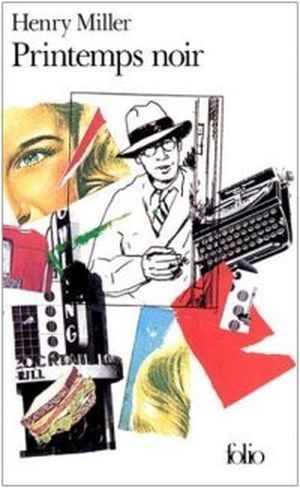Miller : l'écriture en tiroirs
C'est la seule petite note que j'ai inscrit dans mon carnet, après les cinquante premières pages. L'écriture en tiroirs, l'écriture qui déborde.
J'ai toujours pensé que ma rencontre avec Miller (que j'imaginais déjà comme décisive, ce genre de rencontre où l'on tombe fou amoureux et fou furieux) se ferait avec Jours tranquilles à Clichy. Je l'avais même commandé, je l'attendais avec impatience, et un matin comme ça sans prévenir j'ai trouvé à la place, dans une petite brocante à la con, Printemps Noir.
J'ai commencé dans la voiture, et les mots étaient si forts, si beaux, que j'ai dû refermer le livre. Je me suis dit, ne mange pas tout d'un coup, ralentis, mais impossible de m'arrêter. Le vocabulaire de Miller est plus que riche, il est inépuisable. Il est souple, fluide, il coule comme de l'eau, il va à mille à l'heure, puis à reculons, en diagonale, il couvre tout, tout, tout. Il n'y a rien qui n'ai pas été raconté dans Printemps noir. La mort, le sexe, la vie, les femmes, la misère, New York, Paris, Neptune, maman et les boutons de manchette. Tout est sur le même pied d'égalité, à la même hauteur, se toisant sur le quai d'une gare.
Je ne saurais même pas vraiment dire ce que j'en retiens - peut être l'impression qu'enfin, enfin, on parle la même langue que moi.
Je crois n'avoir jamais lu quelque chose qui se rapproche autant de ce dont je suis déjà intimement persuadée : la nécessité de vivre sans temps, en milliers de fragments, d'accepter sa pluralité et son égoïsme, son égocentrisme, aimer la vie dans tout ce qu'elle a de plus hideux, de plus barbare. Et puis, être magnifiquement désespéré ! Toujours le sourire, le sourire sous les coups. Toujours en marche, laissant les cadavres de soi derrière soi. Ne jamais s'arrêter - marcher, courir, écrire.
Voilà, ne jamais s'arrêter d'écrire. Toujours chercher plus loin dans les mots, avec les mots, contre les mots.