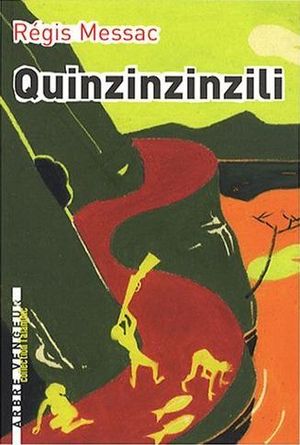Ce n’est pas seulement pour son titre délirant que Quinzinzinzili flirte avec le « genre » lui-même difficile à définir des curiosa. À n’y voir qu’une espèce de « roman-culte », avec ce que ces deux mots peuvent avoir de rassurant, on en oublierait presque qu’il est foncièrement déglingué. Plus déglingué que Sa Majesté des mouches, paru quelque vingt ans plus tard, dont il partage le thème : la régression d’un groupe d’enfants (ici presque) livrés à eux-mêmes. Si le roman de Golding véhicule une vision sombre de l’humanité, celui de Messac fait dans le noir de chez noir. (Il n’y a plus d’espoir !)
Premier constat : il y a quelque chose de visionnaire dans ce roman d’anticipation publié en 1935 et qui raconte sa Deuxième Guerre mondiale : « Un jeune officier de marine japonais, agissant sans ordre et de sa propre initiative (du moins c’est ce qu’il affirma publiquement par la suite avant de se faire hara-kiri), vint avec son bâtiment bombarder Honolulu. » (p. 35). Sans en dévoiler trop, cette Deuxième Guerre mondiale-là cessera faute de combattants…
Deuxième constat : pour le reste, et d’un point de vue littéraire, Quinzinzinzili ne semble pas apporter grand-chose de nouveau. Un narrateur qui commence par se demander s’il est fou, même en 1935, ça n’a rien de surprenant : « Moi, Gérard Dumaurier… / Ayant écrit ces mots, je doute de leur réalité. Je doute de la réalité de l’être qu’ils désignent : moi-même. Est-ce que j’existe ? Suis-je autre chose qu’un rêve, ou plutôt un cauchemar ? L’explication la plus raisonnable que je puisse trouver à mes pensées, c’est que je suis fou » (incipit). Et plus ce qui sert d’intrigue avance, plus ce serait rassurant qu’il soit fou – mais moins c’est plausible... Quant au style vaguement oralisant, on pouvait lire mieux quelques années avant : chez Céline, oui. (D’ailleurs, on peut risquer un parallèle entre Messac et Céline : nés à un an d’intervalle, mobilisés et blessés pendant une Première Guerre mondiale sur le compte de laquelle on peut mettre la misanthropie foncière qui anime leurs récits, ils peuvent être regroupés au sein de cette nébuleuse qu’avec les pincettes d’usage on appellera « anarchisme ». Mais comme en histoire littéraire deux parallèles peuvent finir par se croiser, le premier mourra par ceux dont le second avait choisi d’être complice. Messac et Céline sont l’avers et le revers d’une même pièce.)
Troisième constat : on est au-delà de l’humour noir. (Ce n’est pas non plus macabre à proprement parler ; c’est autre chose.) Que dans une humanité ravagée ne subsiste plus qu’une seule femme – disons femelle : les enfants deviennent des adolescents au cours du récit, et l’âge finit par moins compter que le sexe –, c’est tout à fait plausible ; qu’elle soit particulièrement laide, ce sont des choses qui arrivent ; qu’on émette l’hypothèse que « ses fesses molles, ses tétines basses et son ventre en chaudron seront désormais les modèles de la beauté future » (p. 119 de la réédition de l’Arbre Vengeur), c’est cohérent (une des qualités de Quinzinzinzili est d’ailleurs sa cohérence avec les données de départ). Et c’est drôle. Mais la femelle en question s’appelle Ilayne ; une déformation d’Hélène ; vous savez, Hélène, la belle Hélène, celle dont la possession fut la cause de la première guerre de la littérature occidentale. Là, tu parles d’un enjeu !
Significativement, d’ailleurs, c’est un gaz hilarant poussé à l’extrême qui abolit l’humanité. (Oui, il s’agit d’un genre de protoxyde d’azote modifié, cela dit à l’attention des chimistes qui lisent des livres.) Le narrateur ajoute (p. 48) que « C’est de cette façon que les hommes devaient mourir, pour ce que le rire est le propre de l’homme. » Le lecteur lettré aura relevé, dans la dernière partie de la phrase, la référence à Rabelais. Rabelais l’humaniste, oui. Là encore, tu parles d’un humanisme !
Quatrième constat : j’ai pourtant l’impression que tout dans Quinzinzinzili est bien à lire au premier degré. L’intrigue elle-même – nos enfants de Cro-Magnon découvrent, se battent, aiment, tuent, explorent… – a quelque chose de tout à fait sérieux, comme elle le serait dans n’importe quel récit ou l’humanité repart de zéro (mettons la Guerre du feu, ou dans un autre registre Ravage). Et les échecs récurrents des gosses cavernicoles n’ont rien de drôle : le roman de Messac semble au contraire mettre en place un tragique de répétition.
La place accordée à la religion (« sans doute ce qui a le mieux résisté à la catastrophe », p. 89) fournit un autre exemple de cette omniprésence du premier degré. Alors qu’elle est présentée sans compromis comme un ensemble de superstitions destructrices, la religion fournit les repères en miroir desquels se construit le roman, depuis cette Révélation toute particulière que constitue l’Apocalypse – apocalypse signifie au sens propre dévoilement, d’où révélation – jusqu’aux références à la mythologie biblique : « Le jour fameux, le jour de colère… où donc ai-je entendu ça, déjà ? » (p. 54), par exemple, est une allusion claire, et des passages comme « Depuis, les serpents de toute nature sont devenus le principal gibier de l’humanité nouvelle. C’est l’espèce qui a le mieux résisté à la destruction (les serpents, veux-je dire). » (p. 73) me semblent à envisager dans une perspective religieuse. On a ici quitté le domaine de la simple moquerie dénuée de sous-texte.
Cinquième constat : au cœur de Quinzinzinzili, il y a la question du langage. C’est explicite dans le roman : la pauvreté de leur langage est l’une des raisons pour lesquelles le narrateur hait les enfants qui l’accompagnent. Avant même que celui-ci puisse dire que « L’amour, la haine, la jalousie, la vengeance et l’assassinat final, tout est concentré en moins de temps qu’il n’en fallait, à la Comédie française, pour déclamer quelques douzaines d’alexandrins. » (p. 124), la mutation de la langue nouvelle – composée en gros, d’une bonne part de français, et d’un peu d’espagnol, de languedocien et d’espagnol, le tout nasalisé – aura préfiguré la déchéance totale de cette humanité future : Gérard Dumaurier finit par dire des enfants (p. 134) « Ils ne peuvent pas me comprendre, et je les comprends de moins en moins. »