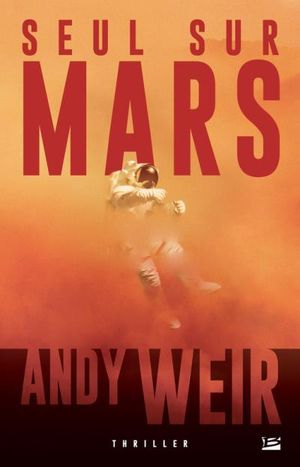La tentation était forte, afin de me ménager une dose de suspens, à la quasi-veille de la sortie de son adaptation cinématographique, de ne pas me jeter sur l'unique roman d'Andy Weir. Et force est de constater, je vais le dire clairement, que c'eut été une faute dramatique. Non pas que le livre soit à la hauteur de sa fantastique réputation (à ce niveau-là on est en fait en deçà de ce que j'espérais) mais plutôt que de deux mots, il faut choisir le plus long. Littérature à cinéma (je sais on dit cinématographe, faîtes pas chier), livre à film, huître à moule, défaire son lit à faire son lit, affaire au lit. Car souvent le plaisir suit. Et c'est ainsi qu'après de longs mois d'hésitation, j'ai préféré aux cent-trente minutes que durera le film de Scott, les quatre ou cinq heures de mon adaptation mentale. Toujours se réserver individuellement la primeur d'une expérience intellectuelle.
De prime abord, comme ça là, le livre en main et sans même en feuilleter les premières pages ou en décortiquer la quatrième de couverture, le pitch a cette classe, cette allure, cette assurance, cette élégance, cette audace, cette prestance, cette évidence des classiques instantanés de la SF : un homme laissé pour mort sur Mars par la NASA revient d'outre-tombe et organise sa révolte sur la planète rouge. Celle contre la mort. Celle pour son salut. Comment se fait-il que personne n'ait encore eu cette idée toute simple et pourtant redoutable? La question est légitime... Et reste toujours sans réponse. Alors on s'interroge. Combien de truismes, de mythes en devenir, combien d'autres histoires aussi lumineuses et criardes que celle-ci nous restent encore invisibles, hors de portée de notre imagination, tapie dans l'ombre, indicible, de notre ignorance?
Le dieu rouge a désormais la sienne, ou disons plus raisonnablement l'une des siennes, tant The Martian, derrière ses allures de survival ultime, pêche en bien des domaines et notamment dans l'absence d'un fin tacticien derrière la plume, à défaut d'un grand écrivain. Il y a donc de rares occasions, comme ici, où l'on peut regretter l'absence au commande d'un projet, soit-il cinématographique ou littéraire, de ce qu'on appelle génériquement "un petit malin". Un mec cynique et cultivé juste comme il faut, rompu à l'exercice, capable de nous monter, à partir d'une idée de base géniale, une trame et un suspens, certes éculés, mais diablement efficaces. Un Damon Lindelof de derrière les fagots quoi.
Pourtant, si l'on peut éminemment regretter que l'idée n'est pas germée dans l'esprit génialement fertile d'un Frank Herbert ou d'un Poul Anderson ou bien dans l'imagination enfiévrée d'un Jules Verne ou d'un H. G. Wells, tout n'est pas à jeter dans le travail d'Andy Weir. La concision de ses descriptions, la clarté de ses explications mathématiques, l’innocence de ses courtes et bien trop rares digressions, l'empathie pleine de sincérité envers son héro malchanceux, la finesse peut-être un peu maladroite et dénuée d'ambition du style "journal intime" ou encore l'expertise de sa documentation sont à mettre dans la colonne des "plus". On peut même lui reconnaître une certaine ingéniosité et un merveilleux sens pratique, les qualités du botaniste perdu là où rien ne pousse étant bien évidemment imputables à celles de son père scribouillard.
Mais voilà, il manque ce petit quelque chose, cette parabole biblique à laquelle raccrocher les déboires de Watney, cette métaphore mythologique à mettre en perspective avec cette tentative d'évasion de l'enfer. Cette portée philosophique, ce questionnement ethnologique, culturel et naturaliste qu'une solitude aussi sévère appelle forcément et qu'un Thoreau n'aurait jamais imaginé dans cette mesure. Cette radicalité aussi qui aurait peut-être obligé Weir à sacrifier les quelques passages sur Terre à Houston ou dans l'espace à bord du vaisseau Hermès, pour se concentrer uniquement sur son cowboy martien solitaire et nous faire totalement vivre, que dis-je éprouver, l'attente d'un retour hypothétique à la civilisation. Comme l'avait fait Cuarón avec le docteur Ryan Stone dans Gravity, se contentant des quelques échanges verbaux avec capcom pour bien nous signifier que durant 90 minutes, cette liaison radio serait notre ultime cordon ombilical vers notre terre mère. Ce sel métaphysique enfin à saupoudrer tout au long des 400 pages que compte le roman qui l'aurait emmené à la place qui aurait du être la sienne, quelque part entre John Carter, Dune, Tau Zero et Walden : ce dieu rouge, ce Nergal, ce Maître de la Grande Bile, cet astre glacial de la guerre... pour la survie... que la morale voudrait digne d'une Perséphone, d'un Achéron, plus sèche et froide, moins mièvre ; celui qui mange la nourriture des morts de devrait jamais en retourner. La faute, comme je l'écrivais plus haut, à ce style trop répétitif qui handicape toute esquisse d'émancipation du roman au pure genre de la SF, toute élévation du récit à la simple accumulation de péripéties, toute envolée onirique à cette succession infernale de problèmes de mathématique. Mais si il freine bel et bien l'ambition du récit, il lui imprime aussi sont rythme trépidant, haletant, et lui confère son caractère très personnel, au plus près de son personnage principal, le déjà culte Mark Watney.