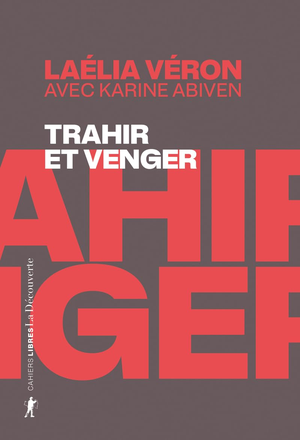Difficile aujourd’hui de passer à côté du succès rencontré par les récits de transfuges de classe, pour peu qu’on suive de près ou de loin l’actualité littéraire. Le Nobel attribué à Annie Ernaux a mis un sacré coup de projecteur sur le genre, même s’il ne l’a pas légitimé aux yeux de tous. Précisons qu’il serait réducteur de réserver l’appellation de récits transclasses aux œuvres similaires à celles d’Annie Ernaux ou d’Édouard Louis, tant ces récits s’inscrivent depuis bien longtemps dans des catégories plus générales, comme l’autobiographie (pensons à Rousseau, à Camus), la success story, l’essai sociologique, l’autofiction à la Modiano. Pourtant, lorsque ce dernier reçoit le prix Nobel, il ne vient à l’idée de personne que l’œuvre ainsi récompensée est celle d’un transfuge de classe. Et parmi les écrivains qui relatent leur ascension sociale (très rarement leur déclassement) tous, loin de là, n’entendent pas venger leur race, qu’ils ont pourtant le sentiment d’avoir trahie et parler au nom des sans voix, si pas à leur place.
Le mérite de l’ouvrage de Karine Abiven et de Laélia Véron est de se vouloir exhaustif, leur analyse balayant un large spectre de productions littéraires s’apparentant aux récits de transfuges de classe. Elle dégage les caractéristiques du genre et son schéma narratif extrêmement figé, elle examine ses liens avec des domaines non littéraires comme la sociologie ainsi que les messages idéologiques et/ou politiques que ces récits entendent promouvoir. Dans l’ensemble, l’ouvrage m’a paru assez objectif, soulignant la cohérence de certains positionnements mais pointant le cas échéant les paradoxes ou les contradictions qui les traversent.
Que dans son autobiographie, Rachida Dati se présente comme un pur produit de la méritocratie républicaine est somme toute conforme à ses positions politiques. Que, fraîchement honorée du Nobel, Annie Ernaux dont la vision sociale est proche des thèses de Bourdieu, aille défiler aux côtés de Jean-Luc Mélenchon contre la vie chère n’a rien de surprenant. Mais si, de manière générale, les récits qui ne remettent pas en cause les institutions ou l’ordre établi n’ont guère de mal à assurer une certaine cohérence, ce n’est pas le cas que ceux qui véhiculent une approche déterministe et conflictuelle entre dominants et dominés, approche qui va souvent de pair avec une position radicalement militante.
Parmi ces paradoxes, on peut relever l’attitude ambiguë qui consiste à ne pas assumer le caractère littéraire de son œuvre, sous prétexte de ne pas faire de l’ombre à la nature avant tout politique de celle-ci. De là, le refus de « faire du style » tout en se déclarant en la matière les héritiers de Duras ou de Camus, excusez du peu. Reste à savoir si l’ambition affichée de rester sous le seuil littéraire est compatible avec le fait de publier dans des maisons d’édition reconnues, de rencontrer le succès public, de recevoir des prix prestigieux.
Pour en revenir au caractère prétendument politique de ces récits centrés sur un parcours individuel et des affects intimes, il faut avouer qu’il ne saute pas toujours aux yeux. Il ne suffit pas de brandir sa trajectoire toute personnelle comme un miroir naturaliste pour mobiliser les consciences, encore moins pour induire un changement sociétal qui ne peut venir que d’une action collective. Certes, beaucoup de lecteurs ressentent une certaine proximité avec les émotions que véhiculent ces récits, telles que la honte, le sentiment de trahir, la colère, de la peur de ne pas être légitime mais celles-ci ne sont pas spécifiques aux transfuges de classe. Un exemple parmi tant d’autres, mentionné dans cet ouvrage et qui m’avait interpellée dans La Honte d’Annie Ernaux : le traumatisme qui a marqué l’auteure, traumatisme identifié par elle-même comme l’origine du sentiment d’inadéquation sociale qu’elle a dès lors ressenti est lié à une scène extrêmement violente à laquelle elle a assisté, son père ayant un jour tenté de tuer sa mère. Ce n’est donc pas tant la découverte de rapports de domination qui la fait se sentir indigne, mais une violence physique intra-familiale et le secret honteux qui lui donne l’impression d’être différente. Quant au désir de vengeance souvent revendiqué par ces auteurs, on a du mal à comprendre en quoi la réussite individuelle et l’accession au statut d’écrivain pourrait venger les injustices sociales subies par les générations précédentes.
Un autre point (parmi d’autres sur lesquels je ne m'appesantirai pas) qui pose question, c’est la place primordiale que l’école occupe systématiquement dans ces récits, même chez les tenants des thèses de Bourdieu. Or, refuser le discours méritocratique en accusant l’institution scolaire d’être un modèle de reproduction sociale alors que son propre parcours démontre qu’elle peut être un vecteur d’émancipation n’est pas une position facile à assumer, pas plus qu’une ascension sociale qui contredit les thèses déterministes qu’on défend. On peut bien sûr estimer être l’exception qui confirme la règle mais difficile dans ce cas d’échapper à la posture du héros qui réussit contre vents et marées. Sans compter que le récit d’une exception peut difficilement prétendre à devenir un modèle politique censé représenter le plus grand nombre.
Dire que la nobélisation d’Annie Ernaux a été diversement reçue est un euphémisme. Rarement une œuvre aussi clivante aura été récompensée d’un prix aussi prestigieux. Et phénomène plus rare encore, c’est au sein même du pays d’origine de l’auteure que les polémiques ont été les plus vives. Tout ce qui est excessif est souvent insignifiant et le mérite de cet ouvrage est d’adopter un point de vue rigoureusement argumenté pour expliquer, en dehors de toute considération politique, pourquoi de telles œuvres peuvent séduire, émouvoir de par leur caractère authentique et susciter chez certains un réel sentiment de proximité tout autant qu’elles peuvent crisper un lecteur plus critique par les paradoxes et les biais cognitifs qui les sous-tendent.